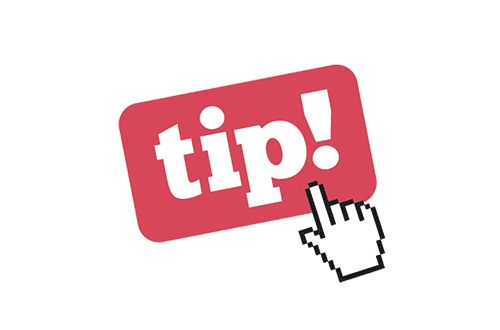-
Par fab75du31 le 29 Novembre 2023 à 21:09
L’année 2016.
Brisbane, janvier 2016, au petit matin.
Dans une cellule de dégrisement d’un poste de Police.
Allongé sur le petit lit de ta cellule, le corps meurtri par les coups, épuisé par la fatigue et par une migraine terrible, tu te sens mal, très mal, pire que mal. Tu n’arrives pas à réaliser ce qui s’est passé, ce que tu as fait. Tu ne peux admettre d’en être arrivé là, tu ne peux t’empêcher de ressentir un profond écœurement à ton égard.
Pourtant, ça fait un bail que tu te déçois toi-même, chaque jour un peu plus que le précédent. Au cours de ces trois années, tu t’es senti tomber de plus en plus bas, tu t’es senti entraîné dans un cercle vicieux duquel tu n’as pas pu t’extirper.
Mais tu ne t’es jamais senti aussi minable qu’à cet instant où le bien le plus précieux pour un homme, sa liberté de mouvement, vient de t’être retiré pour une durée encore indéterminée.
Tu appréhendes les conséquences de cette horrible nuit. Tu t’en veux à mort pour la violence dont tu t’es montré capable, pour cette noirceur qui s’est exprimée chez toi, qui a explosé en un instant, et sans raison valable. Tu sais que tu ne te pardonneras pas d’en être arrivé là.
Tu crains que ta famille et tes amis puissent apprendre un jour ce que tu as fait.
Tu crains par-dessus-tout qu’IL apprenne un jour ce que tu as fait. Et qu’il soit déçu et dégoûté au point de se demander comment il a un jour pu tomber amoureux d’un sale type comme toi.
Toulouse, janvier 2016.
La nouvelle année démarre sur une sorte de nuage que je me suis construit autour de ma nouvelle passion. Je passe tout mon temps libre à écrire, soirées, nuits, week-ends. Et, devant mon clavier, je ne vois pas les heures passer.
Ça occupe mon esprit et ça me plaît. Même si mon seul lecteur, c’est moi-même. Mais ça me suffit. Je ne me sens pas prêt à partager mes récits avec qui que ce soit. C’est mon jardin secret, et ce que j’y cultive, c’est de l’ordre du très intime.
Les seuls moments où j’interromps mon écriture, c’est quand Martin me sonne. Agréables interludes qui me font renouer avec une certaine sensualité.
Je sais que ce que j’ai avec Martin ce n’est pas une relation équilibrée, et qu’elle contribue dans une certaine mesure à m’empêcher de rencontrer un gars avec qui je pourrais être heureux. Mais pour l’instant, ce gars je ne sais pas où le chercher.
Alors, oui, avec Martin, c’est une relation « faute de mieux », une relation purement sexuelle. Saupoudrée d’une certaine complicité, certes, mais qui ne m’offrira jamais une relation véritable.
Mais c’est aussi une relation qui ne me demande aucun investissement, une relation par laquelle je me laisse porter. Une relation qui me laisse toute la latitude pour tenter de faire la paix avec mon passé.
En fait, il y a d’autres occasions où je suis « forcé » de détacher les yeux de l’écran et les doigts du clavier. C’est lorsque Galaak vient se coller contre ma jambe et pousser avec une force capable de faire rouler mon fauteuil de bureau avec moi assis dessus.
C’est lorsqu’il réclame une sortie pipi, ou bien ses croquettes, un câlin, ou tout simplement un peu de mon attention. Ou une séance « pouic pouic ». Pour cela, il a bien appris du pauvre Gabin. Il approche avec le jouet entre les crocs, il est tout fou fou, mignon à croquer, et il le laisse tomber à mes pieds. Le message est clair. « Et maintenant, on joue ! La vie c’est fait pour jouer, aussi ! ».
C’est la pause Galaak.
Brisbane, janvier 2016.
Le désastre était inévitable. Ton esprit était trop noir, et depuis bien trop longtemps. Et tu étais saoul, beaucoup trop saoul. Tu étais une bombe ambulante à la charge instable. Tu aurais pu exploser à chaque instant, pour peu qu’une étincelle se présente sur ton chemin.
Et l’étincelle s’est présentée sous la forme d’un gars croisé sur une fête foraine, lui aussi un tantinet éméché. Vous êtes passés l’un à côté de l’autre, et ni lui ni toi n’avez rien fait pour éviter la collision. Vos épaules se sont heurtées violemment. Tu t’es retourné, il s’est retourné. Les insultes ont volé.
Et puis, l’outrage de trop est sorti de la bouche de ce type :
« Fukin’ fag ! ».
Là, tu as vu rouge. Tu l’as cogné en premier. Le gars était costaud, il ne s’est pas laissé faire, tu as pris quelques coups très violents en retour. La douleur et l’odeur de ton sang ont décuplé la rage qui couvait en toi. Tu t’es relevé, et tu t’es jeté sur lui. Tu l’as cogné de toutes tes forces. Et tu as fini par avoir le dessus.
Toute la rage, la colère, la tristesse, le sentiment d’injustice, l’humiliation, la déception, la solitude accumulées depuis des années sont sorties de toi, d’un coup, d’un seul, te transformant en un fauve à la violence incontrôlable.
Et tu l’as frappé encore et encore. Le type s’est transformé en punchingball, en exutoire tout trouvé pour ton esprit meurtri par trop d’années de subissements. Et il a pris pour tous ceux qui t’ont humilié ou fait du mal un jour.
Il a pris pour ces connards qui t’ont tabassé, à Paris, le soir de tes 25 ans, et qui t’ont volé des mois de rugby, et ton fragile équilibre si difficilement bâti.
Il a pris pour ceux qui t’ont traité de pédé pendant un match après ton retour sur le terrain.
Il a pris pour ces charognards qui t’ont pris en photo avec Rodney, qui ont écrit de la merde, qui l’ont publiée, en anéantissant ainsi, juste pour vendre un peu plus de papier, toute ta carrière au rugby.
Il a pris pour ceux qui t'ont aimé et admiré tant que tu marquais des essais et qu'ils te croyaient hétéro, et qui t'ont craché dessus quand ils ont su que tu étais gay.
Il a pris pour les sponsors qui se battaient pour t'engager et qui ont tous disparu jusqu'au dernier le lendemain de l'article sur ce maudit torchon.
Il a pris pour ceux qui t'ont poussé vers la sortie du rugby alors que tu avais encore tant de belles années devant toi.
Il a pris pour toute cette humiliation qui t’a meurtri, t’obligeant à fuir à l’autre bout de la Planète.
Tant qu’à y être, il a pris aussi pour ceux qui n'ont pas voulu de toi au Stade Toulousain après ton bac. Un rêve, celui de jouer en Noir et Rouge, qui ne t’a jamais quitté, et qui a été presque à ta portée à un moment, avant de d’être lui aussi arraché le soir de tes 25 ans.
Et, pourquoi pas, il a pris aussi pour le mec qui a séduit ta mère et qui l’a amené avec lui alors que tu n’étais encore qu’un enfant. Et pour les gosses en CP qui se moquaient de toi et te bousculaient parce que tu étais un enfant petit, maigrichon, isolé et taciturne.
Il a pris aussi pour ce joueur biarrot qui t’a explosé le genou lors d’un placage et qui t’a volé une année de rugby. Et pour tous ces coups que tu as pris parce que tu étais le joueur à abattre pour espérer remporter le match. Des coups répétés et violents, dont le souvenir se réveille de plus en plus souvent dans ta chair, et de plus en plus douloureusement.
Au final, le gars de la fête foraine a pris pour toute la colère qui s’est accumulée en toi jusqu’à devenir totalement incontrôlable le jour où tu t’es retrouvé seul et sans rêves.
Il a pris pour tous ceux qui auraient mérité tes coups, il a pris les coups que tu ne pourras jamais assener à leurs destinataires naturels.
Il a pris parce que tu te détestes, tu te dégoûtes d’être gay, car tu sais que cette « tare » te suivra toute ta vie et que ça jouera toujours contre toi. Parce qu’être pédé a été la source de tous tes problèmes. Parce qu’être pédé t’a fait tout perdre, le rugby, ta passion, ton rêve, les honneurs, la gloire, la belle vie, tes potes. Et l’amour, aussi.
Et par-dessus tout, il a pris pour ta solitude et ton malheur actuels qu'aucun voyage, aucune cuite, aucune baise n'arrive pas à te faire oublier.
Heureusement, quelqu’un est venu s’interposer, t’immobiliser. Ils ont dû s’y prendre à plusieurs pour te maîtriser. Retenu par de nombreux bras charitables, ta pression retombe d’un coup et tu réalises avec horreur ce que tu viens de faire. Tu regardes le type à terre et cet autre gars qui lui porte secours. Et déjà les remords déchirent ton âme.
La peur du pire t’envahit, tu te mets à trembler comme une feuille. Et les larmes sortent de toi comme un torrent en crue, tu pleures sans plus pouvoir t’arrêter.
Toulouse-Martres Tolosane, janvier 2016.
En ce début d’année, ça bouge dans mon taf. Suite à un départ à la retraite, je me vois proposer un nouveau poste qui m’amènera à être le plus souvent présent sur les sites d’exploitation au sud de Toulouse.
L’envie de me rapprocher de mon nouveau taf se joint à celle de prendre un nouveau départ et de chercher un meilleur cadre de vie pour moi et mon Galakou d’amour. Je décide de quitter Toulouse et d’emménager à la campagne. Après une courte recherche, je pose mes valises dans une maison avec un grand jardin située dans un très charmant village sur la route des Pyrénées.
En quittant Toulouse, je m’éloigne de tous mes repères, ma famille, mes amis. C’est un nouveau départ, un saut vers l’inconnu. Mais je crois que je vais être bien à Martres-Tolosane.
Le soir de mon emménagement, je regarde Galaak gambader dans le jardin et poser son odeur aux quatre coins de la clôture. Je crois que lui aussi va être bien ici.
Brisbane, janvier 2016.
Dans une cellule du Centre Correctionnel.
La question ne cesse de tourner dans ta tête. Comment as-tu pu en arriver là ? Comment es-tu devenu cette bombe à retardement qui ne demandait qu’à exploser ?
A bien regarder, cette « charge explosive » s’est accumulée en toi depuis ton enfance. Elle est la somme de tes peurs, de tes frustrations, et de tes humiliations.
Le fait est qu’au lieu d’affronter tes démons intérieurs, tu as trop souvent choisi de les fuir. C’est tout toi, ça, Jérém. Fuir plutôt qu’assumer. Depuis le temps, tu devrais avoir appris la chanson. Mais ce n’est toujours pas le cas, hélas.
Il ne sert à rien de fuir pour tenter de semer tes démons intérieurs. Car ils sont en toi. Et si tu ne leur règles pas leur compte, ils ne cessent de grandir avec le temps. Jusqu’à ce que la jauge se retrouve à un niveau critique.
C’est ce qui t’est arrivé, Jérémie.
Après la bagarre, l’attente des secours t’a paru interminable. Tu as été soulagé de voir que le type que tu avais cogné semblait moins amoché qu’il t’avait semblé sur le coup.
Quant à toi, tes quelques blessures étaient plutôt légères. Ainsi, après un court détour par les urgences, la Police t’a embarqué et foutu en cellule de dégrisement. La dynamique de l’« accident » a été très vite reconstituée. Ton état d’alcoolémie crevait le plafond. Le type aussi était saoul. Mais toi, tu t’es acharné sur lui, de nombreux témoins ont pu le confirmer. Tu as été renvoyé en comparution immédiate devant un juge.
Tu as eu de la chance. Ton avocat t’a appris que le type n’aura pas de séquelles. Et tu as pleuré de soulagement.
La sentence a été somme toute clémente. Deux mois avec sursis, quelques dizaines d’heures de travaux d’intérêt général, le remboursement des frais médicaux du type, ainsi qu’un fort dédommagement.
Martres Tolosane, début avril 2016.
Près de trois mois après mon installation à Martres, la maison est enfin complètement aménagée. Le printemps arrive, et je sens monter en moi une nouvelle envie, celle de recevoir du monde dans mon petit chez moi à la campagne. Autour de grillades dans le jardin, je pends la crémaillère en plusieurs actes.
D’abord avec ma famille, Papa, Maman, mais aussi Elodie, Philippe et la petite Lucie. Elle n’est plus si petite d’ailleurs, la crevette a bien grandi, elle va bientôt avoir 14 ans, et il semblerait qu’elle ait déjà un amoureux au collège.
Quelque temps plus tard, c’est au tour de mes amis de découvrir mon nouveau cadre de vie. A commencer par Thibault et Arthur, les deux adorables pompiers, forts désormais d’une histoire de près de dix ans. Ils ont également amené le petit Lucas qui, du haut de ses 14 ans et demi, est en train de devenir plutôt beau garçon. La passion sportive de son papa ayant déteint sur lui, il ne jure que par le rugby et il joue dans une équipe junior au poste d’ailier. Comme Jérém en son temps.
Sont également de la partie Julien, le beau moniteur d’autoécole, ainsi que sa (nouvelle) copine, une certaine Laura. « Je crois que c’est la bonne » il m’a lancé discrètement en arrivant chez moi, tout en accompagnant ses mots avec un sourire fripon et un clin d’œil malicieux en contraste total avec ses propos.
J’ai bien évidemment convié Stéphane et Iban, dont la relation dure depuis trois ans déjà.
Entouré de mes amis, je me sens bien, je passe une très agréable journée. La conversation est rythmée, joyeuse. Personne ne se hasarde à évoquer de près ou de loin le sujet qui pourrait gâcher l’ambiance.
C’est fou comme près de dix ans après ma séparation avec Jérém, ce sujet soit toujours tabou. C’est certainement de ma faute. J’ai voulu me protéger, et mes amis ont respecté cela. Jérém a disparu de nos conversations. J’aimerais pouvoir demander de ses nouvelles, je voudrais pouvoir montrer que je suis guéri, que j’ai fait mon deuil de cette histoire.
Mais j’ai peur de demander, j’ai peur de savoir, j’ai peur que le deuil ne soit toujours pas achevé.
Brisbane, avril 2016.
Après avoir réglé ta dette avec la justice, la nouvelle année peut enfin commencer pour toi, Jérémie. Cependant, rien ne laisse présager qu’elle sera différente de la précédente.
Car tes démons intérieurs reviennent aussitôt te titiller. Tu ne veux pas retomber dans les travers qui t’ont conduit à cette maudite bagarre, mais tu sens que tu n’es pas assez fort pour remonter la pente tout seul.
En fait, tu n’as jamais été assez fort pour être bien tout seul. Tu as toujours eu besoin de te sentir épaulé pour être bien.
Enfant, c’est Thibault qui t’a soutenu en premier. Et c’est grâce à lui que tu avais rencontré le rugby. Et, avec le rugby, c’est tout un monde qui s’ouvrait à toi, .
C’est grâce au rugby si tu avais enfin eu des potes. C’est encore grâce au rugby que tu t’étais taillé ce corps musclé qui a attiré sur toi les regards depuis ton adolescence. Et c’est toujours grâce au rugby que tu avais trouvé une passion, que tu t’étais senti à ta place pour la toute première fois de ta vie, que tu avais gagné de l’assurance, que tu t’étais senti respecté, admiré, jalousé même.
Le rugby t’avait permis d’affronter et d’apprivoiser l’un de tes démons, la peur de l’exclusion.
Mais un autre était à l’affût, et celui-ci te paraissait encore plus terrifiant que le premier.
Ce démon épouvantable était celui de tes attirances inavouables.
Et là, c’était Nico qui avait pris le relais. Nico avait su te montrer qu’il n’y avait rien de mal à aimer un garçon, et qu’être gay n’était pas une tare, et que ça ne t’ôtait pas le droit d’être heureux.
Avec Nico, tu avais appris à accepter qui tu étais, et à ne plus te détester parce que tu es gay.
Ulysse t’avait lui aussi beaucoup soutenu. Il t’avait aidé à t’intégrer dans le monde du rugby professionnel, il t’avait lui aussi donné une « recette » pour que tu puisses dépasser ta peur d’échouer, pour que tu croies en toi.
Au final, tu avais fini par trouver un certain équilibre entre ta passion et ta vie, entre le rugby et Nico. Mais tout cela avait volé en éclat le soir de tes 25 ans.
Ce soir-là, tu t’étais senti doublement vulnérable.
D’abord « physiquement ». Car, même si tu avais essayé de te défendre et de défendre Nico, tu n’avais pu faire qu’encaisser, et regarder Nico encaisser lui-aussi, les coups de ces bâtards.
Mais dès le lendemain, tu t’étais également senti vulnérable « socialement ». Il a fallu des années de « mise en scène » pour construire ton image d’hétéro socialement acceptable, des années d’efforts et d’exploits pour façonner ta carrière de rugbyman professionnel de premier plan. Et il avait suffi d’un instant pour que toute ta construction s’effondre. Tu ne t’attendais pas à ça. Et ça, ça t’avait traumatisé.
Ton image avait volé en éclats, et tu te sentais considéré comme un imposteur, un menteur, un traître.
Pendant les longs mois de convalescence, tu avais réussi à récupérer ton corps, mais pas ton mental. Ni ton aura de sportif prestigieux. L’humiliation et la honte t’avaient suivi jusque sur le terrain, lors de ton retour en équipe. Tu t’étais fait insulter. Dès lors, tu avais su que tu ne pourrais plus jamais revenir au top dans le rugby.
Tu étais si mal que tu avais même imaginé quitter le rugby pour de bon. Tu cherchais surtout à fuir l’humiliation publique d’un outing forcé. C’était vital pour toi, c’était ta façon de sortir la tête de l’eau, de ne pas te noyer.
Puis, tu avais croisé la route de Rodney. Ce qui t’avait immédiatement plu chez lui, ça avait été sa façon de s’assumer. Rodney était un rugbyman connu et respecté qui vivait sereinement son homosexualité, sans vraiment s’en cacher, sans en avoir honte, et sans que cela nuise à sa carrière. Et en plus, il était tellement charismatique ! Il était pote avec tout le monde, il était extrêmement populaire. Ça t’a paru fou, incroyable.
Nico avait été une inspiration, Rodney t’apparaissait carrément comme un modèle.
Après le traumatisme de l’agression parisienne, tu as cru que tu serais davantage en sécurité avec lui.
Martres Tolosane, fin avril 2016.
Martin m’avait annoncé son départ à l’automne dernier. Et c’est maintenant que ça se concrétise. J’ai beau m’y être préparé, lorsqu’il m’a annoncé la date précise de son déménagement en Normandie, j’ai senti un peu plus de vide gagner mon cœur. Ma relation avec Martin aura duré tout juste un an. Ce garçon n’était qu’un sex-friend, certes, mais d’une certaine façon je m’étais attaché à lui. Tout autant que nos galipettes, nos conversations vont me manquer. Sa présence va me manquer. Le regard qu’il portait sur moi me faisait me sentir attirant, son envie de remettre « ça » régulièrement me faisait me sentir désirable. Au final, sa présence contribuait à maintenir un semblant d’équilibre dans ma vie.
D’un autre côté, j’ai comme le sentiment que son départ marque également un nouvel essor pour moi. En fait, l’année 2016 commence vraiment après le départ de Martin.
Brisbane, avril 2016.
Et puis, tout a volé en éclats à nouveau, le jour où ces maudites photos avaient été publiées.
Tu te souviens de ce jour de l’été 2009 comme si c’était hier. Tu l’avais appris en même temps que Rodney, par un coup de fil reçu par ce dernier. Votre agent vous avait informés que le tabloïd était en kiosque, et que les photos circulaient sur Internet. Le mal était fait, le désastre irréversible.
Tu avais cru que le ciel te tombait sur la tête. Et tu n’arrivais pas à comprendre comment Rodney, après un court moment de surprise, puisse avoir l’air si serein. Il tentait de te rassurer, mais son calme ne faisait qu’amplifier tes angoisses. Tu étais obsédé par les conséquences désastreuses que cette affaire aurait sur ta carrière, par la honte que tout le monde sache que tu étais pédé.
Sept ans après la parution de ces maudites photos, tu ressens toujours en toi un sentiment de terrible gâchis et de profonde injustice.
Le lendemain de la publication, tu étais très mal. Tu te cassais la tête en essayant de trouver ce qu’il convenait de faire, s’il existait un moyen pour rattraper le coup. Mais tu étais sous le choc, tu paniquais, et tu étais incapable de réfléchir.
Pour toi, la désillusion a été douloureuse. Car tu venais d’en faire l’expérience, à chaque fois que tu avais eu l’impression d’être en sécurité, la vie venait violemment te rappeler que tu ne le seras jamais, nulle part.
Quelques jours plus tard, le téléphone de Rodney avait sonné à nouveau. C’était le journaliste d’une grande chaîne anglaise qui lui proposait une interview pour donner son point de vue vis-à-vis de ces photos. L’invitation était également valable pour toi, Jérémie. Toi aussi tu étais convié à t’exprimer au sujet de ces images volées.
Mais pour toi, c’était hors de question de te prêter à cet exercice périlleux. Te montrer publiquement après le tollé provoqué par ces images était au-dessus de tes forces.
Mais Rodney voyait les choses autrement. Il avait envie de régler ses comptes avec une certaine presse indigne, il voulait y aller la tête haute, assumer qui il était, et dire « merde » à ceux qui le jugeaient. Tu avais tenté de l’en dissuader. Il n’y avait pas eu moyen. Il était trop déterminé à ne pas subir.
La parution des photos avait ébranlé ton équilibre. Le choix de Rodney avait empiré ton mal-être. Tu savais que ton nom serait évoqué, alors que tout ce que tu voulais était qu’on t’oublie.
Ça n’avait pas raté, ton nom était sorti dans l’interview. Rodney avait été très correct vis-à-vis de toi, tu avais vraiment apprécié sa façon de recentrer le sujet de l’interview. D’ailleurs, au fond de toi tu savais qu’il avait fait le bon choix, et que dans son interview il avait été juste, ferme, et exemplaire. Au fond de toi, tu avais admiré son choix, sa maturité, sa force.
Et pourtant, tu n’avais pas su le lui montrer. Tu étais trop mal pour ça. Tu avais prétendu lui en vouloir du fait d’avoir encore remué cette histoire, alors qu’en réalité tu t’en voulais à toi de ne pas être aussi fort que lui.
Rodney avait assumé, et il était passé à autre chose. Alors que toi, tu avais fait un refus d’obstacle, et tu étais resté bloqué là-dessus.
Cette histoire avait mis un arrêt net et brutal à vos carrières. Les sponsors vous avaient lâchés du jour au lendemain, et la direction de l’équipe avait tout simplement annulé le renouvellement de vos contrats. Il n’y avait plus rien eu à faire, pas de recours possible.
De toute façon, tu n’aurais plus osé te pointer dans un vestiaire. Le sentiment de honte te paralysait. Tu te disais qu’où que tu ailles, tu risquerais toujours d’être harcelé et humilié.
Au final, Rodney s’en était sorti la tête haute. D’autant plus que, pour lui, l’arrêt de sa carrière au rugby ne portait pas grand préjudice. Car elle avait été écourtée d’un an ou deux au maximum.
Mais toi, toi tu ne t’en tirais pas à si bon compte. Ta carrière était loin d’être terminée, et tu avais encore de belles années devant toi. Toi t’étais passé direct de la gloire au déshonneur sans transition, et la chute avait été particulièrement brutale.
Tu avais donc fait le choix de fuir pour ne plus être exposé médiatiquement. Tu étais parti le plus loin possible de tout ça.
Rodney n’avait pas besoin de fuir, ni de s’exiler à l’autre bout de la Planète. Il était bien dans ses baskets, lui. Mais il savait que tu étais mal, et il t’avait rejoint en Australie. Il avait choisi d’être avec toi plutôt qu’avec sa famille. C’était un beau geste d’amour.
Mais tu t’étais renfermé sur ton malheur, tu étais devenu instable et agressif. En dépit de l’amour que Rodney te portait, de son soutien, de sa présence, de sa patience, ton mal-être n’avait fait que grandir et il avait très vite eu besoin d’une cible pour s’exprimer. Cette cible était toute trouvée.
Tu avais été insupportable avec Rodney, injuste, infecte. Tu lui en avais voulu sans raison valable, tu avais recommencé à boire, tu avais refusé de te reprendre en main. Tu l’avais trompé. Il t’avait pardonné. Tu avais recommencé. Les disputes étaient arrivées, de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes.
Martres Tolosane, mai 2016.
Comme chaque année, le début du mois de mai est pour moi une source de nostalgie et de mélancolie. Le deux du mois est l’anniversaire de la première révision avec Jérém dans l’appart de la rue de la Colombette. Et cette année, l’anniversaire est de ceux qu’on « fête ». 15 ans déjà !
Tout comme il y a 15 ans, ce soir le vent d’Autan souffle. Il me ramène les souvenirs de l’année 2001 et celles qui l’ont suivie, les plus heureuses de ma vie, les années où j’ai été amoureux, les années où j’ai aimé.
Dans cette période de nostalgie inconsolable, la présence de mon Galakou d’amour est particulièrement précieuse. Il y a une connexion particulière entre lui et moi, un lien qui fait qu’il est capable de sentir venir mes larmes, et d’intervenir avant même qu’elles coulent sur mes joues. Sa technique est simple. Il vient alors se blottir contre ma jambe, il relève le museau, il ouvre sa gueule en poussant des respirations appuyées, il émet un bruit qui ressemble à un bâillement mais qui n’est qu’une invitation au câlin, il cherche mon regard, il cherche le contact, il cherche un échange de tendresse.
E lorsque je croise ses yeux emplis d’amour et de tendresse, je vais déjà mieux. Je plonge mes mains dans son poil aussi doux que son regard, et je vais encore mieux. Je saisis son museau avec ma main, je caresse ses joues qui remplissent parfaitement ma paume, et je vais beaucoup mieux.
Martres Tolosane, lundi 2 mai 2016, au soir.
C’est la première fois que je ne vis pas cet anniversaire à Toulouse, que je ne me balade pas aux alentours de mon lycée, de la rue de la Colombette, du boulevard Carnot, de la Bodega, sorte de pèlerinage pour tenter de chasser ma mélancolie, tout en la cultivant. Car cette mélancolie, ce sentiment de manque, c’est tout ce qui me reste de mon histoire avec Jérém.
Mais cette année, ce pèlerinage n’aura pas lieu. C’est peut-être un pas dans la bonne direction. Peut-être qu’un jour j’arrêterai de célébrer ce curieux anniversaire.
Est-ce que Jérém y pense parfois, à ce jour de mai ? Est-ce qu’il pense parfois à moi ?
Ce soir, alors que la tristesse me happe dans mon canapé, Galaak approche avec son ballon, le fait tomber. Il me regarde fixement pendant un petit moment, tout en remuant la queue. Et puisque je ne réagis pas assez vite, il finit par s’assoir, puis s’allonger sur le ventre, tout en faisant passer sa patte par-dessus le ballon, à la fois une invitation et un défi pleins de tendresse.
Ce soir, j’ai l’occasion de faire l’une de plus belles photos de mon amour de Labrador.
Je saisis le ballon de rugby qu’il tient toujours sous la patte et je le lui lance. C’est parti, on va jouer.
Jouer avec mon chien m’apaise. Le regarder courir après son ballon m’emplit de tendresse, car sa joie totalement insouciante est contagieuse. Et ma mélancolie se dissipe.
Oui, c’est la pause Galaak. Redoutable thérapie de rugbydog.
Sidney, mai 2016.
Tu réalises que tu vas bientôt avoir 35 ans, et le bilan de ta vie est catastrophique. Tu as tout perdu de ce qui faisait ta vie d’avant.
Tu repenses sans cesse aux années magiques de ta carrière dans le rugby professionnel.
Tu repenses aux grands matches dans les grands stades, tu ne pourras jamais oublier le vertige qui t’avait cueilli la première fois que tu avais foulé la pelouse du Stade de France et que tu avais été soufflé par la ferveur, l’enthousiasme, le bruit de 80.000 supporters. Tu ne pourras jamais oublier cette vibration des supporters qui faisait trembler même la pelouse sous tes pieds et qui se transmettait à toi, jusqu’au plus profond de ton cœur. Non, tu n’oublieras jamais à quel point tu t’étais senti heureux et en phase avec toi-même, à cet instant précis !
Tu repenses aux points marqués, aux point ratés, à la tension du vestiaire avant les matches, aux frissons du terrain, aux émotions partagées après une victoire ou même après une défaite. C’était tellement grisant tout ça !
Tu repenses à ce jour mémorable où tu avais enfin soulevé le Brennus.
Tu repenses aux pays que tu avais visités, aux équipes que tu avais affrontées avec le Tournoi des Six Nations.
Tu repenses au temps où ta carrière était promise à un bel avenir que personne n’aurait pu te retirer.
Tu repenses aux amitiés nées autour du rugby, et tu repenses à ces garçons qui étaient devenus des potes inestimables, Thibault, Ulysse, Rodney et qui t’avaient, chacun à leur façon, tant apporté.
Tu repenses à d’autres rencontres, à des entraîneurs, des dirigeants, des anciens joueurs, tous ces gens qui avaient cru en toi, qui t’avaient témoigné de l’estime, des rencontres qui t’avaient marqué, aidé, rassuré, poussé à croire en toi et à te surpasser.
Tu repenses à ta vision de l’avenir à l’époque, un avenir qui te semblait tout tracé. Tu te voyais jouer au rugby jusqu’à 35 ans, c’est-à-dire à peu près l’âge que tu as aujourd’hui. Si tout s’était passé comme prévu dans ta tête, à l’heure qu’il est, tu t’apprêterais peut-être à raccrocher les crampons. Mais ton « aura professionnelle » serait telle que tu aurais l’embarras du choix face aux nombreux postes d’entraîneur ou de consultant que les clubs les plus prestigieux de la Planète, en France ou à l’étranger, t’auraient proposé.
Tu espérais jouer assez longtemps, avoir des statistiques assez impressionnantes, pour marquer durablement les esprits. Ton rêve le plus cher était qu’on se souvienne de toi comme de l’un des meilleurs joueurs de ta génération. Et même, si possible, comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.
Tu repenses à ton corps musclé en boxer sur des affiches en 3 sur 4 dans toutes les villes de France, à ta gueule dans la presse sportive et people.
Tu repenses aux nanas qui faisaient clairement la queue pour avoir ta queue. Et à certains gars qui postulaient pour la même chose, juste un peu plus discrètement.
Tu repenses à l’insouciance de ces années où l’argent coulait à flots, et où la dépense était sans compter.
Tu repenses à cette impression que tu ressentais à cette époque en te levant le matin, l’impression que ta jeunesse serait toujours là et qu’elle te protègerait de tout. C’était l’impression d’être invincible, invulnérable, immortel. C’était une illusion, mais elle était tellement convaincante, que tu avais fini par y croire.
Martres Tolosane, juin 2016.
Pour tenter de combler le manque laissé par le départ du beau Martin, je reviens sur l’application.
Pour me rendre compte que, primo, à la campagne il n’y a pas du tout le même choix qu’en ville. Au point que, certains soir, la mosaïque de l’application ressemble à s’y méprendre au shooting pour le casting des Gremlins.
Et que, secundo, je n’ai pas besoin de ça, des plans sans lendemain, des rencontres fugaces, des heures perdues à essayer d’appâter un mec qui essaie d’en appâter un autre qui lui aussi essaie d’en appâter un autre. J’avais oublié à quel point tout cela est chronophage, frustrant et terriblement dévalorisant.
Alors, je décide d’arrêter les frais. Je décide d’arrêter de gaspiller du temps et de l’estime de moi. A un moment, il faut savoir dire STOP. Il s’agit de prendre le temps de prendre un peu de recul, un peu de hauteur, d’admirer le paysage, d’attendre, de comprendre, de se comprendre, de se connaître soi-même, de comprendre ce dont nous avons vraiment besoin. Calmer le jeu est un exercice difficile, mais ça fait un bien fou.
Pour me changer les idées, je peux toujours compter sur Galaak, mon clown attitré. Il me fait rire, égaie mes journées et mes soirées de sa simple présence.
Dans mon jardin, il y a un cerisier, et ce printemps il est chargé à craquer. Un soir, alors que je suis en train de tondre la pelouse, j’entends un bruissement insistant de feuillage. Lorsque je lève mon regard, je n’en crois pas mes yeux. Galaak est posté sous le cerisier. Il est assis, le museau pointé vers le haut, tout son corps, son attention et son désir visant quelque chose de très précis. Un instant plus tard, je le vois se propulser avec ses pattes arrière, lever les pattes avant, se s'élancer en direction d’une branche, ouvrir la mâchoire au bon moment, la refermer sur une cerise, et atterrir en entraînant dans son mouvement la branche de l’arbre. Jusqu’à ce que le fruit se détache et que la branche retourne à sa position naturelle dans un mouvement brusque qui génère ce grand bruit de feuillage que j’avais entendu. Une fois atterri, il profite de sa prise, qu’il déguste lentement, avec une douceur extrême. Je découvre ainsi que mon chien, que je savais déjà gourmand de toute sorte de fruits, à l’exception des agrumes, est capable d’aller bouffer les cerises directement sur les branches basses de l’arbre. Je n’invente rien, j’ai la vidéo.
Nouvelle pause Galaak.
Le Labrador est le meilleur des anti-dépresseur et, à ce titre, ses croquettes devraient être remboursées par la Sécu.
Sidney, juin 2016.
Mais tous tes rêves avaient été brisés en un instant. En quelques instants. Il avait suffi d’une agression gratuite, de quelques ragots et de quelques photos pour que ta forteresse de bonheur et tes rêves d’éternité s’écroulent comme un château de cartes.
Quel immense gâchis, alors que tu avais vraiment tout pour réussir !
Près de sept ans après ton retrait soudain du rugby professionnel, qui se souvient encore de l’ailier Jérémie Tommasi qui a joué pendant plusieurs saisons, et marqué de très nombreux essais, dans l’une des équipes plus puissantes du Top XV ? Qui se souvient de tes sélections en équipe de France, ou de ta brillante carrière internationale en Angleterre et en Afrique du Sud ? Qui se souvient de ton nom, de ton palmarès ?
Si quelqu’un se souvient de ton nom aujourd’hui, il y a à parier que ce soit plutôt en relation avec ces sales photos que pour tes exploits sportifs. Il y a à parier que si ton nom venait à être évoqué, il serait davantage associé à des moqueries et à du mépris qu’à de l’estime et à de l’admiration.
Tu sais que ta chute a déçu énormément de monde, tous les gens qui ont cru en toi, qui t’ont poussé, encouragé, admiré, les entraîneurs, les coéquipiers, les supporters. C’est frustrant, et terriblement douloureux.
Tu imagines que ta déchéance doit régaler les gens qui ne t’aimaient pas. Et ça, c’est terriblement humiliant.
Mais le pire, c’est la déception et l’inquiétude que tu as ressenties chez les gens qui t’aiment.
Maxime, ton père, Thibault, Ulysse, Charlène. Le plus dur, ça a été de décevoir les espoirs qu’ils avaient placés en toi, en ton avenir sportif. Tu as fini par les tenir à distance. Pour ne plus les sentir s’inquiéter pour toi, pour ne pas sentir leurs déceptions tout juste voilées.
Aujourd’hui, plus rien ne te retient en Australie. Rien à part le fait d’être désormais complètement fauché. Après avoir réglé les frais médicaux et les dédommagements du type que tu as tabassé à la fête foraine, il ne te reste plus rien. Et tu es à présent obligé de cumuler les jobs pour voir venir. Tu n’as même plus de quoi t’acheter un billet d’avion pour rentrer en France.
Mais au fond, ce n’est pas plus mal. Si tu as envie de retrouver les tiens, tu n’as pas du tout envie de leur montrer ce que tu es devenu. Tu as trop honte de toi.
Non, tu ne leur demanderas pas de l’argent pour rentrer. Tu ne supporterais pas une humiliation de plus.
Orlando, Floride, 12 juin 2016.
A Orlando, en Floride, un fou furieux pénètre dans une boîte gay, le « Pulse ». Il est armé d’un fusil d’assaut et de plusieurs recharges de munitions. Il ouvre le feu et tue 49 personnes et en blesse 53 autres.
L’acte est clairement un crime homophobe.
On découvre avec sidération qu’en 2016 on peut encore se faire tuer parce qu’on est gay, et ça se passe dans la première démocratie du monde occidental.
Le monde est malade, il n’y a plus de doute.
Canberra, juillet 2016.
Rodney a quand même tenu bon plus de trois ans. Trois ans à supporter ta morosité, tes sautes d’humeur, ta colère, vos accrochages incessants, tes tromperies à répétition.
Puis, un jour de 2013, après une énième dispute, il avait fait ses bagages et était reparti en Angleterre. Tu sais qu’il l’avait fait la mort dans le cœur, car il t’aimait toujours, malgré ton comportement de con, fait et fini. Il avait essayé de t’aider à aller mieux, mais tu ne lui avais pas permis de t’aimer.
Tu t’étais rendu assez insupportable pour mettre à mal l’amour qu’il te portait. Tu avais dû être vraiment infecte pour qu’un garçon si généreux, patient et amoureux, arrive à jeter l’éponge.
Lorsque Rodney était parti, tu avais ressenti un immense vertige. Le vertige abyssal de la solitude. Mais tu t’étais également senti soulagé. Tu n’en pouvais plus de lui imposer ton mal être et de le faire souffrir. Tu aurais voulu pouvoir faire autrement, mais tu n’avais pas pu. Ta colère et un profond sentiment d’injustice te rongeaient de l’intérieur, et tu n’arrivais pas à te reprendre en main.
Toulouse, juillet 2016.
Tu enserres tes mains sur mes épaules dans une prise ferme, brutale, et tu commences à me limer avec une cadence de dingue. Tes coups de reins sont assénés avec une puissance dont je me délecte. Cet instant est exactement comme je me l’étais imaginé. Ton souffle chaud et bestial dans mon cou, ton animalité déchaînée. C’est même mieux que je me l’étais imaginé. Je ne contrôle plus rien, je t’appartiens entièrement.
C’est vraiment ce côté « animal » qui me fascine chez toi, cette attitude de bon petit macho pour qui seul son propre plaisir compte.
J’espère que la capote va tenir bon, qu’elle va supporter jusqu’au bout la sauvagerie de tes assauts.
Et puis, ça vient. Je sens tes mains se contracter encore un peu plus, tes doigts s’enfoncer davantage dans ma chair. Je ressens l’intensité des secousses de plaisir qui agitent ton corps. Malgré la musique qui retentit dans le haut-parleur placé juste au-dessus de nous, je capte les râles que tu retiens de justesse. Tu jouis dans la capote, mais grâce à mon cul. Quel honneur, tu me fais, beau mâle Kevin !
Tu te déboîtes aussitôt. Tu es pressé. J’ai perdu la notion du temps mais je pense que les dix minutes de ta pause sont passé depuis un moment.
Je me retourne. Rien dans ton attitude indique que tu envisages de me renvoyer l’ascenseur. Tu t’en fous si j’ai envie de jouir à mon tour ou pas. Tu as joui, le but est atteint. Tu enlèves ta capote et tu la jettes dans la cuvette, tu fais disparaître ta belle queue luisante de sperme dans ton boxer. Tu fais repasser ton t-shirt noir par-dessus la tête, il retombe sur ton torse comme un chat retombe sur ses pattes. Tu remontes ton jeans, tu agrafes ta ceinture. Le cliquetis que produit la boucle secouée par tes mouvements secs résonne dans mes oreilles avec une sensualité particulière.
Dans le petit espace, l’odeur de foutre s’ajoute désormais aux autres odeurs de chiotte. C’est l’émanation olfactive de ton plaisir, du plaisir d’un superbe mâle.
Je te regarde une dernière fois, et j’essaie de graver dans ma mémoire ce dernier instantané de ton intimité sexuelle. Ton brushing a été un brin malmené par le double passage de ton t-shirt, ainsi que par la vigueur de tes assauts.
La sueur a perlé sur ton front, tes lèvres entrouvertes laissent s’échapper des expirations puissantes que la musique m’empêche de capter. Ta pomme d’Adam se balade nerveusement le long de ta gorge, signe inconscient du passage récent de l’orgasme.
Pendant une seconde, tu es complètement ailleurs, perdu dans l’atterrissage de ta jouissance de mâle, complètement déconnecté du présent. Ça ne dure qu’un instant, mais c’est beau, beau à en crever.
— Salut ! tu me lances à la va vite, en défaisant le loquet. Et tu disparais, sans le moindre regard, sans le moindre égard.
Je referme la porte derrière toi. Et je me retrouve instantanément en tête à tête avec ma solitude.
Tu as vraiment été un bon coup, Kevin ! L’impétuosité presque agressive de tes gestes, l’arrogance de ton attitude de mâle qui exige son dû, tout en méprisant celui qui le lui offre – bref, ta façon d’être et de me baiser – m’ont foutrement chauffé. Sans parler de ta queue vraiment bien foutue, de tes coups de reins puissants et sauvages, de tes mains saisissant ma chair, la contraignant, me donnant l’impression que je n’avais pas d’autre choix que de satisfaire tes envies jusqu’au bout.
Et puis il y avait le contexte aussi. Ça s’est fait pendant ta courte pause, sur ton lieu de travail, dans une cabine des chiottes ouvertes au public. Sexy Kevin, tu m’as offert une baise frôlant le fantasme absolu !
La vision de ta capote qui flotte dans la cuvette fait écho au souvenir de tes va-et-vient qui pulsent encore dans ma chair, de la prise de tes mains qui entrave encore mon corps, de ta présence en moi.
Oui, tu as été un sacré bon coup. Et pourtant, désormais seul dans ce lieu où tu viens de me sauter sans ménagement, je me sens sale. Et je n’ai même pas joui ! C’est sciemment que j’y renonce, préférant quitter ce lieu sans que le vide post-coïtal vienne me foutre le cafard.
Je tire la chasse, comme pour faire disparaître la dernière trace de cette baise que je regrette déjà.
Ce qui ne m’empêche pas, en quittant cette cabine à mon tour, de sentir monter en moi une sensation de dégoût.
J’ai beau me dire que ce que je viens de faire n’a rien de répréhensible, j’ai beau me dire que prendre autant de plaisir ne peut pas être mauvais. Au fond de moi, je regrette déjà de m’être offert de cette façon.
Je ressens en moi comme un sentiment de trahison de moi-même et de mon passé, comme si je me sentais désormais indigne de ce garçon amoureux, de ce garçon aimé que j’ai été. Certes, ce garçon s’était déjà retrouvé dans des chiottes pour des bonnes baises sauvages. Mais c’était avec le mec qu’il aimait comme un fou.
Qu’est donc devenu ce garçon ?
A cet instant précis, j’ai l’impression d’avoir tué ce garçon. Ce garçon pour qui, il y a longtemps déjà, un autre garçon nommé Jérémie Tommasi était le seul but dans sa vie. Quand le cœur est privé d’amour, le corps prend le dessus et s’enfonce dans la luxure.
J’ai l’impression d’avoir un jour connu le Paradis, avant d’en tomber, et de me perdre en Enfer aujourd’hui.
Comment pourrais-je regarder en face mon beau Jérém si d’aventure le destin rendait cela possible, alors que je sais qu’en rentrant tout à l’heure, j’aurai déjà du mal à me regarder moi-même dans la glace ?
Oui, en quittant le centre commercial, j’ai l’impression de trahir la beauté de ma grande histoire avec Jérém.
Pendant toutes ces années, la machine mentale à archiver le passé a eu tout le temps de trier les souvenirs pour ne retenir que ce que j’avais besoin d’en retenir, à savoir, les moments les plus heureux.
Comme celui du jour où je l’ai vu pour la première fois dans la cour du lycée, de sa casquette et de son t-shirt noirs, ou le souvenir de notre première révision, de son t-shirt blanc, le bonheur de nos retrouvailles, de nos nuits d’amour, de nos baisers, de nos câlins, de nos confidences sur l’oreiller, de notre complicité.
Mais au fond de moi je sais qu’elle a occulté les attentes interminables, la peur de l’abandon, les angoisses, les déceptions. Et notre séparation. En fait non, je n’ai rien oublié, mais le temps a anesthésié ce qui a longtemps été douloureux.
Non, notre histoire n’était pas parfaite. Mais elle était belle, et elle était pure. Même nos erreurs, et Dieu sait que nous en avons commises, tous les deux, étaient « innocentes », sans intention de faire du mal à l’autre. Même nos baises les plus « sauvages » n’étaient en réalité que le préalable de jours heureux, une façon de nous apprivoiser.
Nous nous sommes faits du bien, et aussi beaucoup de mal. Le premier était une évidence, le deuxième rien d’autre que le fruit de nos maladresses. C’était ma première histoire, mon premier amour, et ça l’était pour lui aussi. Nous avions tout à découvrir de la vie, et de nous-mêmes.
Nous étions heureux. J’étais heureux. Avec le recul, j’ai l’impression que même quand je souffrais, j’étais heureux. Car je me sentais si vivant !
Ce samedi, je me suis rendu dans un magasin d’électroménager dans une zone commerciale de Toulouse pour m’acheter un nouveau lave-linge. Et tu étais là, beau mâle Kevin au charme sauvage, derrière le comptoir, et tu avais l’air d’un fauve en cage. Je t’ai maté, et c’est de cette façon que j’ai ouvert la porte de ta « prison ». Je t’ai fait retrouver ta liberté et ta fierté, et tu m’as fait profiter de toute sa sauvagerie. J’ai bien kiffé, mais tes griffes ont laissé quelques blessures derrière elles.
Melbourne, août 2016.
Tant que Rodney était resté à tes côtés, sa présence te tenait à flot, d’une certaine façon. Mais depuis qu’il est parti, tu te laisses complètement vivre.
Depuis trois ans, tu n’as fait que bourlinguer dans cet immense pays-continent qu’est l’Australie. Tu es comme un bateau sans moteur et sans voile, tu pars à la dérive. Tu as voyagé de ville en ville sans jamais t’arrêter, sans jamais trouver un endroit où te poser, un endroit où tu te sentirais bien.
Le fait est que tu ne t’es jamais senti bien nulle part. Car c’est au fond de toi que tu ne te sens pas bien. Il faut être en paix avec soi-même pour être bien. Dès lors, peu importe l’endroit, on sera toujours bien.
Mais tu n’es pas en paix avec toi-même.
Alors, dans ton errance de trois ans, les tentations t’ont attiré comme un vertige devant la falaise.
Tu as baisé, beaucoup trop baisé, tu as chopé quelques saloperies, mais rien qui ne se soigne pas avec des antibios ou une piqûre. Tu as eu de la chance.
Et tu as bu, tu as trouvé la bagarre. Jusqu’à celle avec le type de la fête foraine qui aurait pu gâcher toute ta vie. Heureusement pour toi, cette affaire ne s’est pas trop mal terminée. Et tu t’en es tiré somme toute à bon compte.
Et maintenant, après trois années d’errance, la vie se charge de te présenter l’addition. Plusieurs additions, même.
D’abord, une addition « physique ». Depuis quelque temps, quand tu te regardes dans un miroir, tu n’aimes plus du tout ce que tu vois. Ton corps a changé, et ce n’est pas une réussite. Tes muscles ne sont plus aussi saillants qu’avant, et tu as pris du poids.
Oui, quand tu te regardes dans ton miroir, tu sais que le processus est engagé, et que plus tu attends pour te reprendre en main, plus ce sera difficile de redresser la barre.
Le fait est que ton hygiène de vie est calamiteuse. Tu manges n’importe comment, tu bois trop, et tu ne fais plus de sport.
Certes, tu es toujours beau, tu n’as aucun problème à lever un gars quand tu en as envie.
Du moins jusqu’à ce soir où tu as croisé ce mec en boîte. C’était un beau petit blond aux cheveux bouclés, aux yeux gris magnifiques, profonds, lumineux. Et ce garçon sublime t’a mis un râteau aussi inattendu que monumental.
« Sorry, too old for me ! », il t’avait balancé au moment où tu avais essayé de l’aborder.
« Désolé, trop vieux pour moi ! ».
Des mots lancés avec la « candeur infernale » de sa jeunesse, mais blessants comme une lame de couteau dans tes oreilles.
Des mots accompagnés d’un rire à la fois si beau, si insolent et si cruel.
Des mots « mis en images » un peu plus tard dans la soirée, par contraste, lorsque tu l’avais vu repartir avec un autre superbe mec de son âge.
Certes, ce soir-là tu n’étais pas à ton avantage. Tu n’étais pas vraiment bien sapé, tu avais les cheveux et la barbe trop longs, ce qui faisait ressortir les quelques prémices de blanc qui ont depuis peu commencé à entacher la perfection de ta brunitude.
Mais son râteau t’avait salement surpris, il t’avait fichu un sacré coup au moral. D’autant plus que ce petit mec te faisait foutrement envie !
Certes, tu en as eu d’autres, depuis, de beaux garçons. Et pourtant, cet « accident » t’a marqué, et au fond de toi tu sens que tu as perdu pas mal de ton assurance. La peur du rejet te hante désormais.
Mais il y a aussi une autre addition qui se présente à toi, une addition plus d’ordre « moral ».
Là non plus, tu ne te reconnais plus. Ne rien faire de tes journées, ne pas avoir de but, ça ôte à la vie toute sa saveur. L’oisiveté ne remplace pas la passion. Les plans et les cuites ne remplacent pas l’amour. Et une vie sans passion et sans amour, c’est fade, c’est triste.
Alors, tu vis le présent. En fait, non, tu vis AU présent. Et, ce faisant, tu subis le présent, tu te laisses porter par l’instant.
Quand tu as l’esprit clair, tu en baves. Avec le recul, tu réalises que Thibault, Nico, Ulysse, Rodney, t’ont chacun aidé à leur façon. Chacun de ces garçons t’a soutenu, encouragé, préservé de toi-même. A chaque fois que tu as été entouré, tu as pu maîtriser tes démons intérieurs.
Mais leur influence n'a pas vraiment pris racine en toi. Elle a disparu dès que ces garçons sont sortis de ta vie. Dès que tu les as obligés à sortir de ta vie.
Les autres peuvent nous aider à un moment. Mais nous sommes les seuls à pouvoir affronter nos démons intérieurs et à pouvoir les vaincre.
Martres Tolosane, août 2016.
Lorsque je porte un regard sur ma vie sexuelle depuis trois ans, le bilan n’est guère reluisant.
L’application m’a pris pas mal de temps et d’énergie. Et, la plupart du temps, ne m’a rien apporté de plus que des plans sans lendemain.
Mais elle m’a aussi offert quelque surprise. Elle m’a grandement facilité la tâche pour des rencontres inattendues, comme avec Pierre, le jeune chauffagiste croisé dans un magasin de matériaux. Elle m’a offert une relation d’un an, une relation à la fois sensuelle et amicale, avec Martin, le bogoss volage.
Mais j’ai fini par me lasser de ce système de « consommation » des relations.
Lorsque j’ai banni l’application de mon téléphone, c’est la « chance » qui a pris le relais. D’abord, en mettant sur mon chemin cette bombasse de Justin, le p’tit con New-Yorkais croisé lors de mon déplacement pour aller assister au concert de Madonna au Madison. Et, tout dernièrement, la rencontre totalement improbable avec Kevin, le bel animal croisé derrière le comptoir d’un magasin d’électroménager.
Oui, j’ai eu des aventures, mais aucune relation digne de ce nom. Tous ces plans ont flatté mon corps, mais se sont avérés meurtriers pour l’esprit. Ils m’ont tous laissé un arrière-goût de plus en plus amer et persistant de solitude.
Oui, la solitude. Après ma séparation d’avec Jérém, je l’ai cherchée, car je ne me sentais pas prêt à commencer une nouvelle relation. J’avais peur de souffrir à nouveau, et j’avais surtout peur d’oublier Jérém. Je ne voulais pas l’oublier, et j’espérais toujours d’assister au miracle de son retour. Alors, j’ai fui les quelques gars qui semblaient chercher plus que du sexe.
Mais aujourd’hui, elle me pèse de plus en plus.
Melbourne, août 2016.
Tu le revois en train de te sucer, tu te souviens de la sensation de ses lèvres autour de ta queue, de sa langue s’affairant sur ton gland. Tu te souviens du plaisir qui monte, parfois doucement, parfois très vite. Tu te revois sur le point de perdre pied, puis en train de jouir dans sa bouche, tu le revois en train d’avaler avidement ton jus.
Tu te revois en train de le pilonner, tu te rappelles la sensation de ta queue qui glisse, qui va et qui vient dans son trou chaud, tu le revois en train de prendre son pied au rythme de tes coups de reins, bien soumis à ta virilité, tu repenses à la montée progressive de ton orgasme, et au plaisir inouï de lui gicler dans le cul.
Tu te souviens de l’odeur de sa peau, de cette bouche, de ce cul, qui étaient toujours prêts à accueillir ta queue et tes envies. Tu te rappelles son regard, son désir qui décuplait le tien, qui flattait ton égo, qui te rassurait, qui te donnait des ailes.
Tu te rappelles comment tu te sentais exulter, corps et esprit, grâce à lui.
Et dans ce lit inconfortable, tu jouis. Tu jouis entre les fesses d’un inconnu que tu as levé dans un lieu de drague, un inconnu dont tu n’as même pas retenu le prénom, et dont tu auras oublié le visage demain.
Et lorsque l’excitation retombe, sa présence t’est instantanément insupportable. Tu es soulagé de le voir se rhabiller et partir dans la foulée. Mais son départ rapide te laisse seul avec tes démons.
Seul dans ta chambre d’hôtel, la misère de ton présent réapparaît aussitôt. Et la nostalgie te happe. Tu te souviens de ses bras, de ses baisers, de ses mots, de ses regards doux qui étaient toujours là après ton orgasme pour accueillir tes angoisses, pour apaiser tes démons.
C’était bien, avec Nico, c’était le bon temps. Et tu te mets à rêvasser au bonheur du passé pour tenter d’oublier la misère du présent.
Tu repenses à ce jour où il t’avait proposé de réviser les maths pour le bac. Tu repenses à toute cette période, à ces baises dans ton premier appartement, à son attirance presque palpable pour toi, pour ton corps, ta gueule, ta queue, à son dévouement pour ton plaisir. Mais tu te souviens aussi de son besoin de tendresse que tu lui avais longtemps refusé, alors que tu en avais autant envie que lui. Tu te souviens de comment son regard t’avait aidé à accepter qui tu étais et à cesser d’en avoir honte.
Tu repenses souvent aussi à ce jour pluvieux, à cette attente sous la Halle de Campan, une attente qui t’avait parue interminable. Et puis tu te repasses en boucle l’instant où tu l’avais entendu approcher, où tu t’étais retourné et que tu l’avais vu, l’instant où vous vous étiez serrés dans les bras l’un de l’autre, où vous vous étiez embrassés, avec le même désir, la même fougue, le même amour.
Tu repenses aussi à cet autre souvenir, sur la butte devant la cascade de Gavarnie, tu le tenais dans tes bras, sa nuque attirait tes baisers et une infinie tendresse. Tu avais une nouvelle à lui annoncer, celle de ton départ à Paris, et ça ne sortait pas. Car tu ne voulais pas lui faire de la peine, tu ne voulais pas gâcher cet instant de bonheur parfait.
Tu repenses à ce voyage Italie, à votre complicité, à la douceur de ses baisers, de ses caresses, de sa présence.
Nico a toujours été là quand tu as eu besoin de lui.
Tu repenses à l’accident de voiture à Paris, lorsqu’il n’avait pas hésité à raconter à la Police qu’il était au volant, alors que c’était toi. Il l’avait fait pour te sauver le cul, parce que tu avais bu et que tu n’aurais pas dû prendre le volant.
Ou à cette longue période de rééducation après ton accident de rugby, à sa présence sans faille, à Paris, à Capbreton, sans hésiter un seul instant à mettre ses études entre parenthèses pour être à tes côtés et supporter tes sauts d’humeur et ton ingratitude.
Nico t’a même offert l’occasion de renouer avec ta mère avec qui tu étais fâché depuis ton adolescence, depuis qu’elle avait refait sa vie.
Et tu repenses au soir de tes 25 ans, quand tu lui as fait l’amour dans le sous-sol de l’immeuble où habitait Ulysse. C’était votre dernier moment heureux.
Au fond de toi, tu sais que tu ne seras plus jamais aussi heureux que pendant ces quelques années que tu as partagées avec lui.
Dans un train, début septembre 2016.
Dans un train que j’ai emprunté pour un déplacement professionnel, j’ai croisé deux petits mecs qui m’ont beaucoup ému. Deux choupinous tout juste majeurs, ou peut-être même pas majeurs, débordant de jeunesse et de beauté. Et rayonnants de tendresse mutuelle. Ils se tenaient dans l’espace entre deux wagons, appuyés à une barre verticale. J’ai remarqué les doigts qui se frôlaient et qui semblaient faire des étincelles dans le contact réciproque. J’ai remarqué les regards qui se cherchaient, se caressaient, les petits sourires timides et un peu gênés qui s’entrechoquaient. J’ai remarqué l’alchimie des corps qui s’attirent, des esprits qui s’aimantent.
J’ai ressenti d’infinis frissons en regardant ces deux garçons. Je me suis demandé qui ils étaient, comment ils s’étaient connus, quand ils s’étaient aperçus qu'ils se plaisaient, ce qu’ils ressentaient exactement l’un pour l’autre. J’aurais voulu connaître le bonheur qu'ils ont éprouvé la première fois que leurs désirs se sont croisés, rencontrés, reconnus.
Je me suis demandé à quel point ils devaient bien, tous les deux, enfermés dans leur bulle, seuls au monde, isolés de toute la laideur de l’existence.
Et je me suis dit que j’aimerais tellement retrouver un amour si intense et si passionné que le leur. L’amour le plus beau, le plus fou, le plus insouciant, celui qui déplace des montagnes. Le premier amour.
Si seulement je savais chercher aujourd’hui un garçon qui ait envie de faire un petit bout de chemin avec moi !
Mes amis, Thibault et Stéphane ont eu de la chance, et je suis heureux pour eux. Alors, pourquoi pas moi ? Peut-être que ma chance viendra un jour où je ne l’attendrai plus.
Adélaïde, 15 septembre 2016.
Aujourd’hui, Nico a 34 ans. Tu te demandes ce qu’il fait, avec qui il est, ce qu’il devient.
Ça fait un moment que tu n’as pas eu de ses nouvelles. Tu en as pris, pendant longtemps, auprès de vos amis communs. Et tous les récits te parlaient d’un Nico toujours seul, qui ne t’avait donc pas « remplacé » après votre séparation. Dans un premier temps, cela avait en quelque sorte flatté ton ego.
Mais très vite, cet état de choses t’avait profondément attristé.
Car tu avais appris également que Nico se posait tout un tas de questions sur ce qui t’avait conduit à partir jouer en Angleterre à la rentrée 2007, alors que quelques jours plus tôt tu lui avais assuré vouloir renoncer au rugby et rester en France, parce que tu voulais donner une chance à « Ourson et P’tit Loup ».
Là encore, son dévouement avait été au rendez-vous. Il avait su de suite que cette décision te rendrait malheureux. Alors, il avait ouvert la porte et il t’avait laissé libre de prendre ton envol vers le ciel d’Angleterre, un ciel que tu imaginais plus dégagé pour ton avenir sportif que celui de France. C’était une preuve d’amour, une ultime preuve d’amour, dont tout le monde n’aurait pas été capable.
Et comment l’avais-tu remercié pour cette abnégation, pour avoir fait passer ton bonheur avant le sien ?
Tu avais fait le choix de partir sans même le lui annoncer, en estimant qu’il valait mieux le silence que des explications difficiles et douloureuses. C’était la voie de la facilité, car tu n’as jamais été doué pour gérer la souffrance des autres, notamment lorsque tu en étais la cause.
Alors, tu es parti comme un voleur, l’obligeant à monter à Londres pour découvrir que tu étais avec un autre. Tu sais que tu as été lâche. Il ne méritait pas ça, lui qui a toujours été là pour toi, quitte à prendre des risques, à se mettre en danger, à mettre sa vie au second plan. Et à se rendre malheureux pour que tu puisses être heureux.
Tu t’en veux de lui avoir imposé ça, tu t’en veux chaque jour. Tu sais que pour aller de l’avant, Nico aurait besoin de réponses à ses questions, et que le seul à pouvoir lui apporter tout cela, le seul à pouvoir lui apporter les explications capables de le libérer du poids du passé l’empêchant de marcher vers l’avenir c’est toi, Jérémie.
Après toutes ces années, tu n’es plus du tout sûr d’avoir fait le bon choix à l’époque. Mais à présent, tu te dis qu’il est trop tard pour revenir en arrière. Tu n’oseras plus jamais revenir en arrière. Tu lui as fait bien trop souvent le coup de disparaître et de revenir. Tu te dis que tu as perdu toute crédibilité, toute confiance. Il doit t’en vouloir, et à juste titre.
En fait, tu n’en sais rien. C’est depuis ton voyage en France en 2013 que tu n’as plus cherché à avoir de ses nouvelles. Tu as essayé de l’oublier, tu as essayé d’oublier tes regrets et tes remords.
Peut-être que Nico a réussi, lui, à t’oublier.
De toute façon, tu n’as même plus les moyens d’aller le retrouver, même si tu trouvais le courage d’affronter son regard et ta culpabilité. Tu es bloqué sur ce continent à l’autre bout de la Planète.
Alors, Nico est désormais, et il le restera pour toujours, le plus grand regret de ta vie. Tu sais que tu l’as rendu malheureux, et qu’en le rendant malheureux, tu t’es rendu toi-même malheureux.
Car, au fond de toi, tu le sais. Le jour où tu as choisi le rugby plutôt que son amour, tu as fait la plus grosse erreur de ta vie.
Tu te demandes s’il pourra te pardonner un jour d’avoir été si injuste, si ingrat, si lâche avec lui.
Et tu espères seulement qu’il a trouvé le chemin pour être à nouveau heureux.
Martres Tolosane, 16 octobre 2016.
Galaak sait toujours quand je suis triste et nostalgique. Il le ressent dans son grand cœur de Labrador. Et avec son fabuleux instinct de Labrador, il a toujours la recette pour me faire aller mieux.
Ce soir, alors qu’une fois de plus la tristesse me happe brutalement, il se saisit de son ballon et me l’apporte pour une séance de jeu. J’accepte son invitation, je l’attrape, je le lance, il part le récupérer en bondissant. Lorsqu’il le saisit entre ses crocs, la modulation de pression de sa mâchoire a pour effet de produire un son qui change en permanence d’intensité et de hauteur. Un son qui semblerait presque exprimer des émotions, son impatience, son excitation, son plaisir de jouer et de partager ce moment avec moi, et de me voir sourire et aller mieux par la même occasion. Ces couinements répétés et d’intensité changeante ce sont en quelque sorte « la voix de Galaak ».
Aujourd’hui, Jérém a 35 ans. Je n’ai jamais oublié l’un de ses anniversaires. Car je n’ai jamais cessé de penser à ce garçon dont le visage est le visage de la période la plus heureuse de ma vie.
Où es-tu mon Jérém ? Que fais-tu ? Es-tu heureux ? Penses-tu, parfois, à moi ?
Washington, novembre 2016.
Après deux mandats de présidence assurée par un homme d’origine afro-américaine, une première et un exploit dans un pays où la ségrégation n’a été abolie que 50 ans plus tôt, le vent politique tourne du tout au tout aux Etats-Unis. Cette année, où un homme à la chevelure couleur de la paille est élu à la Maison Blanche.
La désillusion et l’inquiétude dans une grande partie du pays et du monde entier sont palpables.
L’histoire est un éternellement recommencement. La marche du monde ressemble parfois à un pas de crabe. Un pas en avant, et deux en arrière.
Toulouse, jour de Noël 2016.
Comme chaque année, je fête le réveillon de Noël avec mes parents. Je passe un bon moment. Tout en me remémorant le réveillon d’il y a quelques années, lorsque Jérém était venu me chercher après une période d’éloignement, et nous offrir un nouveau chapitre à notre histoire.
Le lendemain, le jour de Noël, une triste nouvelle paraît dans la presse. George Michael est retrouvé sans vie dans sa voiture garée dans une rue à proximité de sa demeure.
L’un des fantasmes sexuels majeurs de mon adolescence n’est plus. Et bien que les coups durs de la vie l’aient précipité depuis pas mal de temps déjà dans toute sorte d’excès, et que ces excès aient eu prématurément raison de sa beauté et de sa jeunesse, il restera à tout jamais à mes yeux le bogoss de « Faith » et de « Kissing a fool ».
Un immense musicien, un auteur sublime, un interprète superbe.
Mais aussi le sublime petit con de « Wham ! », exhibant sa jeunesse et sa demi-nudité avec une insolence frôlant le chef d’œuvre absolu. En fait, c’est surtout sa joie de vivre que le temps lui a ôté prématurément.
Adieu, George. Et que tes retrouvailles là-haut avec ton Anselmo soient belles, et chaudes. Et qu’il te reprenne à nouveau par la main comme il t’a pris ce jour où il a foudroyé ton cœur en assistant à l’un de tes concerts. Qu’il te prenne par la main comme on aurait tous besoin de l’être pris un jour, comme « Jésus avec un enfant ».
Cette année a été une bien triste année pour les stars de mon adolescence.
Prince a lui aussi tiré sa révérence en avril, lui aussi emporté par le fléau de la crise des opioïdes qui a avait déjà emporté Michael Jackson sept ans plus tôt. Un scandale sanitaire dont les Etats-Unis commencent tout juste à saisir l’ampleur, après des années d’un laisser faire criminel des autorités au profit d’intérêts privés sans scrupules.
Whitney Houston étant elle aussi disparue il y a quatre ans – quelle voix, quel immense gâchis ! –
De mes repères musicaux des années ’80, il ne reste plus que Madonna.
Longue vie à elle, mon principal et dernier repère !
A propos de Madonna, en cette maudite année 2016, on a également déploré la disparition de celui qui l’a tant inspirée au début de sa carrière. En janvier, David Bowie est parti rejoindre ces étoiles dans cet Espace qu’il a si souvent évoqué dans ses chansons.
Dans une ferme en Nouvelle Galles du Sud, décembre 2016.
Depuis un mois, tu as atterri dans cette grande ferme avec la bagatelle de 10.000 brebis à tondre. La tâche était immense et vous étiez nombreux à vous y atteler. Tu as commencé comme attrapeur, puis tu es passé tondeur. Pendant des semaines, ce travail fortement physique t’a épuisé, t’a empêché de trop réfléchir et broyer du noir.
Tu as aussi fait de belles rencontres, avec des gens un brin « hippies post-modernes », des gens gravitant autour d’une philosophie de vie basée sur le lâcher prise et le détachement des biens matériels. Une mentalité qui t’a beaucoup touché. Et pour la première fois depuis ton arrivée en catastrophe en Australie, tu as eu l’impression d’aller mieux. De te sentir utile, valorisé, intégré dans un « monde ».
Dans cette ferme du bout du monde, tu as l’impression d’avoir trouvé des potes, presque une nouvelle famille. Après les longues journées de tonte, le soir, autour du feu, on parlait, on s’écoutait. A tour de rôle, tes collègues racontaient leurs vies, leurs déboires, leurs regrets et leurs remords. Tu as senti une ambiance écoute et d’empathie, sans jugement aucun. Il faut dire que le joint aide bien à délier les langues et à suspendre les jugements.
Et tu as fini par te sentir à l’aise pour parler des bêtises que tu as faites depuis quelques années, de tes errances. Tu as trouvé de l’écoute, tu t’es senti compris et épaulé. Et ça t’a fait un bien fou de vider ton sac. Tu n’as pas pu arriver à la fin de ton récit sans que les larmes viennent brouiller un peu plus ton accent déjà rude à entendre.
Oui, tu as pleuré. Et tu t’es senti soulagé. Pour la première fois depuis des années, tu as senti ton cœur se délester d’un poids. Pour la première fois depuis des années, tu te dis que, malgré tout ce que tu as perdu et que tu ne retrouveras pas, l’avenir peut t’offrir des jours meilleurs.
Toulouse, 31 décembre 2016, 23h59.
Dans une minute à peine, une nouvelle année s’achève et une nouvelle commence.
Tout le monde semble s’agiter autour de cette échéance, comme si elle allait marquer une véritable démarcation entre un « avant » et un « après ». En réalité, même si dans une minute on aura changé d’année, demain ce sera juste la suite d’aujourd’hui. Demain, rien n’aura changé. Ma solitude demeurera intacte, tout comme la nostalgie des années que j’ai passées avec Jérém.
Et pendant que le compte à rebours retentit, mes pensées s’envolent à l’autre bout de la Planète.
Dans une ferme en Nouvelle Galles du Sud, 31 décembre 2016, 23h59.
Ton réveillon de la nouvelle année, tu le fêtes avec eux, autour d’un grand feu. Ça boit, ça rigole, ça fume de joints, ça chante. Tu es entouré, et tu passes une bonne soirée. Mais ta solitude, tu la portes toujours dans ton cœur. Tout comme la nostalgie des années que tu as passées avec Nico.
Et pendant que le compte à rebours retentit, tes pensées s’envolent à l’autre bout de la Planète.
 4 commentaires
4 commentaires
-
Par fab75du31 le 19 Août 2023 à 18:39
Décembre 2007.
Les fêtes de fin d’année arrivent, elles passent et se terminent sans un signe de la part de Jérém, même pas un message pour la bonne année. S’il ne le fait pas, je ne le ferai pas non plus. Ce n’est pas de la mesquinerie. S’il a tourné la page, autant que je l’accepte et que j’en fasse de même. Il me semble qu’il serait pathétique de quémander son attention, et de recevoir en retour des bribes de politesse, en lieu et place des étincelles et de la tendresse qu’il y a eu entre nous auparavant. Pire que tout, ce serait de recevoir au contraire son silence, son indifférence. Je ne le supporterais pas. En fait, je me protège, comme je peux.
Lors d’une nuit d’insomnie, d’angoisse et de larmes, celle du réveillon de Noël, j’ai effacé son numéro anglais, numéro que je n’ai pas eu le temps d’apprendre par cœur comme le premier. Donc, même en voulant, je ne pourrais pas lui envoyer de vœux.
Et pourtant, parfois, l’envie, violente, me prend d’appeler Maxime pour lui redemander ce numéro, de lui envoyer des vœux et guetter sa réaction. Mais à chaque fois j’y renonce. Au fond de moi, je crois que j’ai fait le bon choix. Le fait de ne plus avoir son numéro est un premier pas, un petit pas, mais un pas certain, dans la direction de passer à autre chose.
S’il veut m’envoyer des messages, il sait comment me joindre. A moins que lui aussi ait effacé mon numéro.
Mais, au fond de moi, je préfère qu’il me fiche la paix. Un message de sa part, ce serait comme retourner un couteau dans une plaie. La plaie est là, béante, saignante, et elle a besoin de temps et de calme pour cicatriser.
Pourtant, encore plus au fond de moi, j’aimerais tellement recevoir un SMS de sa part ! Seul un message venant de lui pourrait venir à bout de ma tristesse, de mon désarroi. Mais pour ce faire, il faudrait que ce soit un message capable de restaurer d’un seul coup le règne d’Ourson et P’tit Loup.
Mais je sais que cela est impossible.
Lors de mes nombreuses autres nuits d’insomnie, je laisse la radio en fond sonore pour me tenir compagnie, pour tromper ma solitude et ma tristesse. Je suis tellement mal que j’ai envie de rien, même pas d’écouter de la musique, elle qui a été mon premier amour, au début de mon adolescence, lorsque l’amour pour les garçons me semblait hors de ma portée.
Aujourd’hui, même Madonna n’arrive pas à m’extirper de ma morosité. Alors, je laisse aux programmateurs musicaux d’une fréquence qui ne passe que de la bonne musique millésimée le choix des morceaux que je vais écouter. Et une nuit, une voix, une mélodie, un texte m’arrachent le cœur.I remember when (…)/Je me souviens quand…
Et soudain le souvenir d’un jour déjà lointain remonte instantanément. Un jour de bonheur, le jour de mes vingt ans. Jérém qui débarque à Bordeaux par surprise, avec la belle voiture que lui avait prêtée Ulysse. C’était la première fois qu’il venait à Bordeaux, il m’avait amené au resto, et puis nous étions rentrés à l’appart en lisière de la cour au sol rouge, et nous avions fait l’amour. J’étais si heureux cette nuit-là !
Hélas, ce bonheur a pris fin.
Then one day you came/Puis un jour tu es venu
You told me you were leaving/Tu m'as dit que tu partais (…)
And made me cry again/Et tu m'as fait pleurer à nouveau
When you said/Quand tu as dit (…)
Please don't wait for me/S'il te plait ne m'attends pas (…)
And I'm still waiting/Et j'attends toujours (…)
Ooh, I'm a fool/Oh, je suis un imbécile
To keep waiting/Pour continuer à attendre
Jérém m’a dit de ne pas l’attendre. Et, pourtant, je l’attends. Malgré le fait qu’il ait donné son amour à un autre, malgré ces jours, ces semaines, ces mois de souffrance que cela m’inflige. Je sais que s’il débarquait à l’improviste, s’il venait me chercher, ma porte serait grande ouverte, et je l’accueillerais les bras pleins d’amour et je lui pardonnerais tout, tout, tout.
Ooh, I'm a fool/Oh, je suis un imbécile
To keep waiting/Pour continuer à attendre (…)
And I'm still waiting/Et j'attends toujours
2007 se termine. Je crois que ça a été la pire année de ma vie.
L’année 2008.
La nouvelle année commence de la même façon que s’est terminée l’ancienne, c’est à dire dans une infinie tristesse, ma tête et mon cœur pris dans un incessant et déchirant tourbillon de sentiments d’inachevé, de gâchis, et d’injustice. Au fond, je n’en veux pas à Jérém d’être tombé amoureux d’un autre gars. Je ne peux pas lui en vouloir. L’amour, ça ne se commande pas.
Et pourtant, je ne cesse de me demander pourquoi cela s’est produit, et si vite. Certes, après ce qui nous était arrivé à Paris le jour de ses vingt-cinq ans, il avait besoin de changer d’air pour pouvoir reprendre sa carrière sportive sereinement. C’est même moi qui l’ai poussé à y aller, à ne pas écouter ses réticences. Je me souviens de sa question quand je lui ai dit de ne pas rester pour moi.
« Et nous ? ».
C’est bien qu’à ce moment-là, il y avait encore un « Nous », un « Ourson et P’tit Loup ». Et trois mois plus tard, ce n’était déjà plus le cas. Le rapprochement avec Rodney s’est fait très vite après son arrivée à Londres. Lors de son retour d’Australie, il y avait encore ce « Nous ». Mais était-ce vraiment le cas ? Sa réticence à partir, à rester pour « Nous », n’était-ce pas juste la peur de me faire souffrir en me quittant ? Est-ce que l’éloignement n’avait pas commencé en Australie ? Ou encore bien avant ?
Janvier 2008/1.
La rentrée arrive, le travail reprend. Je dois me faire violence pour me lever, pour me doucher, m’habiller, prendre ma voiture, affronter les bouchons, pour aller au bureau, dire bonjour à mes collègues, traiter mes dossiers. Je vais au bureau chaque matin, mais je suis ailleurs. Partout où je vais, je porte ma tristesse avec moi. Le manque, l’absence sont insupportables.
Dans ma chambre, le soir, dans le noir, j’ai envie de lui. Je crève d’envie de lui. Si je ferme les yeux et me concentre sur la branlette, j’ai encore l’impression de sentir son parfum, la chaleur de sa peau, le poids de son corps, la solidité de son torse, la présence de sa queue dans ma bouche, entre mes fesses, la puissance de ses coups de reins. Sa façon de chercher son pied, les râles contenus de son orgasme, la puissance, la chaleur humide, l’odeur, le goût de ses giclées.
Je le revois en train de me baiser, dans son plus simple appareil, tous pecs et abdos et biceps et tatouages et chaînette de mec dehors, torse nu, poils noirs virils et insolents ou rasés, ou bien enveloppé d’un t-shirt blanc tellement ajusté à sa plastique qu’il en devenait presque une deuxième peau.
Je me souviens de sa façon de porter le t-shirt ou le débardeur blanc, la couleur immaculée mettant tellement en valeur sa plastique de fou, la nuance mate de sa peau, m’inspirant à chaque regard la double furieuse envie de les lui arracher pour voir ses tétons, ses poils, ses pecs, ses abdos, et celle qu’il les garde, tant le blanc lui allait bien, tant le tissu était ajusté à son torse, à ses épaules, à l’arrondi de son cou, et se définissait presque comme une deuxième peau, douce, tiède, bandante.
Nous avons baisé dans cette chambre, sur ce lit, juste après le bac, pendant ses pauses de l’après-midi lorsqu’il travaillait à la brasserie à Esquirol. Il m’a giclé dans la bouche, il m’a sommé d’avaler, il m’a baisé, une, deux, trois fois par après-midi, en espaçant ses assauts le temps d’une courte cigarette. J’ai tout encaissé, jusqu’au dernier coup de reins, jusqu’à la dernière secousse de son orgasme, jusqu’à la dernière giclée, jusqu’à la dernière trace de son nectar de jeune mâle. Son plaisir était le mien.
Dans cette chambre, nous avons également fait l’amour, c’était juste après la catastrophe qui avait frappé Toulouse le premier jour de l’automne de l’année 2001. Et nous l’avons fait d’autres fois, par la suite, lorsqu’il était reçu dans cette maison comme le beau-fils bien aimé.
Imaginer Jérém en train de coucher avec Rodney m’arrache les tripes. Mais, il faut bien l’avouer, pendant que mon orgasme approche sous l’effet des va-et-vient de ma main, c’est aussi furieusement excitant. Je donnerais cher juste pour le regarder prendre son pied et jouir, même si c’est avec Rodney.
Pendant l’ascension vers le plaisir, sous l’effet de l’excitation, les fantasmes masquent la souffrance.
Mais après l’orgasme, tout change instantanément. L’excitation retombée, mon mal-être revient aussitôt.
Et l’imaginer prendre son pied avec un autre, faire profiter un autre de son corps et de sa virilité, idée qui m’avait bien chauffé une seconde plus tôt, m’est à nouveau insupportable.
Et ce qui est insupportable aussi, c’est de me poser mille questions sur ce qui se passe dans ce lit de Londres. Jérém est un garçon actif. Il a parfois voulu essayer de recevoir la virilité d’un autre garçon, j’ai été le premier à qui il s’est donné. Il s’est donné parfois à Thibault, lors de nos plans de fin de championnat, et une ou deux fois lors de nos plans à trois occasionnels.
Et avec Rodney, ce garçon bien viril ? Qui tient le rôle de l’actif et qui celui du passif ?
Janvier 2008/2.
Depuis la rentrée, ma vie se résume à peu de choses. Je vais au taf, je rentre à la maison. J’évite de traîner sur le trajet. Je sors le moins possible.
Toulouse est ma ville, et je l’aime de tout mon cœur. Mais elle est aussi le théâtre de mes premiers émois avec Jérém, un théâtre désormais vide, horriblement vide. Et ce théâtre fantôme contribue à alimenter mon désarroi et ma mélancolie. Je n’ai envie de rien. Même pas d’aller boire un verre avec Thibault, pourtant si gentiment proposé.
Pour mon ami Julien, qui prend régulièrement de mes nouvelles, la recette pour tourner la page et cesser de souffrir qu’il m’a exposée un soir au téléphone paraît simple : baise, nique, jouis jusqu’à que la queue t’en tombe, fais toi plaisir !
Mais franchement, ça ne me dit rien. Je n’ai pas envie de ça, ni de sortir, ni de faire des rencontres, ni de baiser.
En dehors du travail, j’ai envie de me glisser sous la couette et de chialer.
Et accessoirement de regarder des matches de rugby anglais.
On tient là un bel exemple de l’incohérence de ma nature et de mon manque de mental. J’essaie d’oublier Jérém depuis des mois et puis, un samedi après-midi, je craque. Je m’installe avec Papa devant la télé pour regarder le beau brun jouer avec Rodney.
Je sais que je me fais du mal, mais j’ai besoin de le voir. C’est plus fort que moi.
Son apparition à l’écran m’arrache les tripes. Et pourtant, je reste devant l’écran. Maintenant que j’ai commencé à regarder, maintenant que je sais qu’il est en train de jouer, je ne peux pas partir. J’ai besoin de veiller sur lui, de m’assurer qu’il arrive à la fin du match sans se blesser.
Vers la fin de la première mi-temps, alors que Jérém vient de marquer un magnifique essai, Papa me questionne.
— Tu ne m’as jamais raconté comment s’est passé ton voyage à Londres…
C’est vrai qu’à mon retour à Toulouse, je n’avais pas du tout envie de parler de ça. J’ai juste dit que c’était fini entre Jérém et moi, et que je n’avais pas envie d’épiloguer. Mon souhait a été respecté. Mais je sais que mes parents se posent des questions, et je crois que je suis enfin prêt à y répondre.
— Il est amoureux d’un autre…
— C’est vrai ?
— Oui, Papa. Il est tombé amoureux de Rodney Williams…
— Son coéquipier ?
— C’est ça…
— Mais lui aussi il est…
— Il faut croire… ils habitent ensemble !
— Si vite ?
— Apparemment, ça a été le coup de foudre.
— Mais ils ne craignent pas de se faire repérer ?
— Officiellement, ils sont colocataires.
— Et tu le connais, ce Rodney Williams ?
— J’ai dormi une nuit chez eux.
— Ça n’a pas dû être facile.
— Non, pas vraiment. Et le pire, c’est que Rodney est un gars très sympa, et je n’arrive même pas lui en vouloir !
— Comment tu te sens ?
— Très mal.
— Tu devrais sortir, essayer de voir du monde.
— Ça ne me dit rien.
— Ce n’est pas en restant enfermé que tu vas rencontrer le gars qui va te faire oublier Jérémie.
— Je pense que ce gars n’est pas encore né.
— Moi je crois que si. Il faut juste que tu ailles à sa rencontre. Tu es un beau garçon et tu es intelligent. Tu trouveras quelqu’un qui saura te rendre heureux.
— J’ai du mal à le croire.
— Se faire quitter pour un autre, c’est dur, car ça oblige à se remettre en question. Mais ne laisse pas le bonheur passé t’empêcher d’en vivre d’autres.
— Est-ce qu’il en existe seulement « d’autres », après avoir été si heureux que je l’ai été ?
— Un nouveau bonheur viendra quand tu seras prêt à le recevoir.
Les mots de Papa me font chaud au cœur, ils me ramènent une nouvelle fois aux couplets de la chanson de Diana Ross.
Wait patiently for love/Attends patiemment l'amour
Someday it will surely come/Un jour ça viendra sûrement (…)
Mais quand on pleure l’amour perdu, on n’attend que le retour de celui dont l’absence est insupportable.
Le match est la chronique d’une belle victoire des Wasps. Jérém est de plus en plus à l’aise, et cet après-midi il marque pas moins de trois essais. Le petit Français se fait remarquer Outre-Manche. Je suis heureux pour lui, même si le fait de le voir sur un écran et de le savoir désormais inaccessible me fend le cœur. Lorsque la caméra capte sa belle gueule en premier plan, j’ai envie de pleurer, mon cœur a des ratés, ma gorge se serre, j’étouffe.
Son grain de beauté dans le creux du cou, sa peau mate, sa transpiration, ses tatouages, son brushing, sa belle petite gueule de jeune mâle, tout crie au sexe chez lui. Mais ce qui me manque le plus, c’est de le serrer dans mes bras, et de me sentir enserré dans ses bras musclés. Comme il me manque le bonheur qu’il savait m’apporter !
Dans un autre plan de caméra, voilà Rodney, le beau garçon qui a pris ma place dans le cœur et dans la vie de Jérém. Son regard est tellement clair, son sourire tellement lumineux et chaleureux. Je comprends tout à fait pourquoi Jérém est tombé amoureux de lui. Et ça me donne terriblement envie de chialer.
Après le coup de sifflet final, les Wasps témoignent leur liesse en faisant tomber les maillots. Jérém tombe le sien. Son torse dévoilé est une claque inouïe, une sculpture grecque aux proportions et aux reliefs parfaits, le tout parsemé de délicieux petits poils qui recommencent tout juste à repousser. Ça faisait longtemps qu’il ne les avait pas coupés, ils ne l’étaient pas la dernière fois où il m’a fait l’amour en août dernier, il les a donc coupés depuis. Pourquoi ? Pour faire plaisir à Rodney ? Pour être comme Rodney ? Rodney qui arbore, lui aussi, un torse spectaculaire, avec des tétons à donner le tournis, un torse complètement imberbe.
Les joueurs se félicitent entre eux, et je n’ai pas à attendre longtemps pour assister à une accolade virile entre Jérém et Rodney. Les pecs se pressent les uns contre les autres, les mains se glissent dans le dos de l’autre, un contact viril et sensuel, torse nu contre torse nu, comme pendant l’amour. Le désir est toujours là, toujours aussi évident, aussi brûlant, toujours aussi violent. Ça crève les yeux, en tout cas les miens, qui connaissent ce qu’il y a entre ces deux beaux garçons.
Une fois de plus, j’essaie de me dire que je devrais être heureux qu’il soit heureux, même sans moi. Mais c’est au-dessus de mes forces.
Au fond de moi, je ne sais pas si j’ai envie d’aller de l’avant, je ne sais pas si j’ai envie d’arrêter d’attendre Jérém.
Printemps (mars) 2008.
J’ai toujours trouvé que Toulouse est une très belle ville, de par son architecture, ses espaces verts, ses couleurs, sa gastronomie, son terroir, sa faune masculine. Et je trouve qu’au printemps, au moment où tout le vivant bourgeonne et frémit, elle est encore plus engageante. Mais cette année, lorsque le beau temps revient, et que les jours s’allongent, c’est à ce moment-là que ma tristesse devient encore plus dure à porter.
Le vent d’Autan se lève, et ses rafales charrient de vieux souvenirs. Des souvenirs emplis de nostalgie, des souvenirs de Paradis Perdu.
Je repense à tous ces moments passés avec Jérém, au lycée, dans l’appart de la rue de la Colombette, puis à Campan, à Paris, à Bordeaux, en Islande, au Québec, en Italie, au Pays Basque. Je repense au soir où nous nous sommes baladés à Montmartre, à cette journée où nous sommes allés voir un glacier aux couleurs féeriques se déliter dans la mer à Jökulsárlón, à cet autre où nous nous sommes baladés dans les rues moyenâgeuses d’Arezzo, au jour où nous nous sommes promenés à la Chaussée des Géants en Irlande du Nord. Je repense aux jours heureux de notre amour.
J’aurais tellement aimé continuer à visiter le monde avec Jérém.
Maintenant qu’il est avec Rodney, il fera des choses avec lui, il partira en vacances avec lui, il se créera des souvenirs avec lui. Et ces souvenirs prendront la place de ceux qu’il s’était fabriqués avec moi. Je ne serai plus le seul avec qui il aura visité des lieux, plus le seul copain avec qui il aura partagé de bons moments. Peut-être pas le seul à qui il aura donné un petit surnom mignon. J’étais son Ourson, que sera Rodney, pour lui ? Son beau « Wasps », son beau guêpe mâle ?
J’imagine qu’un jour il aura envie de présenter Rodney aux personnes qui comptent pour lui. Aux cavaliers de Campan, à Charlène, Martine, Jean-Paul, Daniel, à Thibault, à Maxime, à son père.
Et je me dis qu’une fois que Rodney aura été introduit auprès de ses amis et de sa famille, une fois qu’il aura découvert Campan et le domaine viticole de son père, il sera définitivement installé dans sa vie, et notre séparation sera définitivement actée. Car elle le sera dans l’esprit des gens qui ont connu notre couple et il n'y aura plus de retour en arrière possible.
Oui, cette année le vent d’Antan ravive ma tristesse, la fait flamber comme une braise tapie sous des cendres encore fumantes. J’ai l’impression de couler de plus en plus, dans un puits sans fond.
Puis, un soir où je suis vraiment mal, où j’ai vraiment l’impression de toucher le fond, je ressens au fond de moi comme un réflexe de survie. Alors, je donne un coup de pied contre le plancher de ma souffrance, je rassemble mon énergie, je me fais même un peu violence, et je me saisis de mon téléphone.
J’appelle Julien. Dès le lendemain, je passe une soirée avec lui et ses potes dans un bar à proximité du pont Saint-Pierre. Je suis entouré de monde, mais ma solitude ne me lâche pas, même au milieu de tous ces étudiants, même au milieu de tous ces bogoss. Je bois, encore et encore, pour essayer de lâcher prise, pour essayer d’oublier cette souffrance qui ne me quitte pas. J’ai peut-être été un peu vite en besogne, quitter ma retraite alors que ma convalescence n’était pas terminée n’était pas vraiment une bonne idée, je crois que je fais une rechute.
A trois heures du matin, je rentre chez moi à pied, accompagné par Julien qui, inquiété par mon état d’alcoolémie inhabituel, a insisté pour m’escorter jusqu’à la porte de l’appartement de mes parents.
Sur la route, nous faisons une halte, et Julien se grille une clope. C’est effet de l’alcool, ou la peur de me retrouver seul chez moi, de retrouver ma chambre avec tous ses souvenirs de Jérém. Je n’ai pas envie de quitter Julien, ce soir. Plus je le regarde, plus je le trouve sexy. J’ai envie de lui, j’ai terriblement envie de lui. Je réalise que je bande dur. Ce gars dégage une aura sexuelle de fou. Ce mec, il pue carrément le cul. J’ai envie de lui à en crever.
Et si je lui proposais une pipe ? Une pipe, ce n’est pas grand-chose, et ça ne se refuse pas. Surtout pas un queutard comme lui. Une pipe, ce n’est rien, et ça me ferait tellement de bien…
Pendant un instant, l’espace des deux dernières taffes avant d’écraser le mégot, son regard croise le mien et l’aimante. Pendant un instant, je crois que Julien a lu dans mes pensées, dans mon désir. Pendant un instant, je crois voir son visage s’illuminer d’un léger sourire, un sourire qui vaudrait encouragement vis-à-vis de mes intentions, des intentions qu’il aurait devinées et qu’il pourrait faire devenir des réalités. Pendant un instant, j’ai l’impression qu’il hésite, qu’il serait peut-être partant. Pendant un instant, dans ma tête, je suis à genoux devant le beau moniteur, je le fais jouir dans ma bouche, puis il vient en moi, il me pilonne longuement, avant de rincer mes entrailles avec ses bonnes giclées de coureur invétéré.
Mais l’instant est court, et il passe vite. Je le laisse filer. Et lui aussi. Ou alors, je me fais juste des films. Mais comment j’ai envie de me faire baiser par ce mec !
L’instant est désormais derrière nous, et nous recommençons à marcher, et à discuter de choses parfaitement inutiles. Devant la porte de chez mes parents, avant de partir, Julien me fait un bisou sur la joue et me glisse :
— Si j’étais pédé, ça ferait longtemps que je t’aurais déglingué !
Je n’ai pas la présence d’esprit ni la répartie pour lui rétorquer qu’il n’a pas besoin d’être pédé pour me déglinguer. Il suffit juste qu’il en ait envie.
Au fond de moi, je sais que c’est mieux qu’il ne se passe rien entre nous. Mais ça fait du bien d’entendre ce genre de propos dans la bouche d’un si joli garçon.
Avril 2008/1.
J’ai encore rêvé de Jérém. Il était là, nous faisions l’amour, ou la baise, ou les deux.
Je me réveille en sursaut, et je suis seul dans mon lit. Je bande. Et pendant que je me branle, je parcours les nombreuses fois où il a joui en moi. Je parcours les positions, les attitudes, les lieux où il m’a pris, où il m’a fait l’amour, où il a joui, où j’ai joui juste en me faisant limer.
La sensation de me sentir rempli de lui, de me sentir complètement à lui, l’énergie intense qui se dégageait du mélange de nos plaisirs parfaitement complémentaires me manque horriblement. Le voir perdre pied, le voir souffler son plaisir, soufflé de plaisir, savoir que son jus s’extrait de ses couilles et vient fourrer mes entrailles, ça me manque à me rendre fou.
Je donnerais très cher pour le regarder en train de me faire l’amour, ou même le regarder simplement rechercher son propre plaisir, sans se soucier du mien, comme lors des premières révisions dans l’appart de la rue de la Colombette.
Et pour assister à la transformation soudaine de mâle fougueux pendant la recherche du plaisir à garçon perdu une fois qu’il l’a trouvé, la respiration haletante, la peau mate – le front, le creux de son cou et de ses pecs – parsemés de transpiration…
Je jouis, et je pleure.
Avril 2008/2.
Mi-avril, je me décide enfin à rappeler Thibault. Je pense que s’il y a une personne sur terre capable d’alléger un peu mon fardeau, c’est bien le jeune pompier.
Arthur étant d’astreinte au SDIS, il n’a pas pu être avec à nous. Au fond de moi, je suis content que ce soit le cas. Non pas que je n’aime pas Arthur, bien au contraire, ce garçon est bien sous tout point de vue. Mais je sais que je serai davantage à l’aise juste avec Thibault, car nous avons des souvenirs communs, et une connaissance commune qui nous unit. Je sais que je pourrai me laisser aller avec Thibault, parler de ma tristesse, pleurer.
Nous nous faisons un resto au centre-ville. Je n’ai pas vraiment envie de parler tout de suite de mes malheurs. Je sais que ça va venir à un moment ou à un autre, mais j’essaie de gagner du temps. Pour ce faire, je m’emploie à prendre d’abord des nouvelles du jeune pompier.
J’apprends ainsi qu’il est en passe de devenir chef de centre, avec à la clé plusieurs dizaines d’hommes sous sa responsabilité. J’apprends qu’il est toujours heureux avec Arthur, et ça me met du baume au cœur. Thibault mérite tellement ce bonheur ! J’apprends également qu’il est heureux lorsqu’il commence sa journée « en amenant le petit Lucas à l’école ». Si c'est pas mignon, ça ! Thibault est un véritable papa-poule.
Mais le jeune papa ne tarde pas à me questionner.
— Comment tu vas, Nico ?
— J’ai connu mieux.
— Ça peut pas s’arranger entre vous deux, vraiment pas ?
— Non, je ne crois pas…
— J’avoue que je ne comprends pas ce qui s’est passé dans sa tête… vous aviez l’air tellement heureux tous les deux !
— Et moi donc !
— Au fait, tu as eu de ses nouvelles depuis qu’il est parti en Angleterre ? j’enchaîne pour ne pas pleurer
— Pas beaucoup. Je ne l’ai eu au téléphone que pour les vœux de la bonne année.
Ainsi, Thibault y a eu droit. Il n’y a donc que moi qui n’y a pas eu droit. Il veut vraiment couper les ponts.
— Il t’a raconté, pour lui et Rodney ?
— Un peu, mais il ne s’est pas éternisé sur le sujet. Je crois qu’il avait peur que je lui fasse la morale…
— Il avait l’air heureux ?
— Nico…
— Dis-moi, s’il te plaît.
— Je ne sais pas, il avait l’air d’aller bien.
— Il a emménagé avec lui, et il a l’air d’avoir trouvé l’équilibre qui lui manquait avec moi.
— Ne dis pas ça, Nico, Jérém a été très heureux avec toi.
— Il ne l’était pas assez, visiblement !
— Ce qui s’est passé à Paris il y a deux ans ça l’a vraiment secoué. Et ça a tout bousculé dans sa tête.
— Et il m’a oublié !
— Ce n’est pas vrai. Quand on s’est eus au téléphone, il m’a demandé de tes nouvelles.
Je sais que le fait qu’il demande de mes nouvelles ne signifie rien de plus, qu’il n’envisage pas pour autant de revenir auprès de moi. Mais ça me touche d’entendre ça.
La soirée continue chez lui, autour d’un verre. Thibault me parle de son taf qui le passionne et j’aime le sentir si épanoui, si heureux. Le bonheur ajoute encore des degrés à sa sexytude déjà affolante. Sous l’effet de l’alcool et de cette proximité nocturne, je repense à nos plans à trois avec Jérém, celui dans l’appart de la rue de la Colombette, mais aussi à ceux dans l’appart à Paris, à l’occasion des finales de championnat. Et je repense aussi à cette nuit que nous avons passée tous les deux à Bordeaux. Qu’est-ce que ça avait été bien cette nuit de plaisir et de tendresse !
Et qu’est-ce que j’aurais envie de réitérer l’expérience me sentir tour à tour saisi, dominé, enveloppé par ses gros bras ! Ce soir, j’ai envie de lui, furieusement envie de lui.
A la faveur d’un blanc dans la conversation, nos regards se croisent. Thibault semble déceler le désir qui suinte de mon regard, et il a l’air tout autant troublé que moi. C’est sans doute ce trouble, ou bien l’empathie envers ma tristesse, qui le pousse à me prendre dans ses bras puissants et à me serrer très fort contre lui. J’accepte ce gage d’amitié, de bienveillance et de tendresse. Et même si je crève d’envie de l’embrasser, de le revoir à poil et de faire l’amour avec lui, je me retiens ce soir encore. Je respecte son bonheur avec Arthur et je ne veux pas qu’il se passe quelque chose entre nous qu’on pourrait regretter par la suite. Je tiens trop à notre amitié.
Avril 2008/3.
Je me demande quand Jérém amènera Rodney dans sa famille ou à Campan (ou peut-être est-ce déjà fait ?), je me demande comment réagiront tous ces gens quand ils les verront arriver. Je me demande s’ils seront touchés par ce changement, comment ils accueilleront ce nouveau gars dans la vie de Jérém. Je me demande s’ils auront une pensée pour moi. Une partie de moi aimerait qu’ils soient révoltés, qu’ils disent à Jérém qu’il a fait une connerie en me quittant, qu’ils le poussent à revenir vers moi.
C’est on ne peut plus stupide que de penser que lors d’une séparation les proches doivent prendre parti, en particulier vis-à-vis de celui qui est quitté. Et c’est encore plus surréaliste d’imaginer qu’ils doivent œuvrer pour « l’ordre naturel des choses », celui du couple momentanément perturbé par l’« intrus », soit rétabli au plus tôt.
Oui, tout cela est immensément stupide. Et pourtant, cela nous effleure l’esprit à un moment ou à un autre.
Les proches ne peuvent pas prendre parti, car ils n’ont pas à interférer dans la vie de quelqu’un. Si on leur en donne l’occasion, ils côtoieront tout aussi facilement celui ou celle qui quitte que celui ou celle qui est quitté(e). Et ils accepteront également « l’intrus ». Intrus qui, à la simple condition d’être un tant soit peu avenant, ne le restera pas en tant que tel pendant longtemps. L’intrus sera bientôt promu « légitime » dans l’esprit des proches.
Au fond de moi, je sais que Rodney sera accueilli comme je l’ai été et que, le temps de le connaître un peu, ils l’adopteront comme ils m’ont adopté. Ils seront peut-être un peu déroutés sur le coup, mais ils s’y feront très vite. D’autant plus que ce garçon a l’air d’un garçon adorable.
Et le souvenir de Nico s’effacera très vite de leur tête. D’autant plus que, pour me protéger, pour ne pas risquer de croiser Jérém, son nouveau mec et son nouveau bonheur, je cesserai de voir ces gens et que, de ce fait, je cesserai d’exister pour eux.
La douceur de Maxime, le soutien de Mr Tommasi, le franc parler de Charlène, la grande gueule de Martine, la guitare de Daniel, la sagesse de Jean Paul, les boutades de Satine, l’amabilité de Ginette, la bonne humeur des cavaliers, les bons gueuletons, la présence de cette grande famille d’adoption, tout cela va immensément me manquer. La séparation d’avec Jérém m’a également exclu de tout un monde où je me sentais apprécié, accepté, entouré de bienveillance. Un monde où je me sentais bien.
Avril 2008/4
Il y a des jours, où je m’imagine qu’il se souviendra de notre bonheur, que ça lui manquera, et qu’il reviendra m’appeler Ourson. Il y a des nuits où je rêve de cela. Il y a des matins où je me réveille en larmes tellement le décalage entre le rêve et la réalité est violent.
Il y a des heures où je me dis que ce n’est pas possible, que ça ne peut pas se terminer comme ça, que ça devrait être illégal, qu’il devrait exister un délit de « privation volontaire du bonheur d’autrui ».
J’ai beau me dire que je n’ai pas le droit de lui en vouloir d’aimer un autre garçon, la privation de mon bonheur me rend fou. Coincé entre ces deux sentiments contradictoires, comme dans un étau qui ne cesse de se resserrer, j’ai l’impression que ma tête subit une telle pression qu’elle est au bord de l’explosion. J’ai l’impression d’avoir du plomb sur mes épaules, du béton dans mes poumons. J’étouffe, physiquement, mentalement. Je vois tout en noir, et mon avenir me paraît infiniment sombre.
Avril 2008 MadonnaNews.
Le 11 avril, le nouveau single « 4 minutes » est en radio.
L’album sort quelques jours plus tard, le 19 avril. Je me rends à la Fnac à la sortie du taf. Comme pour un astronome qui peut observer des phénomènes célestes une fois tous les X années, pour le fan que je suis, la découverte d’un nouvel album de Madonna est un événement, car cela ne se produit qu’une fois tous les 2 à 4 ans. Alors, j’apprécie à sa juste valeur cette occasion rare. La première écoute, celle à laquelle, par définition, on n’a droit qu’une fois, est une expérience presque « mystique ».
Le CD passe plusieurs fois en boucle dans mon lecteur et dans mon casque.
Impression à chaud : il y a du bon et du moins bon. Hard Candy, c’est le début de l’ère des featurings, des collaborations avec des artistes plus jeunes et plus à la mode pour tenter d’atteindre un public plus large. Un choix artistique peut-être inévitable, mais à l’efficacité plutôt discutable pour le fan que je suis.
Pour moi, Madonna, c’est de la pop et c’est en solo. Là, ce n’est plus vraiment de la pop, et c’est trop souvent en featuring. Le son est plus dur, plus acidulé. Pour moi, c’est moins du Madonna. Après plusieurs écoutes, et sous réserve d’un changement d’avis lorsque le disque aura un peu vieilli et se sera installé dans ma mémoire « madonnienne », je me dis que le chef d’œuvre pop « Confessions » sorti trois ans plus tôt n’est pas égalé par cette nouvelle galette.
Ce qui n’empêche pas cet album, et les chansons qui le composent, de se mélanger très rapidement aux événements actuels de ma vie, et à se constituer en icônes sonores de nouveaux souvenirs personnels et intimes. Au même titre que les albums précédents.
En 1998, « Ray of Light » a été l’album de mon entrée au lycée, et de l’entrée de Jérém dans mon cœur.
En 2001, « Music » a été la bande son des premières révisions sexuelles dans l’appart de la rue de la Colombette, des baises à répétitions, des fois où j’ai été réveillé par sa queue raide et insatiable qui cherchait mon cul pour lui gicler dedans une fois de plus.
En 2003, American Life a été le support sonore des longues semaines à Cap Breton pendant la rééducation de Jérém après son accident au rugby. Et de sa guérison, de son grand retour au rugby, et de nos jours heureux, des câlins avant, pendant, et après l’amour.
En 2005, Confessions on a Dancefloor a été la symphonie pop des jours heureux, de l’apothéose de mon bonheur avec Jérém.
Et en 2008, Hard Candy est l’album qui sonne le glas de ce bonheur, l’album de l’ère post-Jérém, celle du manque et du déchirement, une nouvelle ère de ma vie où je me perds dans un infini de tristesse dans lequel je n’ai plus de repères.
Et, malgré tout, Madonna est là une fois encore pour m’en donner un, avec sa musique.
Mai 2008.
Après le match auquel j’avais assisté avec Papa, j’ai pris et tenu la résolution d’arrêter de regarder les matches de rugby anglais. Voir Jérém m’est encore trop douloureux. J’ai besoin de prendre de la distance, j’ai besoin de penser à autre chose.
Et pourtant, à l’occasion de l’anniversaire de notre première révision dans l’appart de la rue de la Colombette, alors que la morsure du manque se fait particulièrement cruelle, je vais sur Internet, satanée invention qui rend le « sevrage » de l’Autre et le processus de deuil amoureux encore plus problématiques, en quête d’articles sur le championnat anglais et sur Jérém.
J’apprends alors qu’après un début de saison en dents de scie et par moments franchement chaotique, en cette fin de tournoi, les Wasps reprennent du poil de la bête. Et je constate que la presse est unanime, le rôle de la nouvelle recrue française, et du tandem de choc qu’elle forme avec un joueur plus expérimenté, Rodney William, est le moteur de cet exploit sportif.
Les photos de mon Jérém en maillot ne sont pas moins insoutenables que les images filmées de la télé.
Retrouver sa belle gueule marquée par les séquelles de notre agression est toujours une épreuve. Et voir son nom et prénom associés à ceux de Rodney presque à chaque article en est une autre. Non, je ne suis pas près de guérir de la blessure, de la déchirure, de l’absence, de cet amour perdu.
J’apprends également que le 18 mai, lors de la demi-finale de la Guiness Premiership, Jérém a marqué pas moins de trois essais, des point décisifs pour la victoire remportée contre le Bath Rugby pour 21-10.
Le 31 mai, lors de la finale contre les Leicester Tigers au stade Twickenham à Londres, les Wasps s’imposent 26 à 16 et remportent haut la main le championnat anglais. Et, une fois de plus, les exploits Tommasi-Williams sont salués par la presse sportive.
Comment Jérém doit être heureux de partager ces moments, ces exploits, cette réussite avec le gars qu’il aime ! C’est peut-être ça qui lui manquait avec moi, partager sa passion pour le rugby. Et il a trouvé ça auprès de Rodney. Il a peut-être été heureux avec moi, je l’ai cru pendant un moment, d’autres l’ont cru, et Jérém lui-même a pu le croire. Mais le fait est que le bonheur qu’il vit aujourd’hui est probablement si intense qu’il finira par éclipser celui qu’il a vécu avec moi.
Les derniers espoirs qu’ils puisse revenir un jour vers moi fondent dans mes larmes comme un sucre dans le café.
Début juin 2008.
Début juin, je tombe sur un article indiquant que Jérémie Tommasi et Rodney Williams auraient signé pour au moins une saison en Afrique du Sud. Il est prévu qu’ils intègrent l’équipe des Sharks pour y disputer début 2009 le Super 14, une compétition de rugby internationale entre équipes sudafricaines, néo-zélandaises et anglaises.
Partir en couple en quête du graal du rugby mondial, partir comme deux jeunes premiers que rien ne semble pouvoir arrêter, la route devant eux toute tracée vers la gloire sportive. Ça doit être tellement beau. Ils doivent être tellement heureux, les deux amoureux !
Je lis également que si le retour de Jérém dans le XV de France avait un temps été envisagé au vu de ses exploits anglais, désormais, suite à ce transfert en Afrique du Sud, cela n’est à nouveau plus d’actualité. Jérém s’éloigne un peu plus de moi, de plusieurs milliers de bornes.
Adieu, Jérém, mon Amour.
Début juin 2008, juste avant les épreuves du bac.
Un mercredi, un jour de RTT, je décide d’aller faire un tour en ville. J’ai envie de passer à la FNAC. Mais ma nostalgie inconsolable détourne mon trajet, aimante mes pas vers le lieu où tout a commencé.
Sans vraiment le vouloir, mais sans m’y opposer pour autant, je me retrouve devant l’entrée de mon ancien lycée. J’ai envie de revoir l’endroit où mon existence et celle de Jérém se sont croisées. Je le redoute aussi. L’absence est une présence en négatif, mais une présence quand-même. Un lieu, le lieu, ce lieu est un support formidable pour la mémoire, pour le souvenir.
Pour que ma visite ne paraisse pas bizarre, le prétexte est tout trouvé. J’aimerais passer dire bonjour à mon ancienne prof de français, Mme Talon.
Dès que je pénètre dans la cour du lycée où je ne suis pas rendu depuis le bac, soit depuis sept ans, j’ai un sentiment de vertige en contemplant le temps passé depuis. Cela a filé si vite ! Je réalise que je ne connais plus personne ici, car même « les premières années » lorsque j’étais en terminale ont passé leur bac depuis belle lurette.
Dans la cour qui n’a pas changé, je cherche le vieux chêne sous lequel se tenait Jérém en ce fameux matin de septembre 1998. Bientôt dix ans ! Je le revois toujours, en train de discuter avec ses potes, je revois son t-shirt noir, sa casquette noire à l’envers, son insolence, sa beauté surnaturelle, son sourire ravageur, et je ressens à nouveau les papillons dans le ventre que j’avais ressentis ce jour-là. Mon cœur se serre, mes larmes coulent sur mon cœur, montent à mes yeux, et je les arrête de justesse pour qu’elles ne débordent pas sur mes joues.
J’essaie de détourner mon attention sur ce que la vie peut offrir de plus beau, de plus rafraîchissant, de plus réconfortant, le spectacle de la jeunesse, la jeunesse masculine en ce qui me concerne.
Partout dans cette cour qui « fut un temps mon terrain de jeu », pour citer le titre d’une très belle ballade madonnienne sortie en 1992,
Oui, partout dans cette cour qui fut le « terrain » de mon premier amour, et qui ne l’est plus, hélas, ici et là, des grappes de lycéens distribués de façon homogène dans l’espace verdoyant offrent un spectacle saisissant.
Leur insouciance me fascine, leur position dans la vie, juste avant le bac, c’est-à-dire à l’aune du début de leur âge adulte, avec tant de possibilités devant eux, avec tant de futurs possibles pour chacun d’entre eux. Eux, que la vie n’a pas encore abîmés, meurtris.
Il y a quelques garçons qui attirent mon attention plus que d’autres, quelques physiques déjà bien développés, quelques formats rugbyman, quelques belles petites gueules, quelques brushings insolents, quelques jeunes virilités qui ne doutent de rien et qui ne semblent demander qu’à être défrisées par un orgasme d’intensité inattendue.
Il règne dans cette cour, tout comme dans les couloirs du lycée, un air de nonchalance de fin d’année, comme un avant-goût de vacances. Je me souviens de cette ambiance des derniers jours avant le bac où tout le monde était pressé d’en finir avec le lycée. Je me souviens de la tristesse que cela provoquait en moi, car cela annonçait la disparition de Jérém de ma vie. Je me souviens du déchirement qu’était l’arrivée de l’été qui annonçait la fin des jours où je pouvais encore le côtoyer. Et ça, je ne pouvais pas l’accepter. C’est de ce déchirement que j’avais puisé la force de lui proposer de réviser ensemble. La suite est une histoire connue.
Je passe devant les portes ouvertes des classes, et mon cœur se serre un peu plus à chaque pas qui m’approche de mon ancienne classe de cours. Et dans cette pièce qui, elle tout particulièrement, « fut un temps mon terrain de jeu », une prof que je ne connais pas fait un cours de rattrapage à une poignée d’élevés tout aussi inconnus.
L’un d’entre eux, un délicieux petit con brun, une fabuleuse tête à claques à l’air de sacré branleur, ce qui le rend furieusement sexy par ailleurs, est assis à SA place. Une place qui en aura connu plus d’un, des branleurs sexy.
Je me fige sur le seuil de la porte, incapable de m’éloigner de ce lieu de souvenirs. Je reste figé jusqu’à me faire repérer.
— Je peux vous aider, Monsieur ? me demande la prof.
— Vous vous sentez bien, m’sieur ? me demande d’une façon adorablement insolente le petit con brun assis à la place de Jérém.
Monsieur… ça fait quelque chose d’entendre un petit con de près de dix ans mon cadet m’appeler ainsi.
— Je… je cherche Mme Talon, je finis par articuler comme en apnée.
— Je crois qu’elle n’a plus cours. Mais allez voir en salle des profs, elle y sera certainement.
— M… Merci… je bégaie, tout en me faisant violence pour m’extirper de ce lieu de souvenirs.
Mme Talon est effectivement dans la salle des profs. Elle est en train de corriger des copies. En me voyant arriver, elle me sourit et vient me saluer. Elle me propose un café.
— Nicolas, ça me fait plaisir de te revoir, alors, qu’est-ce que tu deviens ?
En quelques minutes, je lui parle de mes études à Bordeaux, de mon travail à Montaudran.
— Et tu es marié, fiancé ?
— Non…
J’ai toujours considéré Mme Talon comme une bonne prof, une prof qui a su me faire aimer les classiques de la littérature française, car elle a su les rendre vivants, en portant sur les auteurs et leur œuvre un regard moderne, décomplexé, en mettant en évidence l’universalité du message que ces textes portaient en eux, en les mettant à notre portée sans pédanterie, souvent avec humour, l’humour qui est le sel de l’existence.
J’ai aussi toujours considéré Mme Talon comme une femme forte, avec un caractère bien trempé, drôle mais ferme, exigeante mais juste. Une femme dotée d’une élégance et d’une grâce naturelles, d’un charisme qui en impose. Et, par-dessus tout, une femme intelligente. Une femme que je portais en grande considération, car elle a toujours fait preuve d’une profonde bienveillance à mon égard.
Cette intelligence et cette bienveillance, je les retrouve aujourd’hui, lorsque, après lui avoir dit que je n’étais pas marié parce que les filles ne sont pas ma tasse de thé et que depuis le lycée j’étais tombé amoureux d’un camarade de classe, elle m’a répondu :
— Je me suis toujours dit que le regard que tu posais sur lui était un regard d’amoureux.
— Vous saviez ?
— Toutes les filles étaient amoureuses de lui, alors, pourquoi pas toi ?
— Oui, pourquoi pas moi…
— Il a fait une belle carrière.
— Oui…
— Et tu l’as revu après le lycée ?
— Nous avons eu une relation qui a duré jusqu’à l’année dernière.
— C’est vrai ?
— Oui, nous avons été heureux. Mais ça s’est terminé.
— Hélas, la vie est ainsi faite. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Tu es jeune, et à ton âge le bonheur est là, il suffit de tendre la main pour le saisir. Je suis désolée mais je dois y retourner, elle enchaîne. Reviens me voir, mais plutôt en début d’année scolaire, car là c’est le rush.
— Je reviendrai, je lui réponds, alors que je sais pertinemment que je ne le ferai pas.
— Ressaisis-toi, Nico. Fais confiance à la vie, elle te le rendra. J’ai envie de te dire cette phrase que disent les Italiens et qui est intraduisible en français, « faccio il tifo per te ».
— Ce qui veut dire ?
— « Fare il tifo », c’est supporter une équipe de foot. Donc, « fare il tifo » pour quelqu’un, c’est croire en lui, tout en lui souhaitant le meilleur.
— Merci, Madame, je sais que vous avez toujours cru en moi, et vous me l’avez montré quand j’en avais le plus besoin.
— Je n’ai fait que mon travail.
— Non, vous avez fait bien plus que ça. Vous m’avez appris à croire en moi, j’arrive à articuler de justesse, alors que les sanglots chatouillent mes cordes vocales.
— C’est bien ce que je dis, je n’ai fait que mon travail de prof.
Je traverse la cour en caressant une nouvelle fois du regard ces grappes de délicieux petits mâles en fleurs que la vie n’a pas encore abîmés, en leur enviant la magnifique page de vie vierge qui se dresse devant eux, tout en ignorant qu’il y a eu un jour Jérém&Nico dans ce lycée, dans cette cour.
Je me demande combien d’entre eux ont déjà connu l’amour. L’amour physique, l’amour du cœur. Combien d’entre eux ont aimé ou aiment secrètement d’autres garçons. Je me demande s’il y en a qui ont osé proposer à ce gars qui les troublait depuis le premier jour du lycée de réviser pour le bac.
Je me demande, parmi ces lycéens qui me semblent si jeunes par rapport à moi, combien de « Jéréms » enfermés dans leur rôle d’hétéro, combien de « Nicos » soupirant secrètement se cherchent et vont se trouver un jour, ou pas. Ou pas.
A tous les Nicos, j’ai envie de dire, de crier : soyez patients, persévérants.
A tous les Jéréms, j’ai envie de hurler : laissez-vous aller !
A tous, j’ai envie de brailler : N’ayez pas peur d’aimer ni de vous laisser aimer, jamais !
Car il n’y a que lorsqu’on aime, et que l’on se sent aimé en retour, qu’on est vraiment et pleinement heureux.
Les mots de Mme Talon m’ont ému aux larmes. Mais ma tristesse en ressortant de l’enceinte du lycée n’est que plus grande.
Juin-Juillet 2008.
Après un printemps pluvieux, la belle saison s’installe peu à peu. Au début, j’ai voulu l’ignorer, cette belle saison, et continuer à rester enfermé chez moi. La pluie était un parfait support à ma tristesse. Mais les beaux jours semblent appeler avec insistance à oublier ses propres malheurs et à s’ouvrir à nouveau à la vie. Il me semble qu’il est encore plus dur d’être triste quand les beaux jours sont là.
Je souffre comme un chien, et cette souffrance est devenue une partie de moi, elle a remplacé mon bonheur. Alors, au fond, à ma souffrance, j’y tiens. Je n’ai pas le courage d’oublier le bonheur passé, d’oublier Jérém. J’ai l’impression que sans cette souffrance, je me sentirais encore plus seul, encore plus malheureux, que je me sentirais nu. Que je trahirais l’amour de mes vingt ans. Déjà que Jérém semble avoir tout oublié, je reste le dernier témoin de ce bonheur. Si moi aussi je l’oublie, ce sera comme s’il n’avait jamais existé.
Je ne peux l’oublier, non, jamais. Alors, je prends des notes, je trace des lignes, je remplis des feuilles de mots, d’épisodes, de souvenirs, de larmes. Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ça, peut être juste laisser une trace, pour ne pas laisser l’oubli engloutir l’amour de mes vingt ans.
Oublier c’est dur, mais me replonger dans les souvenirs ça l’est tout autant, dur et épuisant. Je ne peux jamais écrire très longtemps. Les larmes finissent par brouiller mes yeux, et je suis obligé d’arrêter. Souvent. Mais je reviens régulièrement à mes cahiers. Mes notes, mes textes, mes divagations ressemblent à un sacré bazar. Mais à mon bazar, j’y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Car c’est tout ce qui me reste de Jérém.
Juillet 2008.
L’été avance, avec ses journées chaudes propices à l’observation du Masculin. Lors de mes trajets maison-boulot, j’observe le spectacle des « fleurs du mâle ». Les bras se découvrent en premier. Parfois, au bonheur des débardeurs, les épaules se dévoilent également. Au gré des échancrures généreuses, on peut observer la naissance des pecs, quelques poils, parfois.
Le bonheur tient parfois en une manchette qui épouse de près un biceps solide, dans une façon de porter le t-shirt sur un beau torse, dans une chute d’épaules à l’angle solide, dans l’arrondi d’un col, dans une chaînette nonchalamment posée sur la peau, dans un brushing, un regard, un sourire, des lunettes de soleil, une barbe, un grain de beauté, dans un brushing brun, châtain, blond, insolent. Délicieux détails du Masculin. Le Masculin qui est parfois dans un détail, parfois un tout, ou les deux à la fois.
Les journées chaudes peuplées de délicieuses visions masculines toutes plus émoustillantes les unes que les autres sont suivies de nuits tièdes appelant à l’amour physique. Pendant un temps, ma morosité efface mon désir. Je contemple les beaux garçons, sans vraiment les désirer.
J’ai l’impression qu’en allant de l’avant, je fermerais définitivement la porte à un éventuel retour de Jérém. C’est tellement dur de tourner le dos aux souvenirs heureux, à l’amour de sa vie.
Mais l’été sait se montrer persuasif. Il me chuchote à l’oreille qu’il est un péché mortel que de gaspiller de si belles journées, et de si douces nuits, à se morfondre.
Puis, un vendredi, le vent d’Autan se met à souffler. Il se lève dans l’après-midi, et continue de gronder bruyamment dans la rue le soir venu.
Le vent d’Autan semble lui aussi m’encourager à aller de l’avant, à prendre ma vie en main, à me secouer de ma morosité. Il semble dire, répéter, encore et encore que la belle saison est là, et que ce serait un énorme gâchis de la gaspiller en broyant du noir.
Le vent d’Autan. Il m’en a fait, des coups, celui-là ! Il m’a conduit à Jérém un jour de printemps, et il m’en a éloigné un jour d’automne.
Et maintenant, il voudrait que je lui fasse à nouveau confiance pour aller de l’avant ? Mais pour aller où au juste ?
Je ne sais pas si j’en ai envie, de lui faire confiance. Je n’ai envie d’aller nulle part, au juste. En fait, j’ai peur. Peur de bouger dans ma vie, peur de rater Jérém si jamais il décidait de revenir me chercher.
Le déclic arrive le soir même, tard dans la nuit, lorsque de ma radio surgissent les accords de guitare d’une chanson chantée par un charmant garçon.
« J’ai toujours préféré, aux voisins les voisines »
Ce couplet m’a toujours fait sourire, car j’ai toujours trouvé que chanter :
« J’ai toujours préféré aux voisines les voisins », ça sonnait tellement mieux.
Déjà, car il y a effectivement dans le voisinage proche de chez mes parents un garçon qui est tout à fait à mon goût. Hors de ma portée, mais terriblement à mon goût.
Mais ce soir, cette nuit, la légèreté et la sensualité de cette chanson prennent une nouvelle dimension pour moi, elles ont l’effet d’un électrochoc, d’une caresse, d’une brise excitante sur ma peau. Ses accords de guitare frais comme un sirop de grenadine semblent me pousser à aller de l’avant.
Je réalise à quel point j’ai envie de sortir de ma morosité, de sortir tout court. Au fond de moi, je sais que j’étouffe dans cette chambre, que je me noie dans cette chambre. Je sais que j’ai besoin de prendre l’air, de boire un peu, de danser, d’oublier. Je sais que je ne pourrai pas oublier. Mais je peux cesser de penser, de broyer du noir, de pleurer. Du moins, l’espace de quelques heures.
Alors, pour tenter d’apaiser la douleur qui meurtrit mon esprit, qui déchire mon cœur et transperce mes entrailles, je me jette tête la première dans mon été de nouveau célibataire.
L’instinct de survie finit par gagner. Après des mois de réclusion volontaire, changement de cap à 180 degrés.
Dès le soir suivant, le samedi, je sors pour me rendre dans ces lieux où je peux croiser des garçons comme moi. Des lieux où je peux faire des rencontres. Je n’ai aucune envie de construire une nouvelle histoire. Non, j’ai juste envie de tester mon pouvoir de séduction et de baiser.
Le quartier de la rue de la Colombette m’étant impossible à approcher à cause des souvenirs encore trop vifs, la Ciguë et le On Off me sont interdits. Alors, je me rends au B-Machine. J’ai un pincement au cœur, un gros pincement, en franchissant le seuil de cette boîte où je ne me suis pas rendu depuis près de sept ans, après le premier clash avec Jérém, le soir où il s’était retrouvé mêlé à une bagarre qui l’avait plongé dans le coma. Ça m’arrache les tripes de revenir à la case départ, en tant que nouveau célibataire, après avoir été si heureux et avoir tout perdu de mon bonheur passé.
Je me fais violence, et j’y vais.
Une fois installé au comptoir avec ma bière, je ne sais plus exactement ce que je viens chercher ici, je ne sais même plus pourquoi je suis venu. En vrai, je n’ai même pas envie de boire, ni de danser, ni de baiser. Au final, j’ai juste envie de rentrer chez moi et de m’abandonner à ma tristesse familière.
Et, pourtant, je me fais une nouvelle fois violence pour rester.
Mais cette soirée est une déception totale. Pendant deux heures, je me retrouve comme un con derrière ma bière, personne ne vient me parler. Je ne vais pas non plus parler à qui que ce soit, je ne croise aucun regard, j’ai l’impression d’être transparent. Ou repoussant. Je dois porter sur moi mon malheur, ma tristesse. Et il n’y a rien de tel pour faire fuir les garçons.
Il n’est pas encore minuit lorsque je repars bredouille, sans même avoir eu envie de me mélanger à la foule qui a pris d’assaut la piste de danse au sous-sol.
Et pourtant, j’y reviens, dès le lendemain. Je prends un verre et je descends au sous-sol pour m’étourdir de décibels et mater les garçons, sans espérer davantage de cette soirée. Mais c’est souvent quand on ne s’y attend plus que les choses finissent par arriver.
Sous l’effet des lumières polarisées, son t-shirt blanc bien ajusté à sa plastique avantageuse brille de façon aveuglante dans la pénombre à l’autre bout de la piste de danse. Il brille dans le contraste avec sa peau bien mâte, avec son intense brunitude. Il brille également dans le contraste, on ne peut plus intense, avec mon souvenir, avec ce t-shirt noir qu’il portait, si bien, par ailleurs, lors de notre première « rencontre ». C’était il y a longtemps, à l’entrée du On Off. J’étais avec Jérém, il était là avec ses potes, une petite cour d’admirateurs de son intense mâlitude.
Le bobarbu bien viril m’a capté et il me fixe depuis l’autre bout de la piste. Son regard de chasseur mâle, de chasseur de mâles m’intrigue, m’intimide, m’excite.
C’est lui qui fait le premier pas, au sens propre comme au sens figuré. Le premier est son sourire, un sourire carnassier, conquérant, assuré, lubrique, arme de séduction massive. Les suivants, ce sont des vrais pas par lesquels il contourne la piste en se faufilant entre les torses, en frôlant les torses et les biceps, en se frayant avec aisance un chemin entre les regards qui tentent de le retenir, pour s’approcher de moi. Le fauve fonce sur moi, je n’ai plus qu’à bien me tenir.
— Salut, ça fait un bail, il me glisse, tout en me claquant la bise.
Sa barbe est toujours aussi douce, aussi excitante, son parfum toujours aussi entêtant, sa présence toujours aussi troublante. En fait, le mot juste est « bandante ».
— Salut, oui, ça fait sept ans, jour pour jour.
— Déjà ?
— Eh, oui, ça passe vite…
— Tu as bien changé, tu es devenu beau garçon !
— T’as qu’à dire que j’étais moche à l’époque !
— Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit. Tu as grandi, tu as mûri, tu as l’air d’avoir pris de l’assurance. Tu n’es plus le minet perdu que tu étais il y a sept ans. T’as l’air d’un mec qui a quelques heures de vol au compteur…
— Si tu le dis…
— Ce qui fait que j’ai encore plus envie de te baiser maintenant que l’autre fois ! il me lance, cash.
— Je prends ça pour un compliment…
— Ça en est un !
— Toi, t’es toujours aussi bandant…
— Je sais, il fait, sans ciller.
— Et toujours aussi insupportable !
— C’est ça qui fait mon charme, entre autres…
Je souris.
— Alors, qu’est-ce qui t’amène ici, dans ce lieu de perdition ?
— Mon nouveau célibat, je suppose.
— T’as été maqué pendant tout ce temps ?
— Oui, pendant sept ans, ou presque.
— Ne me dis pas que pendant tout ce temps tu te tapais ce gars qui a fait une sacrée carrière au rugby ?!
— Si !
— Ah, cool pour toi ! Comment il s’appelait déjà… Jérôme, je crois…
— Jérémie, il s’appelait Jérémie.
— Je n’en reviens pas que je me suis fait baiser par un futur titulaire du XV de France ! Et alors, c’est fini entre vous ?
— Oui…
— Dommage…
— Oui, dommage.
— Tu veux un truc à boire ? il me propose, sans chercher à en savoir davantage sur ma rupture, chose que j’apprécie, car je n’ai vraiment pas envie d’en parler dans ce contexte, avec tout ce bruit autour.
— Avec plaisir.
Une minute plus tard, Romain et moi trinquons à nos retrouvailles imprévues.
— Et toi, toujours à la chasse aux mecs ? je lui lance.
— On ne se refait pas, il se marre. Son sourire est toujours aussi furieusement charmeur et lubrique. Mais maintenant, j’ai un régulier, il continue. Il est là, à côté de l’entrée, c’est le gars avec le t-shirt orange. Il s’appelle Rémi. On vient de temps à autre pour chercher un mec pour un plan à trois. C’est pour ça qu’on est là ce soir.
Son regard me déshabille.
— Et d’ailleurs, il enchaîne, si ça te dit d’être ce gars, ce soir, j’en serais ravi. Et lui aussi, à en juger d’après la façon dont il te mate.
La beauté virile de ce mec se rapproche de celle de Jérém. Ce gars, a côtoyé Jérém, a dragué Jérém, a défié Jérém, a sucé Jérém, s’est fait baiser par Jérém. En couchant cette nuit avec lui, j’aurais peut-être un peu l’impression que Jérém soit là, avec nous, avec moi, en moi.
— Pourquoi pas…
Une demi-heure plus tard, dans un appartement aux Sept Deniers, nous sommes deux à nous « disputer » la queue bien tendue du bobrun barbu à qui j’ai demandé de garder le t-shirt blanc pendant cette longue séance de fellation.
Rémi finit par monopoliser la queue de son régulier, et moi je me retrouve sur le carreau. Alors, je me remets debout, et je sors ma queue. Remi ne tarde pas à venir me pomper. Mon plaisir est décuplé par le regard que le beau barbu pose sur moi, un regard intrigué et chargé d’une lubricité brûlante. En fait, j’ai compris ce qu’il kiffe, Romain. Il kiffe baiser des mecs « actifs de base », des mecs qui le font penser à des hétéros. Plus je me montre « actif », « viril », plus je l’excite, tout comme ça l’avait excité de se frotter à la virilité de Jérém. Il aime être l’actif de mecs actif qu’il aime être le seul capable à rendre passifs.
Romain chausse une capote, il se positionne derrière moi et s’enfonce en moi pendant que Rémi me suce. C’est génial de se sentir en même temps actif et passif. Ses coups de reins se prolongent sur le lit, avec Rémi allongé sur le ventre juste à côté, avec ses belles fesses offertes, attendant patiemment que son maître vienne honorer son cul.
Ce que le beau brun barbu ne tarde pas à faire. Il sort de moi, il se débarrasse de sa capote, et il s’enfonce entre les fesses de son régulier. En quelques coups de reins, il remplit le beau Rémi de quelques bonnes giclées chaudes.
C’est terriblement excitant de voir un aussi beau mâle jouir. Mon excitation est à son paroxysme. Alors, lorsque le beau barbu se retire de son régulier, je pose ma main entre les reins de ce dernier pour l’empêcher de se redresser.
— Attends un peu, t’as pas fini de te faire baiser, je lui lance, sur un ton désinvolte. Un ton qui fait son effet, car Rémi écarte à nouveau ses cuisses et cambre à nouveau ses jolies fesses.
— Mets une capote, il me glisse.
— C’était prévu !
— Tu fais ça maintenant ? j’entends Romain me glisser, sur un ton tout aussi surpris qu’excité pendant que je me saisis d’une capote et que je la déroule le long de ma queue tendue.
Je ne réagis pas à son interrogation, bien assez satisfait de l’avoir surpris, et peut-être troublé un fois de plus cette nuit.
Un instant plus tard, je me laisse glisser entre les fesses de Rémi, je m’enfonce lentement dans son trou bien préparé par les assauts du beau barbu, lubrifié par sa semence, comme dans du beurre.
Dans l’état d’excitation qui est le mien à ce stade de la soirée, il ne me faut pas longtemps pour venir. Pendant toute la durée de mes va-et-vient, le regard de Romain ne m’a jamais quitté. Et sa trique ne l’a jamais quitté non plus. Je devine ce qui m’attend « après ». Et cette idée précipite et décuple mon orgasme.
Je viens tout juste de jouir lorsque je me retrouve plaqué sur le matelas, la capote pleine toujours sur ma queue qui ne saurait débander. Mon corps vibre encore sous les dernières répliques du séisme de mon orgasme, alors que la langue du beau barbu s’affaire déjà sur ma rondelle pour m’offrir d’autres intenses frissons.
Ça ne fait pas une minute que j’ai joui, mais l’envie de me faire baiser par un Romain excité au possible fait remonter illico mon excitation et mon envie de m’offrir à lui.
— Vas-y, baise-moi… beau brun ! je lui lance, comme un écho aux échanges passés avec Jérém.
Romain ne se fait pas prier, il vient en moi aussitôt. Je ferme les yeux, je me concentre sur la présence de sa queue en moi, sur son gabarit, sur sa façon de me posséder, sur sa façon de me saisir avec ses mains, sur sa façon de me signifier que j’ai beau jouer les actifs, le mâle alpha c’est toujours lui, un point c’est tout.
Il s’enfonce en moi jusqu’à la garde et il commence à me limer.
— Vas-y, fais-toi plaisir, bomec, baise-moi autant que tu veux ! je le chauffe.
— Je vais te baiser comme une chienne !
— C’est tout ce que je demande.
— T’aimes prendre une bonne queue dans le cul, hein ?
— Oh que oui…
— Et ma queue, tu la kiffes ?
— Ta queue est super bonne !
Elle est bonne, certes. Mais aucune ne saura égaler celle du gars que j’aimais plus que tout.
— Elle est aussi bonne que celle de Jérémie ? il me poignarde dans le dos en même temps qu’il me baise dans le dos.
J’ai envie de pleurer, mais mon excitation m’aide à tenir bon, et à mentir.
— Aussi bonne, j’affabule pour le chauffer encore un peu plus.
— Peut-être plus bonne encore… il siffle, malicieusement.
— Peut-être bien… je sur-mens pour le chauffer à blanc.
J’ai envie qu’il sorte toute sa fougue de mâle, j’ai envie qu’il me défonce comme il sait bien le faire quand on sait lui parler, le chercher, le provoquer, j’ai envie que ce soit animal, j’ai envie de me sentir à lui, j’ai envie que ce soit comme avec Jérém.
Pour être animal, c’est bien animal. Je ne sais pas s’il a cru à mes mensonges, mais ce qui est certain c’est qu’il est sacrement excité et que ses assauts sont bien fougueux. Et pourtant, ils ne provoquent pas l’extase à laquelle je m’attendais.
J’ai beau fermer les yeux, rejouer des répliques de pieu iconiques, mentir sans pudeur. Romain est un sacré mâle, un sacré baiseur. Mais Romain ce n’est pas Jérém. Avec Romain, c’est bon, très bon même. Là où avec Jérém, c’était un feu d’artifice. Cette capote entre nous est du bon sens en caoutchouc, du bon sens non négociable, mais il enlève toute spontanéité de ma part. Après la mésaventure avec Benjamin il y a quelques années, je suis toujours sur le qui-vive, de peur que ça casse. Je ne veux pas revivre la frayeur que j’ai vécue à l’époque. Peut-être que j’attends trop de ce plan, c’est même certain, dans la mesure où je demande plus ou moins consciemment à mon amant d’être quelqu’un d’autre.
Romain finit par venir quelques instants plus tard, en lâchant un beau râle de jouissance et de satisfaction.
Quant à moi, je n’ai plus envie de jouir, j’ai même débandé.
Inutile d’attendre les câlins qui savent amortir l’atterrissage après l’extase, ils ne viendront pas. Romain n’est pas câlin après avoir baisé. Ça aussi, ça le différencie de mon Jérém.
Romain n’est pas non plus le genre à garder dormir chez lui l’outsider d’un plan à trois. Il est près de deux heures du mat, et il m’appelle un taxi. L’attente est longue et le silence dans l’appart assommant. Il n’y a que l’humour de Ruquier et la folie de Foresti jouant un sketch ponctué de la réplique « Je ne suis pas folle, vous savez ? » pour rendre ce long moment d’attente un brin moins glauque.
Avec Romain, je n’ai pas trouvé ce que je cherchais. Tout simplement parce que ce que je cherche, est inatteignable. Aucun gars ne saura jouer les Jérémies. Je redescends alors mes attentes d’un cran, et je passe en mode « j’ai besoin de baiser pour oublier, alors je cherche simplement un mec pour baiser ».
Je sors à nouveau. Dès le lendemain. Toujours au B-Machine. Un gars vient me parler, je finis la nuit dans son pieu. J’aimerais le revoir, mais je sens que ce n’est pas à l’ordre du jour de son côté.
Le week-end suivant, je recroise Romain au B-Machine, il drague d’autres mecs, d’autres proies. Lorsque je l’approche, il me dit tout juste bonjour. Ce gars n’est que le gars d’un soir, un soir tous les sept ans, éventuellement. Alors, peut-être rendez-vous en 2015…
Un autre soir, je tombe sur un gars prénommé… Jérémie, « Jérém pour les potes ». Quand il m’a appris son prénom, j’ai eu envie de pleurer. Dans le noir que j’ai demandé pour nos ébats prétextant que cela m’excite à mort, je ne me prive pas de lancer encore et encore, moins une exhortation qu’une supplication :
— Vas-y, défonce-moi, Jérém !
Mais Jérém ne me défonce pas du tout comme Jérém. Car Jérém n’est pas Jérém. Il n’a même pas du tout le genre, le corps, ni la gueule de mon Jérém. Mais il y a quelque chose d’excitant, à la fois de douloureux, frustrant et excitant dans cette sorte de mantra : Vas-y, défonce-moi, Jérém !
Je continue de sortir, d’avoir des aventures. Mais avec ces quelques inconnus, le manque de complicité sensuelle et de tendresse me fait cruellement défaut. L’inquiétude vis-à-vis des IST et MST que je pourrais choper rien qu’en prenant un mec en bouche ou en laissant un mec me prendre en bouche, la peur que la capote casse, le gars pressé de partir, le gars pressé que je parte, moi pressé de partir une fois que nous avons fait ce que nous avions à faire, l’envie de pleurer lorsque je me retrouve seul dans la rue, en train de rentrer chez moi, seul comme un chien, tout cela enlève toute une grande partie de l’insouciance et de la spontanéité qui fait d’une baise une bonne baise.
Jamais je ne retrouverai un amant comme Jérém, un amant qui savait me faire jouir comme personne d’autre. Un amant en qui je pourrai avoir assez confiance pour faire l’amour sans capote. C’est tellement bon de pouvoir faire assez confiance à un garçon pour être rempli de son jus. Sans cela, pour moi, le plaisir est incomplet, saboté, inachevé.
Oui, je donnerais cher juste pour l’avoir une dernière fois en moi, ne serait-ce que dans ma bouche, pour recevoir une dernière fois ses giclées chaudes dans mon palais, pour retrouver son goût de jeune mâle, et pouvoir avaler sans avoir à réfléchir, et profitant de ce plaisir l’esprit libre.
Pendant les nombreuses branlettes avec lesquelles je m’assomme, j’en viens même à envisager de prendre un avion pour Londres pour aller lui proposer, réclamer, quémander une pipe en souvenir du bon vieux temps. Au fond, une pipe, ça ne se refuse pas, et une pipe ce n’est pas vraiment tromper…
Je me dis qu’il doit se souvenir d’à quel point il les aimait, mes pipes, et qu’il serait donc sensible à ma proposition.
Quand on a eu un amant comme Jérém, le sevrage est une épreuve inhumaine.
Quand on se branle, tous les fantasmes semblent à portée de main.
Evidemment, de celui-ci, comme pour d’autres, je n’en fais rien. Car il s’évapore aussitôt mon orgasme passé.
Je regrette de ne pas avoir proposé à Jérém de filmer au moins une fois nos ébats, comme je l’avais envisagé à un moment dans ma tête, après l’achat de mon premier appareil numérique à l’occasion de notre voyage au Québec. A l’époque, l’idée me paraissait bien excitante. Mais je n’ai jamais osé lui en parler, de peur d’essuyer un refus. Je l’avais envisagé pour pouvoir me branler devant ces images lorsqu’il était loin de moi. Mais ça ne s’est jamais fait.
Au fond, c’est mieux ainsi, ça me ferait trop mal de regarder en boucle ce bonheur sensuel perdu.
D’ailleurs, toute image de Jérém me fait mal. Il y a des mois, le premier janvier, en guise de bonne résolution pour la nouvelle année, j’ai rassemblé toutes nos photos papier, j’ai gravé les images numériques et les quelques vidéos sur un cd avant de les effacer de mon ordi et de mon appareil photo. J’ai tout mis dans une boîte à chaussures que j’ai scellé avec beaucoup de scotch, avant de la ranger sur l’étagère la plus haute de mon placard, bien au fond, vers le mur, derrière d’autres boîtes.
Loin de me faire oublier Jérém, ces quelques aventures estivales me rendent le manque encore plus insupportable. Car chez tous ces gars, dans tous ces lits, derrière toutes ces braguettes, dans tous ces boxers, c’est Jérém que je cherche. Son corps, sa queue, sa façon de me faire sentir à lui, sa façon de me faire sentir en sécurité, ses gros bras solides qui ont su pendant un long moment être si rassurants…
Lorsqu’en baisant avec un gars vous pleurez intérieurement le grand absent, lorsque vous vous sentez comme sali par l’amant d’un soir à qui votre corps a dit oui, sans que votre cœur, à mille lieues de là, ait donné son assentiment, lorsque vous avez l’impression que chaque baise vous éloigne un peu plus de celui que vous n’arrivez pas à oublier, qu’elle vous rend un peu plus indigne de lui et de ce que vous avez vécu ensemble, lorsque vous pensez aux beaux jours de l’amour en les comparant avec votre misère sentimentale et sensuelle actuelle, lorsque vous pensez sans cesse au grand absent, lorsque vous criez intérieurement son prénom tout en l’imaginant heureux avec l’autre, alors que votre amant du soir ne vous donne pas le centième du plaisir et du bonheur que vous avez connu avec ce grand absent, voilà, quand tous ces signes se cumulent, c’est que le remède à votre malheur n’est certainement pas baiser à tout va.
Il faut un temps pour le deuil d’un amour. Chaque deuil demande un temps qui lui est propre. Et ce temps est incompressible. Il est inutile d’essayer de le raccourcir avec une ivresse, de quelle nature qu’elle soit. Au mieux, on le reporte. Au pire, on le multiplie.
C’est décidé, je suis fatigué des plans. Time out jusqu’à nouvel ordre.
Fin juillet 2008.
Ça fait déjà plus de six mois, et ça fera bientôt un an, que Jérém m’a quitté, et ma douleur est toujours aussi vive, aussi saillante, elle transperce mon âme de part en part, elle coupe mon souffle par moments.
Au final, ce qui me manque le plus, ce n’est même pas le sexe. Ce qui me manque par-dessus tout, c’est sa présence à mes côtés. Dans ma vie. Savoir qu’il y a quelqu’un qui pense à moi, qui tient à moi. Ce qui me manque, c’est de passer la nuit avec le gars que j’aime, de sentir sa chaleur, son parfum, sa présence rassurante dans le lit, de l’enlacer. Et de le retrouver au réveil, de le retrouver le lendemain et le surlendemain encore.
Non, jamais je ne retrouverai un amant comme Jérém, et encore moins un garçon comme Jérém. Jamais je ne retrouverai la façon qu’il avait de m’aimer. De m’aimer.
Je donnerais tout ce que je possède pour sentir à nouveau sur moi sa tendresse, son amour. Son amour. Pour l’entendre m’appeler « Ourson ».
Et l’imaginer partager ses jours et ses nuits avec un autre, l’imaginer en ménage avec un autre, alors qu’il n’a jamais voulu l’être avec moi, ça me donne le tournis, le vertige.
J’essaie de m’apaiser en me disant que peut-être le milieu du rugby anglais est moins homophobe. Ou alors, qu’en changeant d’air, il s’est senti moins oppressé, plus à l’aise.
Mais au fond de moi, je sais que Rodney a su le mettre en confiance et le rassurer comme je n’ai jamais su le faire.
En dessous de la colère de surface, au fond de moi je vis le fait de m’être fait larguer comme un désaveu, je me dis que s’il m’a quitté c’est que je n’étais pas assez bien pour lui. Et ça fait un mal de chien.
Je pleure le bonheur passé, je désespère d’en connaître à l’avenir, et je me noie dans la peur panique d’une immense solitude qui se profile dans mon horizon.
Début août 2008.
Il fait très chaud en ce mois d’août. L’irrigation bat son plein. Tout comme mon travail de relevé et de contrôle du bon fonctionnement des appareils de mesure.
Un matin, je suis amené à me rendre dans une ferme dont l’accès au comptage est particulièrement compliqué. Par chance, j’arrive à avoir l’agriculteur au téléphone et à lui demander des renseignements. A mon arrivée, il m’attend dans la cour du corps de ferme, et me propose de m’accompagner à la station de pompage.
M. S. a la quarantaine, il est un peu enrobé, mais il n’est pas dépourvu d’un certain charme. Il a aussi un accent, espagnol, sans doute. Un accent qui, ajouté à son nom, confirme ses origines. Sous son marcel informe et son short tâché de terre et de cambouis, et malgré ses bottes en caoutchouc-tue-l-amour, il me semble déceler un ensemble masculin qui, sans vraiment être canon, m’inspire l’envie de la découverte, contre lequel j’aimerais me blottir, par lequel je ne dédaignerais pas me faire posséder. L’arrondi de ses épaules me paraît très sensuel. Parfois, le désir est un tout, et parfois il ne tient qu’à un détail. Parfois, c’est les deux à la fois.
C’est peut-être mon imagination, mais il me semble déceler chez M. S. un regard insistant, traînant. Un regard qui doit ressembler au mien. L’agriculteur m’invite à le suivre. Il monte dans sa vieille 205 blanche et je le suis avec ma camionnette de service.
Une 205, qu’elle soit rouge ou pas, est pour moi une accroche de souvenir. Une madeleine. Un QR code. L’image d’une 205 traverse ma rétine, et je plonge instantanément des années en arrière, dans une époque, le bac et l’été qui a suivi, une rue, la Colombette, un studio, celui de Jérém lycéen, des sensations, celles de mes premiers émois sensuels, des images, le corps de Jérém, sa queue, sa jouissance, des questionnements, est-ce qu’il va continuer à m’appeler pour me baiser ou bien va-t-il bientôt se lasser de moi ? Est-ce que baiser avec ce gars me suffit ou bien j’ai envie de plus ? Est-ce qu’un jour il saura me donner plus ?
Nous arrivons à la cabane de pompage et le réel m’arrache aussitôt aux souvenirs. Pour y accéder, il faut emprunter une descente, et l’homme me propose de monter en voiture avec lui. Je m’exécute et sa proximité dans l’espace clos de la voiture me trouble. Le mélange olfactif qui se dégage de lui, entre la lessive propre et le cambouis, je trouve ça plutôt excitant.
Quelques secondes plus tard, nous arrivons enfin aux compteurs. Je fais mon relevé en quelques instants, enveloppé par le bruit assourdissant des pompes qui tournent à plein régime. Au moment de repartir, je croise le regard de M. S. qui s’attarde sur moi et je n’ai pas envie de repartir. L’endroit est on ne peut plus tranquille, personne ne peut nous surprendre. J’ai envie de lui. Dans le ventre, un frisson intense irradie dans tout mon corps et rend mes tétons hypersensibles contre le coton de mon t-shirt.
Le désir est un bon anesthésiant de la souffrance, de l’angoisse, de la peur. Depuis quelques minutes que je désire cet agriculteur, mes inquiétudes au sujet de Jérém sont comme anesthésiées. Je sais qu’elles reviendront bien assez vite, mais j’apprécie ce répit d’un instant.
J’ai envie de le sucer ici, dans la nature.
Mais l’une des pompes se met à gigoter de façon inquiétante, et le gars est obligé de l’arrêter. D’autres complications surgissent, et je l’entends pester. Et me donner congé, car « il va en avoir pour un moment ». Le moment magique est rompu, son désir éclipsé par la contingence.
Je n’ai pas la présence d’esprit de lui proposer mon aide, et je me résous à remonter la pente à pied, pour aller récupérer ma camionnette. Je me retourne deux fois, mais le gars est désormais dans le canal, l’eau jusqu’à mi-cuisse, les bottes certainement pleines d’eau, en train de sortir la crépine bouchée par le feuillage qui a commencé à tomber à cause de la canicule, toujours en pestant bruyamment.
Je m’éloigne du bel agriculteur – oui, le fait de ne pas pouvoir l’avoir l’a fait passer de désirable à beau – hanté par la frustration d’avoir raté l’occasion de faire se rencontrer nos désirs réciproques. J’aurais pu lui dire que j’avais le temps, ce qui est le cas, car il est mon dernier irriguant de la matinée. Mais je n’ai pas su le faire, et je repars comme un con.
Une fois dans ma voiture, je ne peux me résoudre à la démarrer. Je me dis que je vais attendre que M. S. remonte. Il aura résolu son problème de pompe, et son esprit sera à nouveau disposé au désir. Je lui demanderai à boire, il me fera rentrer chez lui, et je le sucerai dans sa cuisine. Peut-être même qu’il me baisera dans son lit. J’ai désormais très envie, et je me fais violence pour ne pas ouvrir ma braguette et me branler.
J’attends de longues minutes, des minutes insupportables, la trique compressée par mon short, les tétons dégageant des décharges électriques au moindre frottement contre mon t-shirt, la chaleur décuplant mon envie de jouir, saisi par le tournis en imaginant les mots que je lui adresserai quand il remontera, pour lui demander à boire, pour lui proposer de le sucer. Parce que je ne vais pas tourner autour du pot, je vais lui proposer de le sucer, j’ai trop envie, je ne peux pas ne pas exprimer cette envie.
Je guette le bourdonnement de la pompe qui redémarre, et par ricochet des soucis levés. Mais je n’entends que le bruit du vent, ponctué par quelques imprécations du charmant agriculteur.
Ce n’est qu’au bout d’une demi-heure que la 205 blanche remonte enfin. La pompe n’a toujours pas redémarré. A priori, la panne n’est pas résolue. J’ai le cœur qui bat à tout rompre, j’ai la tête qui tourne, le souffle coupé. J’avais prévu de sortir de ma voiture, de l’arrêter, de lui demander un truc à boire. Mais mes jambes n’obéissent pas. Je suis saisi par le doute, plombé par le doute. Et si je me trompais, et si dans ses regards il n’y avait pas de désir ? Est-ce que le besoin irrépressible d’en avoir le cœur net qui ravage mon ventre vaut le risque de me faire jeter comme un malpropre ? Et s’il m’en collait une ? Le bruit des coups et l’odeur du sang de cette horrible nuit où Jérém et moi avons été agressés à Paris surgissent dans mon esprit comme une décharge électrique.
Au fond, s’il ressent du désir lui aussi, il pourrait faire le premier pas. Il est plus âgé que moi, il devrait être plus assuré. Il est plus costaud que moi, il ne devrait pas craindre que je lui en colle une. Je découvrirai plus tard que l’assurance n’a rien à voir avec l’âge, et que la peur du regard, du jugement et de l’attaque verbale est aussi puissante que celle de l’agression physique. Aussi, que si on attend toujours que l’autre fasse le premier pas, on rate bien des occasions.
Pendant que sa voiture passe à côté de la mienne, je le regarde, fixement, intensément. Je croise son regard. Mon cœur est sur le point d’exploser. Le gars a l’air surpris de me retrouver encore là. Il est trempé de la tête aux pieds, et il a l’air contrarié. Non, visiblement la panne à la pompe n’est pas résolue. Et, visiblement, son esprit n’est pas revenu dans des dispositions propices au désir. Il y a également du regret dans son regard, me semble-t-il. Peut-être que, tout comme moi, il en avait envie, mais il n’a pas osé.
Le mec trace sa route, et je le vois accélérer en direction du corps de ferme.
Je le suis, accroché à un dernier espoir, qu’il s’arrête à la maison pour se changer, et que je trouve le courage de le rattraper. Mais je le vois bifurquer sur un chemin de traverse, et disparaître dans le maïs. Dès lors, je sais que c’est foutu pour de bon. Je regagne la départementale et reprends ma route, comme vidé, avec un sentiment de défaite qui plombe mon esprit comme un bloc de granit. Et je retrouve toutes mes angoisses, mes peurs, peur de la solitude, mes larmes. Et l’immense tristesse d’avoir perdu Jérém, le bonheur de ma vie.
Plage de Gruissan, août 2008.
A l’occasion du long week-end de l’Assomption, je viens rejoindre Élodie et sa famille pendant un week-end. J’arrive le vendredi soir et le lendemain Lucie est malade. Un peu de fièvre, rien de grave, mais les parents n’arrivent pas à gérer autre chose que ce petit imprévu. Ils s’occupent d’elle, naturellement. Pour la petite famille, pas question de sortir avec cette chaleur.
Alors, je me retrouve seul sur la plage, sur cette plage où pendant tant d’années j’ai refait le monde avec ma cousine, des après-midis entiers de discussions à bâtons rompus qui ont scellé notre profonde affection, seul sur cette plage où j’ai attendu Jérém, seul sur cette plage où je suis venu avec Jérém, seul avec mes souvenirs, ma solitude, mes larmes.
Heureusement, la plage est aussi ce lieu magique où le Masculin se manifeste dans sa sensualité la plus exacerbée.
Plage de sable fin, mer chaude, soleil brûlant, air de vacances, d’insouciance.
Tri visuel automatique rapide, pointage de bogosses.
Pecs, biceps, poils du torse, casquette portée à l'envers, lunettes de soleil, y compris dans l'eau.
Ôter casquette, cheveux mouillés, ruisselants, en bataille.
Autour du cou, une chaînette brillante, nonchalamment posée, sexy à mort.
A la lisière de l’élastique du short de bain, poils mouillés bien alignés en direction du nombril, d’autres bien plus insolents, noirs et saillants.
Corps ruisselants d’eau salée, peau luisante, tentante. Tétons saillants, durcis par la fraîcheur de l’eau.
Sourires, jeux entre potes. Jouer au ballon dans l’eau, coups de tête, de main, de pied, tout est permis, surtout s’amuser entre potes joueurs.
Envie d’un, deux, dix garçons.
La mer, la plage, théâtre parfait pour apprécier les moindres détails, les infinies délices du Masculin.
Toujours août 2008.
Un soir, mon téléphone sonne.
Pendant un instant, je crois à l’Impossible. Lorsque je regarde l’écran de mon portable, je réalise que ce n’est pas CET impossible, mais un impossible quand-même. Un improbable, du moins.
— Salut, Nico ! j’entends Charlène me lancer.
Dans sa voix, j’ai l’impression de déceler l’intention de se montrer à la fois avenante et compatissante, comme vis-à-vis d’un malade ou d’un malheureux avec qui on ne sait pas vraiment quelle posture adopter. Un numéro d’équilibriste dans lequel elle ne se débrouille pas mal.
— Ça va, je mens.
— C’est un petit « ça va », ça…
— Tout petit, oui. Disons que j’ai connu des jours meilleurs.
— J’imagine bien.
— Ceux que j’ai passé à Campan, chez toi, par exemple, étaient bien meilleurs… ils étaient parmi les plus heureux de ma vie.
— Tu n’arrives pas à l’oublier…
— Il me manque à en crever !
— Il me manque aussi.
J’imagine bien à quel point Jérém doit manquer à Charlène aussi. Et je n’arrive pas à retenir mes larmes.
— Oh, Nico, ne pleure pas, sinon je vais pleurer aussi !
— C’est tellement dur !
— Tu n’as pas de vacances devant toi ?
— Si, j’ai deux semaines début septembre.
— Tu as prévu quelque chose ?
— Pas vraiment.
— Viens quelques jours à la maison… enfin… si ça te dit.
— C’est gentil, mais je ne sais pas si c’est une bonne idée…
— Il n’y a pas que Jérémie qui nous manque, tu sais ? Tu nous manques aussi, Nico. Tout le monde me demande de tes nouvelles, tout le monde est triste pour toi. Viens quelques jours, on se fera quelques bons repas et on pourra parler tranquillement.
— Je ne sais pas.
— Quand plus rien ne va, elle me glisse calmement, il reste les amis dans la vie.
Samedi 30 août 2008.
Aujourd’hui, je file vers Campan. Je parcours la même route que j’avais empruntée la première fois où je m’y étais rendu il y a sept ans, jour pour jour. La route qui quitte la « quatre voies », celle qui traverse les villages, celle qui passe par Saint Martory, celle qui laisse admirer le changement progressif d’architecture entre la plaine et la montagne.
Je refais la route qui, ce jour-là, devait m’amener au premier baiser de Jérém après le clash chez moi quelques semaines plus tôt. Je refais la route qui devait m’amener à nos retrouvailles magiques sous la halle en pierre frappée par une pluie ruisselante. Je refais la route qui devait m’amener à l’amour de Jérém.
Il y a sept ans, la pluie était battante. Aujourd’hui, c’est la fougue du soleil de l’été qui joue les prolongations, et elle est tout aussi insistante. Mais je sais que septembre est là, que la rentrée va arriver, que l’été est en train de s’en aller, comme mon bonheur perdu.
En voyant les panneaux « Campan », mon cœur a des ratés. Les larmes, elles, ne me ratent pas. En passant devant la halle en pierre léchée par les rayons orange du couchant, je chiale comme une madeleine. Pendant un instant, je pense à m’arrêter pour aller faire un petit coucou à Martine dans sa supérette. Mais je n’en ai pas l’énergie, je trace tout droit vers le centre équestre de Charlène.
Enfin, c’est ce que je voudrais faire. Je voudrais savoir résister à l’appel de cette bifurcation sur la droite qui m’appelle tel un chant des Sirènes. Mais je n’y résiste pas. Je m’y engouffre, sans savoir vraiment pourquoi, en sachant pertinemment que je ne vais rien trouver de l’ancien bonheur dont la petite maison dans la montagne a été le théâtre. Et que dans ce lieu chargé de symbolique pour moi, je ne vais trouver que la tristesse sans fond de ma nostalgie.
La réalité est encore plus triste que celle que j’avais imaginée. La petite maison n’est pas seulement vide, pas seulement à l’abandon. Elle a été violée. La porte d’entrée a été salement fracturée et l’intimité du foyer est désormais accessible à tout regard, à toute intrusion. Mon cœur se fracture lui aussi un peu plus. La cheminée éteinte paraît morte. Le lit où nous avons fait l’amour, est en vrac, la table où nous avons mangé a été utilisée pour un banquet alcoolisé, comme en témoignent des bouteilles abandonnées. Visiblement, la petite maison dans la montagne a été squattée par des visiteurs indélicats. Tout est en vrac, tout est sale. Je m’assois sur le bord du perron et je fonds en larmes.
Chez Charlène, rien n’a changé ou presque. Même si la patronne a cédé son affaire à Jérém et passé la main à une nouvelle gérante, il y a toujours des chevaux dans les prés, il y a toujours son sourire accueillant et son regard profondément bienveillant.
Il y a toujours du feu dans la cheminée, du thé et des cookies maison. Et des mots qui réconfortent.
Charlène est au courant de ce qui s’est passé à la petite maison, « l’œuvre d’une poignée de petits cons », comme elle le dit, et ça la rend triste elle aussi.
— Jérém est au courant ? je la questionne.
— Oui, je lui en ai parlé. Il a dit qu’il s’en occupera à Noël.
— Il compte venir ici ?
— Je ne sais pas, c’est pas sûr… elle bafouille en réalisant s’être aventurée par mégarde sur un terrain miné.
— Dis-moi !
— J’en ai déjà trop dit, de toute façon.
— Exactement !
— Oui, il m’a dit qu’il viendrait.
— Avec… l’autre ?
L’ « autre » est le nom qu’on donne à celui qu’on ne veut pas nommer, le fossoyeur de notre bonheur, pour nous donner l’illusion qu’on peut lui refuser le droit d’exister tout simplement en refusant de l’appeler par son vrai prénom.
— Oui, avec Rodney.
Je lui ai demandé de la franchise, j’en ai pour mon argent. Comme une droite en pleine gueule. Ainsi, Rodney compte assez pour Jérém pour être, lui aussi, « éligible » à l’univers magique de Campan, il compte assez pour avoir le droit de faire connaissance avec ses racines, avec ses amis cavaliers, avec ses chevaux. J’aurai été le premier, mais bientôt je ne serai plus le seul. La venue de Rodney va sceller officiellement la fin de notre histoire. Quand nos amis communs auront vu « l’autre », ils sauront que c’en est vraiment fini de Jérém et Nico et ce sera acté pour de bon.
— Il va bien ? je lui demande, comme assommé par la nouvelle, arrivant tout juste à respirer.
— Il me semble que oui.
— Il est heureux ? Parce que moi, je suis malheureux, je n’ai jamais été aussi malheureux !
— Tu sais, Nico, Jérémie s’en veut de t’avoir fait du mal. Malgré tout ce qui s’est passé, il tient toujours énormément à toi.
— Ça me fait une belle jambe qu’il tienne à moi alors qu’il couche avec un autre !
— Nico !
Pendant le week-end que je passe à Campan, j’ai l’occasion de retrouver Bille, Tzigane et Unico, les équidés de Jérém. J’ai l’impression qu’ils me reconnaissent et qu’ils savent le pourquoi des larmes chaudes que leur présence fait couler sur mes joues.
J’ai aussi l’occasion de refaire un tour à cheval en petit comité avec Charlène, Martine, Jean-Paul et Carine. De retrouver l’odeur de sous-bois humide, d’automne imminent. De retrouver les souvenirs chargés de nostalgie de nos séjours à Campan, des balades à cheval, des soirées avec les amis cavaliers, de cet instant jour où Jérém m’a serré dans ses bras devant la grande cascade à Gavarnie. Du soir où il m’a embrassé devant tout le monde.
Mais aussi de retrouver la sagesse de Jean-Paul, la fraîcheur de Carine, les rires de Martine et de Charlène, l’odeur rassurante d’un bon feu de cheminée, d’une potée qui cuit pendant des heures et qu’on partage avec les amis les plus proches, et le sourire éclatant des étoiles, si belles, si pétillantes à la montagne.
Pendant tout le week-end, Charlène s’occupe de moi comme une mère, une deuxième mère qui sait précisément ce que je traverse et qui sait trouver les mots, les gestes, la chaleur humaine qu’il faut pour me réconforter.
Je suis revenu à Campan, j’ai naufragé vers Campan, j’ai échoué à Campan.
Et après ce week-end, je me sens comme un convalescent remis sur pied après un traitement de choc. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et mes amis les ont essuyées. Charlène a raison. Quand tout va mal dans la vie, quand tout semble perdu, une seule chose demeure, les amis, les vrais, ceux qu’on peut compter sur les doigts d’une main. Un ami c’est comme la famille, l’excès de pudeur qui inhibe les échanges les plus intimes en moins.
En revenant vers Toulouse, j’ai l’impression que ma vie a enfin retrouvé quelques couleurs.
Septembre 2008.
La semaine après mon week-end à Campan, mon téléphone se met à déconner. Vu son âge, un remplacement s’impose. J’aimerais prendre l’un de ces nouveaux appareils qu’on appelle désormais les smartphones, mais ils sont hors de prix et il me semble que je n’en aurais pas l’utilité. Alors, j’opte pour un nouveau modèle à clapet au design épuré.
Suite à une fausse manipulation, j’efface l’intégralité de la mémoire de mon ancien téléphone, contacts et sms. Je m’en veux à mort. Je tente le tout pour tout, je l’apporte même chez un réparateur. Mais il n’y a rien à faire, tous les échanges avec Jérém sont irrémédiablement perdus. Des messages que je n’ai pas consultés depuis des mois, mais dont la présence, inscrite à la fois dans ma mémoire consciente et dans celle subconsciente, constituait l’un des seuls piliers qui m’empêchait de m’effondrer.
Les messages pleins des délicieuses fautes d’orthographe de Jérém perdus, je me sens encore un peu plus éloigné de lui, encore un peu plus seul, encore un peu plus triste et inconsolable.
Mais si sur le coup cet accident numérique constitue un choc, dès le lendemain il sait se métamorphoser en électrochoc salutaire. Le déclic qu’il me fallait pour commencer réellement à tourner la page, à aller de l’avant, et prendre un nouveau départ.
Un nouveau départ qui passe par un nouvel appart. J’adore mes parents, depuis des mois, des années, ils m’entourent sans être intrusifs, ils tissent autour de moi un cocon qui m’aide énormément à tenir le coup. Mais je sens que j’ai besoin de prendre mon indépendance. J’ai besoin d’avoir un chez moi. Je dois avancer dans ma vie, je dois vivre ma propre vie. Si un jour je rencontre un gars, je ne peux pas l’amener dans ma chambre d’enfant, avec les parents qui dorment au fond du couloir.
— Tu es sûr que tu es prêt ? Rien ne presse, tu sais… me glisse Papa lorsque j’expose mon projet à table, à l’heure du dîner.
— Je n’en ai aucune idée, mais j’ai envie d’essayer.
— Tu es un homme maintenant, mon fils, c’est toi qui sais ce qui est bon pour toi.
Maman est triste que j’envisage de quitter à nouveau le cocon familial, car elle sait pertinemment que cette fois-ci ce sera pour de bon et que je ne reviendrai pas.
— Je ne pars pas loin, tu sais, je vais rester à Toulouse, je tente de la réconforter.
— Mais tu pars quand même. C’est dans l’ordre des choses, je sais, ça s’appelle « grandir ». Mais je sais déjà que tu vas me manquer.
Moins de deux semaines plus tard, la veille de mon anniversaire, l’agence immobilière me remet les clefs du charmant petit appartement qu’elle m’a déniché à Labège, vraiment pas loin de mon travail.
En contemplant cet appart encore vide où chaque petit bruit résonne contre les murs nus, je fais un parallèle avec ma vie. Une nouvelle page blanche s’ouvre à moi, une page dont ces pièces et ces murs vides sont une excellente représentation, et j’aime l’idée de l’ouvrir dès demain, de remettre les compteurs à zéro, pile le jour de mon anniversaire. Mais avant d’aborder cette nouvelle page et de commencer à la remplir avec de nouveaux magnifiques couleurs, je dois clôturer l’ancienne.
Et pour ce faire, il faut que j’arrive enfin à accepter que Jérém soit heureux sans moi. Je dois apprendre à l’être sans lui.
15 septembre 2008.
Aujourd’hui, j’ai 26 ans. Aujourd’hui, j’ai reçu des sms et des coups de fil d’amis voulant me souhaiter bon anniversaire. Mais les vœux les plus attendus, ceux que j’espérais depuis des mois, ceux qui représentaient tant de choses à mes yeux, ceux dans lesquels je ne croyais pas vraiment, tout en les espérant de toutes mes forces, de toutes mes tripes, ne sont pas venus. Je les ai attendus jusqu’à ce que mon téléphone affiche « 16 septembre 2008 ». Et j’ai fondu en larmes.
20 septembre 2008.
C’est aujourd’hui que Madonna vient à Paris pour la première des deux dates consécutives au Stade de France. En pénétrant dans l’immense enceinte, j’ai l’impression d’entendre les acclamations de la foule des 80000 spectateurs des grands matches. Combien de fois, je suis venu voir Jérém jouer dans cette enceinte. J’ai l’impression qu’il pourrait être là, dans la pelouse, au milieu des milliers de fans attendant l’arrivée de la Star.
Ce soir, Jérém me manque horriblement. Il y a deux ans, j’avais partagé cette expérience avec lui. Certes, ce n’était pas dans ce lieu, c’était à Bercy, et il avait vraiment aimé. Je me souviens m’être dit qu’on en partagerait d’autres, des concerts de Madonna, lui et moi. Hélas, ce ne sera pas le cas.
Comme les albums, les tournées marquent des périodes de ma vie.
Le Drowned World Tour de 2001 était la bande son de mes escapades nocturnes vers l’appart de la rue de la Colombette. C’est aussi le souvenir de mon premier concert de Madonna, à Londres, de cette folle virée avec ma cousine, de cette époque d’insouciance.
Le ReInvention Tour de 2004 est lié au souvenir de la plus belle période avec Jérém, après son accident au rugby et son rétablissement, cette période où notre amour semblait si fort, intarissable.
Le Confessions Tour de 2006 était le moment de la « rencontre » entre la Star de ma vie et l’Homme de ma vie. Notre amour vivait ses derniers jours, mais nous l’ignorions, et nous étions si heureux !
L’ambiance est folle dans l’immense enceinte. La Star se fait attendre, mais lorsqu’elle apparaît enfin, tout s’embrase. Le concert est très travaillé, très esthétique. Mais le cadre très inadapté. Dans un si grand espace, le visuel est frustrant, malgré les grands écrans, et le son est vraiment, vraiment mauvais.
Et ça gâche l’expérience tout entière. Quand je compare le concert de 2006 avec celui de ce jour, le verdict est sans appel. Sur le papier, un stade est un choix de prestige, qui montre à quel point l’artiste sait fédérer. Dans la pratique, c’est le pire endroit pour assister à un concert.
Au final, cette soirée est une grosse déception. Non pas à cause de la prestation de l’artiste, mais à cause de l’endroit choisi. Vivement le DVD !
16 octobre 2008.
Jérém a 27 ans. Si le beau brun a oublié mon anniversaire (ou bien il a fait exprès de ne pas me le souhaiter pour garder de la distance entre nous), moi je n’oublie pas le sien. Je n’ai plus son numéro et pendant toute la journée la tentation est forte à chaque instant d’appeler Maxime pour le lui redemander. Mais je me fais violence, de plus en plus violence au fil des heures, de plus en plus de violence jusqu’à ce qu’il ne soit plus temps, jusqu’à ce que mon téléphone, que je fixe depuis des heures, affiche enfin « 17 octobre 2008 ».
Automne 2008.
En ces derniers jours du mois d’octobre, seul dans mon appart, la tristesse, la mélancolie, la nostalgie, les larmes me rattrapent de plus belle. J’ai enfin un chez moi, je pourrais voir qui je veux quand je veux, et pourtant, je n’ai envie de voir personne. Personne, même pas des mecs pour des plans.
En dehors de mon taf et des courses, je me terre dans mon deux pièces, je broie du noir. J’en viens même à me demander si ça a été vraiment une bonne idée d’aménager seul, alors que je ne suis toujours pas guéri de ma rupture, alors que le manque leste mon cœur, écrase mon âme, noue mes tripes.
Octobre 2008.
Oui, en ces derniers jours du mois d’octobre de celle qui a été la deuxième pire année de ma vie ex-aequo avec celle qui l’a précédée, je me noie à nouveau dans cet abîme de tristesse désormais bien familier. La chaleur humaine de Campan est déjà lointaine, et la « couverture », l’état de grâce que cette piqûre de rappel contre la morosité m’avait apporté s’estompe jour après jour.
Alors, je dérive à nouveau et plus que jamais dans cette lutte impossible contre l’inéluctable, la perte de l’amour de ma vie, une perte que ma raison et mon cœur refusent, à laquelle ils n’arrivent pas à se faire, une perte inconcevable, inacceptable, insupportable.
C’est à ce moment que le vent d’Autan recommence à souffler. C’est à ce moment, lorsque je suis à nouveau au plus mal, qu’un ange tombé du ciel revient dans ma vie. Le hasard a fait que tous deux avons choisi d’aller voir le même film, plusieurs semaines après sa sortie, dans la même salle de cinéma, et à la même séance.
C’est après deux heures passées à suivre les pérégrinations de Meryl Streep sur une île grecque tout en chantant du ABBA a tout va, après avoir attendu religieusement, lui comme moi, à des emplacements plutôt éloignés dans la salle, que le fondu au noir et le silence tombent après les titres de fin, et que les lumières se rallument, c’est au moment de quitter la salle que nous nous croisons, que nous tombons littéralement l’un sur l’autre. Je m’arrête pour le laisser passer, il insiste pour me laisser passer. Je le regarde, je le reconnais.
Il n’a pas changé, il est toujours aussi gentil garçon. Et soudain, mon cœur s’emplit de bonheur, comme lorsqu’on rencontre un visage familier après s’être longtemps égarés dans un désert ou une forêt. 21 commentaires
21 commentaires
-
Par fab75du31 le 30 Juin 2023 à 20:47
Automne 2007.
Il y a des garçons, comme lui, dont la simple présence nous explose violemment à la figure au premier instant. Elle nous interpelle, car elle fait vibrer toutes nos cordes sensibles à l’unisson.
Il y a des yeux, comme les siens, qui nous happent, nous aspirent, nous étourdissent. Des yeux dans lesquels on se noie au premier regard. Et les siens sont bleus, fabuleusement, scandaleusement bleus.
Je ne parle pas d’un bleu azur, ni d’un bleu gris. Je veux parler d’un bleu profond, intense, déroutant, un bleu d’océan qui fascine, émeut, envoûte, remue les tripes d’une façon presque douloureuse. Un bleu qui ressemble à une promesse, celle d’une infinie douceur, celle d’un bonheur sans limites. Un bleu qui fait tout bonnement chavirer l’esprit.
Précédemment, dans Jérém&Nico :
Après des révisions pour le bac tout aussi intensément sexuelles que sentimentalement houleuses, un premier clash s’était invité entre Jérém et moi et nous avait conduits à une première, violente séparation.
Puis, des retrouvailles magiques à Campan nous avaient permis de nous dire notre amour et de l’assumer sous le regard bienveillant des cavaliers de l’ABCR.
Hélas, après cette parenthèse enchantée, la géographie s’était chargée de compliquer la relation entre mon beau brun et moi. Sa carrière professionnelle au rugby l’avait amené à jouer à Paris, tandis que mes études m’avaient fait atterrir à Bordeaux.
Mais la géographie n’était pas le seul obstacle qui s’était interposé entre nous, et certainement pas le plus insurmontable. Mon désir de nous voir régulièrement et d’avoir une vie de couple s’était vite heurté à la nécessité de discrétion du sportif professionnel. Le monde sportif n’est pas un environnement propice à assumer une attirance pour les garçons. En gros, le choix est imposé entre une carrière professionnelle et l’épanouissement personnel. Très dur à gérer quand on a vingt ans.
Cette situation a eu de lourdes répercussions sur notre relation, nous amenant à des prises de tête, à des éloignements qui ressemblaient à des ruptures, et à des jours bien sombres.
Oui, j’en ai voulu à Jérém de ne pas assumer notre relation, mais j’ai fini par m’y faire. C’était la condition nécessaire pour ne pas le perdre.
Puis, l’accident était survenu. Devant les caméras, mon beau brun avait été fauché par un joueur indélicat. Et une méchante blessure au genou avait mis en sérieux péril la suite de sa carrière.
Il s’ensuivit des mois difficiles, des mois pendant lesquels j’étais resté à ses côtés malgré sa négativité, son agressivité, et son apparente ingratitude.
Mais Jérém avait fini par surmonter cette épreuve. Il avait également réalisé à quel point je m’étais dévoué pour lui et il avait fini par m’en remercier. Il me semble que cela avait provoqué un déclic dans sa tête, un déclic qui l’avait amené à assumer davantage notre relation.
A partir de son retour sur le terrain après l’accident, Ourson et P’tit Loup avaient enfin évolué en parfaite harmonie. En témoignent nos vacances en Italie, en Islande, au Québec, en France, nos séjours chez mes parents ou dans le domaine viticole de son père.
Nous avions trouvé un rythme de croisière qui nous allait à tous les deux, et rien ne semblait pouvoir nous ravir notre bonheur. Hélas, il a suffi qu’un soir on baisse un peu notre garde, il a suffi d’un baiser échangé dans une rue de Paris, pour que tout bascule.
L’agression homophobe dont nous avons été victimes le soir de ses vingt-cinq ans a sonné le début de la fin de l’« épopée » d’Ourson et P’tit Loup. Elle a marqué la fin de notre bonheur.
Ça a été difficile de surmonter cette violence, cette injustice, cette haine gratuites et injustifiées. Et ça l’a été d’autant plus pour Jérém qui, suite à cette agression, a été outé dans le milieu sportif.
Jérém a subi la double peine, celle de se faire agresser parce qu’homo, et celle de voir sa carrière lui échapper pour cette même raison.
Oui, mon beau brun a eu beaucoup plus de mal que moi à remonter la pente. Une fois de plus, il s’est renfermé sur lui-même, et cela l’a éloigné de moi. Quand Jérém va mal, il fait le vide autour de lui. Et cette fois-ci, il allait vraiment mal.
Même plusieurs mois passés en Australie pour changer d’air, bien que riches en expériences en tout genre, n’ont pas suffi par faire revenir l’ancien Jérém, le Jérém assuré, bien dans ses baskets, confiant en l’avenir. Et amoureux.
A son retour, il m’avait invité dîner dans un resto de la Ville Rose. C’était le 23 août 2007. Puis, il m’avait proposé d’aller marcher sur les quais de la Garonne. Et il m’avait annoncé son intention de quitter le rugby professionnel. Il estimait en effet qu’il ne se sentirait plus jamais à l’aise sur un terrain ou dans un vestiaire.
Après que je lui ai opposé qu’il ne serait pas heureux en renonçant au rugby, il avait fini par m’avouer qu’il avait une opportunité de jouer en Angleterre. Mais qu’il ne souhaitait pas la saisir pour autant. Et qu’à la place, il se contenterait d’un emploi de commercial à Paris.
— Pourquoi tu ne veux pas donner suite à la proposition de l’équipe anglaise ? je l’avais alors interrogé.
— Parce que je n’en ai pas envie !
— Je vois bien que tu crèves d’envie de rejouer et de foutre le camp d’ici !
Puis, au prix d’un effort dont je ne me serais pas cru capable, je lui avais lancé :
— Si tu restes pour moi…
— Arrête, Nico ! il m’avait coupé net.
— Ecoute moi, Jérém. Si tu restes pour moi, c’est pas le bon choix. Tu vas te rendre malheureux et tu vas nous rendre malheureux.
Et là, après un silence qui m’avait paru interminable, je l’avais entendu me glisser, la voix pleine d’émotion :
— Et nous deux ?
J’avais alors repensé aux mots du pauvre M. Charles de l’hôtel à Biarritz, à son regret de ne pas avoir suivi l’amour de sa vie au bout du monde. Et je lui avais balancé, sans hésiter un seul instant :
— Emmène-moi avec toi !
— Nico… ici tu as un travail qui te plaît, tu as ta famille, tes amis. Tu ne vas pas quitter tout ça pour venir avec moi.
— Je peux le faire, il suffit que tu en aies envie.
— Je ne suis même pas certain que ça marcherait là-bas, je ne peux pas te demander de me suivre alors que je ne sais pas où je vais.
— L’Angleterre n’est pas à l’autre bout du monde, nous trouverons le moyen de nous voir, j’étais arrivé à articuler de justesse, alors que les larmes coulaient déjà sur mes joues.
Jérém m’avait pris dans ses bras, m’avait serré très fort contre lui et m’avait chuchoté, les lèvres très près de mon oreille :
— Je t’aime, Ourson. Et je crois bien que je ne t’ai jamais autant aimé qu’à cet instant.
— Ne m’oublie pas, Jérém, je lui glisse, comme une bouteille à la mer, comme une prière.
— Je ne sais pas encore si je vais accepter, je dois y réfléchir.
— Quoique tu décides, ne m’oublie pas !
— Ça, ça ne risque pas. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivé dans la vie. Tu seras toujours avec moi ! Je ne t’oublierai jamais ! Jamais !
Et, ce disant, il avait glissé ses doigts dans l’ouverture de sa belle chemisette, il avait saisi la chaînette que je lui ai offerte pour ses vingt ans et il me l’avait montrée.
Je me souviens que pendant que nous remontions vers la place du Capitole, je sentais l’air frais de la nuit caresser ma peau. Il m’apportait un étrange frisson, une sensation de vide, de manque, de déchirement. Jérém était encore là, il marchait à côté de moi, mais j’avais l’impression qu’il était déjà loin. J’avais l’impression que j’étais en train de vivre un adieu.
Automne 2007.
Je suis sur la plage, nous sommes seuls sur la plage. Il fait beau, mais la chaleur n’est pas étouffante. Le bruit du ressac est une douce musique qui berce mon esprit. Une légère brise caresse ma peau, éveille mes sens. Tout comme le fait ce garçon, un petit dieu à la peau mate et au t-shirt blanc bien ajusté à sa plastique de rugbyman, qui vient de se glisser sur moi.
Je sens le poids de son corps sur le mien, la chaleur de sa peau contre la mienne, la puissance de sa musculature, l’intensité de sa virilité qui m’enveloppe. Je suis bouleversé par sa sexytude, sa sensualité, sa fougue. L’intensité du désir qu’il m’inspire ravage mes entrailles. J’ai envie de lui à en crever.
Il m’embrasse longuement, me laissant me consumer dans mon désir proche de la folie.
Son t-shirt finit par voler, et le bogoss par venir en moi. Je le regarde, le torse bien droit, envoyer ses coups de reins réguliers, ni trop lents ni trop rapides, juste comme il faut pour m’offrir le plus intense des plaisirs. Celui qui prend sa source entre mes fesses, embrasées par la présence de sa queue, et qui irradie dans tout mon corps.
Mais le plaisir est aussi dans mes yeux, car regarder un si beau garçon prendre son pied, en moi qui plus est, constitue une bien bonne idée du bonheur. Je suis hypnotisé par l’ondulation de ses reins, de son corps tout entier. Je suis fasciné par les expressions du plaisir qui traversent son visage. Je suis follement excité par le souffle de sa respiration, par ses ahanements qui se mélangent au va et vient des vagues.
Et je suis intrigué par son plaisir, je guette les signes annonçant son orgasme, à la fois impatient de le voir arriver, comme le plus beau et éphémère des feux d’artifices, et redoutant son arrivée, synonyme de fin de cette séance de bonheur sensuel.
Le plaisir est également dans la paume de mes mains, au bout de mes doigts, quand je cède à l’envie brûlante de tâter ses biceps, ses pecs, ses abdos.
Il est aussi sur mes lèvres, et partout ailleurs sur ma peau où le bogoss a envie de poser les siennes de temps à autre.
Il est sur ma peau, là où ses mains, ses abdos, ses pecs décident de se poser, de frôler, de caresser au gré de son excitation.
Faire l’amour avec Jérém a toujours été un feu d’artifice. Il a toujours été principalement actif, et moi passif. Nous avons parfois inversé ces rôles. Mais il est clair que nos anatomies ont été conçues pour s’emboîter de cette façon, Jérém en moi avec bonheur, et moi l’accueillant avec tout autant de bonheur.
Son orgasme finit par arriver. Ses coups de reins ralentissent, s’espacent, jusqu’à se synchroniser avec les contractions involontaires de son visage, elles-mêmes calées sur le rythme des giclées chaudes qu’il est en train de décharger en moi.
Jérém vient de jouir et…
Et je me réveille en sueur et en moiteur, seul dans mon lit, la queue raide serrée entre mes doigts. Et je ne peux que continuer de me branler pour évacuer cette trique, tout en essayant de revenir dans le rêve, tout en essayant d’imaginer très fort qu’il soit là, avec moi, en moi. Si je me concentre très fort, pendant que je me branle, j’ai l’impression que ma rondelle se souvient de son gabarit, de ses va-et-vient.
Pendant le temps de l’excitation, c’est le Jérém bon baiseur qui me manque affreusement. Son corps, sa queue, son plaisir, son jus.
Mais après avoir joui vient la tristesse, l’abattement, les larmes. Parce que, désormais, c’est P’tit Loup qui me manque, sa présence, son sourire, notre tendresse, ma moitié. A deux, on est plus forts. Seul, je me sens perdu.
Comment il me manque, ce garçon !
Septembre 2007
Et Jérém a bien fini par partir jouer en Angleterre. Je ne sais pas combien ma bénédiction a pesé dans sa décision. Je ne sais pas à quel point il était prêt à renoncer au rugby, à se rendre malheureux pour ne pas s’éloigner de moi, de nous. Je n’ai pas voulu le savoir, je n’ai pas voulu le rendre malheureux. Ça n’aurait servi à rien, je l’aurais perdu quand-même. Il n’y a rien de plus triste qu’un oiseau en cage. J’ai pris sur moi, j’ai ouvert la porte, et je l’ai invité à prendre son envol.
Alors, après un instant d’hésitation, il l’a pris. Jérém est parti pour Londres quelques jours à peine notre soirée à Toulouse.
Il ne m’a pas prévenu, on s’était tout dit au bord de la Garonne lors de ce fameux soir après son retour d’Australie. Il n’aurait servi à rien de reparler de ça, de nous redire adieu. Ça aurait surtout été trop dur.
J’ai respecté son souhait de ne pas rendre les choses encore plus difficiles. Je me suis fait violence, je ne l’ai pas appelé non plus. Ça a été dur, mais j’ai tenu bon.
Son départ, je l’ai appris dans la presse sportive.
Samedi 15 septembre 2007.
Je n’ai eu de ses nouvelles que trois semaines plus tard, le soir de mon anniversaire. Car, à ma grande surprise au vu de son silence depuis cette fameuse soirée, il ne l’a pas oublié. Son coup de fil m’émeut aux larmes, j’en ai le souffle coupé.
Jérém me parle de son installation en Angleterre, il a l’air enthousiaste, je suis heureux pour lui. Mais il me manque à en crever. Le moral remonté à bloc par ce coup de fil inattendu, je me surprends à espérer à nouveau. J’essaie d’envisager un week-end à Londres pour son anniversaire dans un mois.
Mais mes espoirs sont vite douchés, car Jérém ne semble pas très chaud à l’idée, prétextant des entraînements particulièrement intenses en vue de son premier match à venir prochainement.
J’ai l’impression de revivre les premières semaines de son installation à Paris cinq ans plus tôt, lorsqu’il était tout absorbé par sa nouvelle vie, au point de ne plus vraiment avoir de place pour moi.
— Tu me manques !
— Toi aussi tu me manques.
— Je t’aime, P’tit Loup !
— Je te rappelle dès que possible, promis.
Je note qu’Ourson ne fait plus partie de son vocabulaire. Et que les trois petits mots qui mettent un garçon complètement à nu et qui appellent les mêmes en retour, n’ont pas généré la réaction attendue.
J’essaie de m’accrocher à sa promesse pour me rappeler de ne pas me noyer dans une tristesse sans fond. Mais ça ne suffit pas. C’est quoi, c’est quand, « dès que possible » ?
Le soir de mes 24 ans, j’ai très envie de pleurer.
Octobre 2007.
Pendant des jours et des semaines j’attends son coup de fil, en vain. J’essaie aussi de l’appeler. Je tombe immanquablement sur son répondeur. Je n’ai en retour que de rares messages me répétant qu’il est très occupé et me promettant qu’il me rappellerait toujours « dès que possible ».
Mais les semaines passent, et c’est toujours silence radio. Pire que ça, début octobre, il arrête carrément de répondre à mes messages.
Je vis très mal cette période, j’ai le sentiment que je suis en train de le perdre, de perdre l’amour de ma vie, à tout jamais. Je me dis qu’il va m’oublier, que c’est fini, vraiment fini, pour de bon.
Pourquoi m’avoir appelé pour me souhaiter bon anniversaire si c’est pour me laisser tomber comme une merde juste après ?
Je dors très difficilement, au boulot je ne suis pas concentré. J’enchaîne les boulettes. Je finis par me faire rappeler à l’ordre par ma responsable.
Je suis très malheureux. La seule chose qui me donne un peu de réconfort est de savoir Jérém heureux. Enfin, j’espère qu’il est heureux. Je suis content de l’avoir poussé à saisir cette opportunité.
Pour être honnête, je suis partagé entre le bonheur de savoir qu’il a une possibilité de s'en sortir et la tristesse de contempler des milliers de bornes supplémentaires nous séparer.
Je pleure son absence à chaudes larmes. Et je finis par cesser d’envoyer des messages qui demeurent sans réponse. Ça ne sert à rien de le harceler. L’attente à chaque fois déçue m’est de plus en plus insupportable.
Mardi 16 octobre 2007.
Aujourd’hui, Jérém a 26 ans. Pour son anniversaire, je compose son numéro pour la première fois depuis des semaines. Et là, une surprise m’attend. Mais pas le genre de surprise qu’on aime recevoir.
Son numéro composé, au lieu de tomber sur la tonalité bien connue avant d’arriver éventuellement jusqu’au répondeur, je tombe direct sur une voix féminine enregistrée qui m’annonce :
« Le numéro que vous avez composé n’est pas attribué ».
Un vertige incontrôlable se saisit instantanément de mon esprit. J’ai l’impression que tout s’effondre autour de moi.
Je relance la numérotation, et je tombe à nouveau sur la pouffe enregistrée. J’appelle aussitôt Maxime pour savoir s’il a des nouvelles de son grand frère.
— Jérém ne va pas très fort en ce moment. Il a du mal à s’intégrer dans l’équipe et à s’adapter au rugby anglais. Il n’a pas encore joué et il ne sait pas quand il va jouer. Il est très remonté…
Maxime me passe également le nouveau numéro de portable de son frère, un numéro commençant par « 0044 ». Un numéro étranger, qui matérialise un peu plus encore la distance entre Jérém et moi.
Je prends une respiration profonde, je retrouve un instant de lucidité. Au fond, c’est logique, Jérém réside désormais au Royaume Uni, normal qu’il ait troqué son numéro français par un numéro anglais. Ce qui me rend triste, triste comme les pierres, c’est qu’il n’ait pas pensé à me le dire, comme s’il avait voulu marquer encore plus cette nouvelle distance entre nous. Sans le fil invisible représenté par une ligne téléphonique, il n’y a plus aucun lien entre Jérém et moi.
Je suis triste et déçu, mais je ne baisse pas les bras pour autant. Aussitôt après avoir raccroché avec le frère cadet, j’essaie d’appeler l’aîné. La tonalité anglaise, plus nerveuse et aiguë que la française, pique mes oreilles et remue mes tripes jusqu’à que le répondeur prenne le relais.
— The customer you’ve dialed is not available at the moment. Please hung up and try again.
« Le client que vous avez appelé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez raccrocher et réessayer ».
Zut, alors, je n’ai même pas droit à la voix de Jérém, mais à celle d’une autre pouffe, une english pouffe, enregistrée.
Je réalise à quel point ça me manque d’entendre sa voix. Ça fait bien trop longtemps qu’elle n’a pas caressé mon oreille et fait vibrer mon esprit. Au cours de l’été, pendant son voyage en Australie, j’ai regardé en boucle les quelques vidéos faites avec mon appareil photo numérique au Québec, j’ai pleuré devant ces images, devant sa présence, son sourire, sa voix.
Mais depuis notre soirée à Toulouse, j’ai cessé de les regarder. J’ai cessé quand j’ai commencé à craindre et à croire qu’entre Jérém et moi ça pourrait bien être fini. Depuis notre dernière soirée à Toulouse, je retiens mon souffle, comme en apnée. Au fond de moi, je me prépare au deuil de notre amour.
A l’écoute de ce message, je suis tellement désarçonné que je n’ai même pas la présence d’esprit de laisser un message. Je raccroche.
Soudain, je repense à une chanson sortie deux ans plus tôt, et dont l’un des remix se termine justement avec ces mots :
— Please hung up and try again.
https://youtu.be/4MK8q5EJPAU?t=471
Soudain, une note positive trouve le moyen de faire surface et d’apporter un « Ray of Light » dans mon « Drowned World » actuel. Depuis quelque temps, les rumeurs sont de plus en plus insistantes sur l’arrivée d’un nouvel album en début d’année prochaine. Quelques maquettes de chansons non abouties ont même fuité sur le net.
Pour le nouvel album, il semblerait que Justin Timberlake soit de l’aventure. Madonna est toujours là, en filigrane de ma vie, comme une bonne copine. Et dans la grisaille persistante de ces jours désolants, ça me met un peu de baume au cœur.
— … and try again !
Il me faut quelques instants pour retrouver mon souffle et pour composer à nouveau le numéro. Une nouvelle fois, je tombe sur le répondeur. Et cette fois-ci, je rassemble toutes mes forces pour laisser un message :
— Hey, happy birthday, l’Anglais ! Bon anniversaire mon Jérém, j’espère que cette journée spéciale se passe pour le mieux… enfin, je veux dire, j’espère que tout se passe bien pour toi. J’aurais tellement aimé pouvoir te parler un peu ce soir. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Rappelle-moi quand tu as un moment, rappelle-moi quand tu veux, rappelle-moi « dès que possible ». Bisous, Jérém, bisous…
Et je raccroche vite pour que mes sanglots ne soient pas enregistrés. Je raccroche en me demandant ce qu’il fait ce soir, le soir de son anniversaire. S’il est en train de le fêter, comment il le fête, avec qui il le fête. Je me demande s’il a déjà tiré son coup là-bas. J’imagine que oui, depuis bientôt deux mois qu’il est parti. Je me demande si son silence est une façon de me quitter. Je me demande s’il a rencontré quelqu’un. Je me demande si je le reverrai un jour.
Il me faudra attendre le lendemain soir pour que mon téléphone sonne enfin, sollicité par un appel commençant par +44. Soudain, mon cœur se met à taper comme s’il voulait défoncer ma cage thoracique.
— Allo… je décroche timidement.
— Hello, ça va ?
La simple vibration de sa voix me fait un effet de dingue.
— Maintenant que je t’ai enfin au téléphone, beaucoup mieux !
— Désolé, je suis très pris en ce moment.
Je n’ai pas envie de l’accabler, de lui jeter à la figure sa promesse non tenue, ce coup de fil attendu depuis un mois et jamais arrivé. Pas ce soir, car je suis tellement heureux de l’avoir enfin au bout du fil ! Cependant, je ne peux m’empêcher de me montrer un brin polémique.
— Même le soir de ton anniversaire ?
— Je suis allé en boîte avec l’équipe…
— Je m’en doutais… mais…
— Merci pour ton message ! il me lance, avec un enthousiasme qui met à mal toutes mes intentions de lui faire la morale.
— Avec plaisir. J’ai essayé sur ton ancien numéro, mais il n’est plus attribué.
— Je l’ai changé il y a quelques jours. Comment t’as eu le nouveau ?
— J’ai appelé Maxime…
— Ah oui, Maxime…
— J’aurais préféré que ce soit toi qui me le donnes.
— J’allais le faire…
— A Noël… de l’année prochaine, peut-être, je lui rétorque, sans arriver à cacher une pointe d’amertume.
— Non, avant, il lâche aussitôt, un poil agacé.
— Tu m’as trop manqué, Jérém ! je lui lance, comme une bouteille à la mer.
Une bouteille qu’il ne saisit pas. Car, sans transition, il enchaîne avec ses difficultés d’adaptation à une pratique du rugby très différente de celle à laquelle il était habitué, et patati et patata. Un enchaînement qui a tout l’air d’une diversion pour éviter de parler des sujets qui fâchent. Pour éviter de parler de nous.
Je l’écoute patiemment, tristement. J’ai l’impression qu’il me parle comme il le ferait à un pote.
J’ai l’impression que les liens qui nous liaient se distendent, que nous avons de moins en moins de sujets de conversation, de moins en moins de choses à partager. Force est d’admettre que, depuis quelque temps, si j’ai hâte de pouvoir le joindre, d’entendre sa voix, je redoute en même temps de ne pas savoir de quoi lui parler une fois qu’il sera à l’autre bout du fil. J’ai l’impression que nous redevenons peu à peu des inconnus. J’ai l’impression que de notre complicité d’antan, il ne reste plus rien. Et ça, ça m’arrache les tripes.
Le bonheur est si fragile, et il n’est jamais acquis.
Soudain, je repense à une info lue dans la presse sportive il y a quelques jours. Il semblerait qu’entre la 6ème et 7ème journée du championnat anglais, soit du 21 octobre au 17 novembre prochains, il va s’écouler un mois entier. Un mois sans la pression des matches, un mois a priori plus calme.
Evidemment, je demande à Jérém s’il a l’intention de venir en France. Il me répond que non, qu’il a besoin de ce temps pour préparer son premier match dont la date est encore inconnue, soumise à la progression de sa remise à niveau.
Evidemment, je lui propose de prendre l’avion pour passer quelques jours avec lui.
— Je me ferai tout petit, je t’attendrai sagement à la maison, je te ferai à manger…
Evidemment, j’essuie un refus. Evidemment, j’insiste. Evidemment, nous nous prenons la tête.
Vendredi 19 octobre 2007.
Trois jours après l’anniversaire de Jérém, la nouvelle édition du calendrier le plus attendu de l’année sort dans tous les points de vente habituels. Le sommet de la bogossitude rugbystique nationale s’affiche dans les kiosques à journaux, dans les bureaux de tabac, dans les libraires, dans les espaces culture des grandes surfaces.
Dans une libraire du centre-ville, je parcours machinalement les feuilles épaisses en papier glacé, je survole les mois et les mâlitudes avec l’œil avisé d’un amoureux de la grâce masculine. Je découvre une flopée de beaux mâles, et parmi eux le magnifique Ulysse, son torse et ses biceps débordant d’un splendide débardeur blanc qui ne semble demander qu’à être arraché.
Sa présence, bien que seulement en images, me réconforte. Elle m’aide pendant un instant à oublier l’absence qui me déchire. Parce qu’au fond, dans ces pages, dans ces photos, je ne cherche que Jérém.
Le soir même, j’appelle le beau blond. Je sais qu’il n’a pas plus de contact avec Jérém que moi j’en ai. J’ai tout simplement besoin de parler à un ami qui sait prêter une oreille attentive à ma détresse. Et ce soir encore, Ulysse sait me réconforter.
Novembre 2007.
Pendant ce mois sans matches, j’ai toujours autant de mal à joindre mon Jérém. Je me dis qu’il est peut-être toujours vexé à cause de notre petite prise de tête. J’en viens même à me dire que je retombe dans les travers déjà connus au début de son installation à Paris, de cette période où je n’arrivais pas à supporter la distance, où je faisais passer mes envies devant ses rêves.
Et puis, un instant plus tard, je me dis que, quand-même, en un mois il peut bien trouver deux jours pour supporter ma présence !
Je ne sais plus quoi penser, je ne sais pas où mettre le curseur entre son besoin légitime de tranquillité et mon besoin de le voir. Je ne sais plus quoi penser, comment me comporter. Jérém redevient peu à peu une forteresse imprenable.
J’essaie de continuer à croire en notre couple, à me dire qu’il ne s’agit que d’un passage à vide comme nous en avons déjà connus par le passé et que ça va revenir. J’essaie, mais je n’y arrive pas. Au fond de moi, je sais que cette fois-ci ce n’est pas comme les autres fois.
Mais ça ne m’empêche pas, par moments, de continuer à espérer. Chaque week-end je suis sur le point de prendre un avion pour Londres et de débarquer à l’improviste chez Jérém. Mais je ne sais même pas où c’est, chez Jérém. Il ne m’a jamais donné son adresse. J’ai vraiment l’impression qu’il veut me tenir à distance.
Samedi 17 novembre 2007.
Sans nouvelles de Jérém depuis un mois, j’ai appris dans la presse sportive que Jérém allait enfin jouer son premier match sur une pelouse anglaise ce samedi.
La parabole satellitaire que Papa a fait judicieusement installer quelques mois plus tôt me permet d’assister à ce match important pour sa carrière.
Avant le début de la compétition, les joueurs des deux équipes défilent au trombinoscope. Dans son maillot noir, parfaitement coupé, insoutenablement ajusté à son torse solide, le V du col ouvert sur une portion de peau mate à la pilosité délicieuse, les cheveux un peu plus longs que d’habitude, retournés vers l’arrière et fixés au gel, Jérém est beau à en pleurer.
Je retrouve enfin sa belle petite gueule, en même temps que ce signe, l’arête nasale un peu cassée, qui rappelle l'instant où il a failli se faire tuer pour me sauver la vie.
J’ai beau trouver cette petite « imperfection », ce tout petit cabossage que la vie a apporté sur son visage à la fois sexy et terriblement émouvant, elle n’en demeure pas moins le souvenir de l’instant où notre bonheur a pris fin.
Les joueurs de l’équipe des Wasps continuent de défiler. Et le dernier joueur à apparaître est lui aussi d’une beauté à couper le souffle.
Un splendide format rugbyman tout en muscles, arborant lui aussi un maillot noir parfaitement collé à un corps de jeune Dieu grec. Un Dieu grec avec de beaux cheveux blonds, avec une belle barbe blonde. Un Dieu grec qui n’est pas sans rappeler un certain Ulysse.
Mais en amont de sa plastique parfaite et d’une très très très belle Petite Gueule aux traits d’ange viril, ce qui frappe, assomme, fait vibrer chez lui, c’est son regard. Un regard d’une intensité rare, illuminé par des yeux d’un bleu fabuleux. Un bleu enveloppant, envoûtant, enivrant, ensorcelant, époustouflant.
Pendant la seconde où je croise son regard par écran interposé, je suis ébloui comme un lapin pris dans les phares d’une voiture. Et pendant les secondes qui suivent, je suis aveuglé comme après avoir fixé le soleil trop longtemps.
Le mec, un demi de mêlée, s’appelle Rodney. Rodney Williams. Et à l’écran, il est affiché qu’il aurait 29 ans.
Rodney est un coéquipier de Jérém. Un coéquipier dont il ne m’a jamais parlé. C’est vrai qu’il ne m’a pas parlé de grand-chose au sujet de sa nouvelle équipe. Mais soudain, en apprenant l’existence de ce garçon, je ne peux m’empêcher de me demander ce que Jérém en pense, de me demander s’il est aussi troublé par son regard que je l’ai été pendant une seconde, lui qui doit le côtoyer au quotidien.
Le match démarre et Jérém déboule sur le terrain. Ce match est pour lui un nouveau début dans le rugby, celui d’Outre-Manche. C’est une nouvelle chance qui lui est offerte, une chance qu’il a saisie après notre agression à Paris.
Mon P’tit Loup a l’air un peu perdu, tout comme la première fois où il avait déboulé sur un terrain de Top16 quelques années plus tôt, lors d’un match télévisé, à Paris, avec le Stade Français.
Par ailleurs, ce maillot noir et presque moulant lui va comme un gant. Qu’est-ce qu’il est beau !
— Je suis content de le voir enfin retrouver le chemin du terrain, me glisse Papa.
— Je le suis aussi, je suis très content pour lui.
— Vous avez réussi à garder contact ?
— Un peu, mais c’est compliqué.
— Tu l’as revu depuis qu’il est parti ?
— Non.
— Tu lui en veux d’être parti ?
— Non, c’est même moi qui l’ai poussé à y aller. Quand il est revenu d’Australie, il voulait arrêter le rugby.
— A cause de ce qui s’est passé à Paris ?
— Oui, il se sentait scruté et jugé, et il ne se sentait plus à l’aise.
— C’est vraiment con que la pression de la société soit si forte sur les homosexuels ! Remarque, j’étais moi aussi ce genre de con avant que tu ne me fasses grandir, mon bonhomme.
Les mots de Papa, ainsi que sa main posée sur mon épaule, me tirent les larmes.
— C’est bien qu’il ait pu redémarrer ailleurs… il enchaîne. Tu as bien fait de le pousser à poursuivre sa passion, ce garçon a le rugby dans le sang. S’il avait tout arrêté si jeune, il aurait été comme un lion en cage, et il aurait été très malheureux. Et il serait passé à côté d’une belle carrière. Je suis certain qu’il va aller loin ce petit Gersois.
— Je lui souhaite…
— Mais c’est dur pour toi…
— Très dur…
— Pourquoi tu ne vas pas le voir ?
— Parce qu’il ne veut pas !
— Vas-y quand-même !
— Et quoi encore ? Je vais débarquer à l’improviste, alors que je ne sais même pas où il habite ?
— Pourquoi pas ! Tu vas partir à sa recherche, à l’aventure. C’est romantique, non ? Tu verras qu’il sera touché par ta détermination.
— C’est de la folie !
— Il n’y a rien de tel que les folies pour nous faire nous sentir vivants, et pour nous faire nous sentir heureux. Et puis, en vieillissant, on s’aperçoit que les folies que nous nous sommes autorisées nous mettent du baume au cœur bien longtemps après les avoir commises.
Les premières actions de jeu s’enchaînent sous une pluie d’abord légère, et qui devient très vite battante. Les maillots, les cuisses et les avant-bras solides se salissent. Et les visages virils aussi.
La barrière de la langue pourrait poser problème, mais je regarde le match avec un féru de rugby qui me fait les commentaires en direct, juste d’après les images.
Pendant la première mi-temps, Jérém est plutôt effacé. Il intercepte quelques ballons, mais les joueurs de l’équipe adverse arrivent à l’intercepter sans mal. Jérém mord son frein, il a l’air frustré, agacé, inquiet. Oui, la première mi-temps est plutôt difficile pour mon beau brun.
Mais dès le début de la seconde, cela va changer. Le nouvel ailier des Wasps intercepte une passe venant de Rodney Williams. Et là, sous une pluie de plus en plus violente, comme au temps du tandem magique avec Ulysse, la redoutable machine à marquer des essais se met en route. Jérém tape un sprint de malade sur le sol détrempé, il évite coups sur coup pas moins de trois joueurs adverses avec une agilité et une dextérité spectaculaires. Dans son envolée, il projette des jets d’eau et de boue à chaque enjambée. Une poignée de secondes plus tard, et alors que les commentateurs anglais tout comme mon commentateur personnel s’emballent, le petit Français débutant dans l’équipe anglaise pose le ballon ovale au-delà de la ligne de but.
Ce sera le seul essai de Jérém pendant ce match. Un essai qui dans l’absolu n’est pas vraiment déterminant pour la victoire des Wasps, qui dominent l’adversaire Newcastle d’un bout à l’autre des deux mi-temps et finissent par s’imposer par 35 à 12. Et pourtant, un très bel essai. Un essai qui plante le décor, qui fait du bien au moral de Jérém et qui montre à son équipe et à ses dirigeants que le « Frenchie » a un sacré potentiel. Bref, avec cet essai, Jérém réalise ce qu’on appelle « une entrée fracassante ».
Après le coup de sifflet qui scelle la fin du match, les Wasps expriment la joie pour cette belle victoire par de multiples gestes d’amitié et accolades entre joueurs. L’une de ces dernières ne manque pas d’attirer tout particulièrement mon attention.
Je veux parler bien évidemment de celle entre Jérém au regard de braise et Rodney aux yeux bleus. Je la trouve particulièrement expressive, chaleureuse, affectueuse. Et longue. Ça ressemblerait presque à un câlin.
Et lorsqu’elle prend fin enfin, mon impression ne se dément pas, bien au contraire. Les deux joueurs ne se séparent pas tout de suite. Avant que les deux torses ne s’éloignent, il s’écoule un instant qui me semble interminable, pendant lequel le temps me parait comme suspendu.
Sans faire cas de la pluie battante, les deux garçons se tiennent là, pecs contre pecs, les mains de l’un solidement ancrées aux épaules de l’autre, les regards plantés l’un dans l’autre, réciproquement aimantés. Et entre leurs bouches, leurs corps, leurs virilités, il me semble déceler un frémissement, un transport, un élan retenus de justesse, comme s’ils se faisaient violence pour ne pas se rejoindre et se mélanger là, sur le champ.
Les deux jeunes mâles semblent brûler de désir l’un pour l’autre, insouciants des caméras, de leurs coéquipiers, de leurs adversaires et du public acclamant les gagnants. Comme s’ils étaient seuls au monde.
Je ne sais pas si ceux qui assistent à cette accolade voient la même chose que moi. Papa n’a rien vu, ou il n’a rien voulu voir, ou il n’a rien voulu montrer, peut-être. Mais moi, il me semble lire entre les lignes de cette démonstration de proximité virile, une évidente complicité sensuelle.
Les deux joueurs finissent par s’éloigner, après un instant qui m’a semblé interminable, en se repoussant mutuellement d’un double geste joueur accompagné d’un double sourire magnifique et terriblement complice. L’un et l’autre vont alors continuer les témoignages de liesse en allant serrer d’autres coéquipiers. Et ces nouvelles accolades ne ressemblent en rien à celle à laquelle je viens d’assister entre Jérém et Rodney.
Mais moi je n’arrive pas à m’enlever de la tête l’image de ces deux rugbymen pecs contre pecs, se fixant avec une intensité inouïe, comme s’ils se faisaient violence pour ne pas s’embrasser. Je ressens comme un vertige. Tout un tas de questions m’assaillent et je sais qu’elles ne vont pas cesser de me tourmenter.
Le soir même, j’appelle Jérém pour le féliciter pour son retour plus que réussi dans la compétition sportive. Je l’appelle parce que j’ai besoin d’entendre sa voix. Parce que j’ai besoin d’être rassuré, j’en ai un besoin urgent. Je tombe évidemment sur son répondeur à la voix d’english pouffe. Jérém doit certainement être en train de faire la fête avec son équipe pour célébrer cette belle victoire. Je ne peux m’empêcher de l’imaginer avec ce Rodney, de les imaginer assez proches, trop proches.
Je me couche envahi par l’inquiétude d’avoir définitivement perdu l’amour de ma vie. De n’avoir rien vu venir, de me l’être fait ravir par ce garçon aux yeux bleus.
Je tourne dans mon lit pendant des heures. Il me semble que dans mon dernier souvenir mon réveil indiquait 2 h 26.
Je viens de m’assoupir lorsque je suis tiré de mon sommeil encore imparfait par la sonnerie de mon portable. Je me réveille en sursaut. L’écran de mon téléphone affiche le numéro de Jérém en +44.
Je décroche et mon oreille est aussitôt assaillie par une épaisse couche de musique techno très chargée en basses mélangée à de nombreuses voix festives. Ça sent très clairement la boîte de nuit.
Sans même avoir encore échangé un seul mot avec Jérém, je suis heureux qu’il me rappelle. Et lorsque j’entends sa voix, je suis aux anges.
— Alloooooo, tu m’entends ?
— Oui, Jérém, je t’entends.
Jérém est un tantinet éméché, je l’entends à sa voix éraillée, à sa bonne humeur alcoolisée que je connais si bien. Il me demande s’il m’a réveillé, je lui réponds que oui, mais que ce n’est pas grave, il me dit qu’il n’a pas vu l’heure.
Mille questions brûlent mes lèvres, mais j’essaie de faire bonne figure, me contentant de le féliciter pour ce beau démarrage dans le championnat anglais, de l’écouter parler de sa fébrilité avant le match, de son stress et de sa frustration pendant la première mi-temps et de son soulagement d’avoir pu enfin montrer de quoi il était capable.
Oui, mille questions brûlent mes lèvres, mais je les retiens toutes. Ce n’est pas facile, j’y arrive de justesse, et au prix d’un effort important. Mais je ne veux pas qu’on se prenne la tête ce soir, et encore moins gâcher cette belle victoire, cette belle journée.
Malgré son coup de fil, j’ai horriblement envie d’éclater en sanglots. Là encore, je me retiens de justesse. Car, au fond de ma poitrine, je sens que mon cœur s’est fissuré.
Et là, j’entends une bonne voix de mec lancer tout proche de Jérém :
— Jerry, it’s late, we have to go home !
C’est nouveau, ça, « Jerry ». Mais c’est qui ce gars à la voix bien mâle qui appelle mon Jérém, « Jerry » ?
— Ok, I’m coming ! j’entends alors Jérém lui répondre aussitôt.
— C’est un pote à toi qui t’appelle Jerry ? je ne peux m’empêcher de le questionner.
— Ouais… il… il me ramène à l’appart…
Et il termine sa phrase avec une formule qui m’arrache un peu plus le cœur :
— Allez, à plus !
« A plus ». Jamais Jérém ne m’a dit au revoir avec un « A plus ». Je l’ai entendu utiliser cette formule rarement, toujours avec des potes à lui. Mais jamais encore avec moi. C’est distant et froid comme prise de congé. Tellement froid que ça me dissuade de lui lancer « Je t’aime » qui me brûle pourtant les lèvres.
Au lieu de quoi, j’arrive quand même à lui glisser :
— Il faut que je vienne te voir…
— Pour l’instant, c’est trop compliqué, on verra plus tard.
— Promis ?
— Ouais… ouais… promis…
Et pourtant, je sens que sa promesse n’en est pas une.
— Tu me manques Jérém… j’arrive à articuler, la voix cassée par les larmes.
Mais il a déjà raccroché. Et là, je sens que mon cœur est en train de se briser.
Derniers jours de novembre 2007.
Les jours suivants sont difficiles. J’essaie de m’accrocher à cette promesse que j’ai pu lui arracher, celle de nous revoir. J’essaie et j’essaie encore, sans cesse, pour tenter de faire taire mes inquiétudes et mes interrogations. En vain.
Je me passe et me repasse sans cesse cette accolade entre Jérém et Rodney aux yeux bleus. Et à chaque fois, ce que mon souvenir me montre, ce sont deux garçons qui semblent vibrer à la fois de l'écho du bonheur sensuel et de la tendresse récemment partagés et de l’anticipation de ceux à venir, et dont l'attente n'est qu'une délicieuse torture qui embrase le désir.
Et le pire dans tout ça, ce qui me ronge le plus, c’est la sensation que le plaisir n’est pas la seule chose que partagent ces deux beaux garçons. Quand j’y pense, il me semble que les regards étaient trop intenses, l’accolade trop sensuelle pour que ce ne soit qu’une histoire de jouissance des corps. Non, il me semble qu’il y a autre chose. Tout est dans ce regard qu’ils portent l’un sur l’autre. Un regard qui semble traduire une alchimie des esprits qui me donne le vertige.
Les semaines passent et la promesse de Jérém ne se concrétise pas. Pas de nouvelles depuis Londres depuis le coup de fil après son premier match avec le maillot des Wasps. Et mes questionnements deviennent chaque jour plus obsédants.
Début décembre 2007.
Début décembre, j’ai quelques jours de RTT. Je ne m’en réjouis pas. Jusqu’ici, le travail m’aidait à penser à autre chose, mais l’inactivité me plonge dans un cauchemar de cogitations en boucle H24. Je ne tiens plus en place.
Ça, c’est le carburant de ce qui va suivre.
En surfant sur Internet, j’apprends qu’entre la 7ème et la 8ème journée du championnat de rugby anglais, il y a un autre mois de pause. Chose que Jérém s’est bien gardé de m’annoncer.
Ça, c’est l’étincelle qui va faire démarrer la machine.
C’est ainsi que, sur un coup de tête, et en accord avec les suggestions de Papa, je réserve un aller-retour pour Londres. Je pars à l’aventure, sans même prévenir Jérém. Il tenterait de m’en dissuader et il y arriverait probablement. Je ne veux pas risquer de casser mon élan.
Je l’appellerai sur place, et je me dis qu’il n’osera pas me refouler. Et s’il ose, c’est qu’il n’en a plus rien à faire de moi. Et que notre histoire est foutue pour de bon. J’ai peur de ce que je vais découvrir à Londres. Mais j’ai besoin de savoir. J’ai besoin de savoir si Ourson et p’tit Loup existent encore ou s’ils se sont perdus dans le tourbillon de la vie. Rien ne sera pire que cette attente, cette ignorance, ces soupçons, ces cogitations, ces films tous plus catastrophiques les uns que les autres qui me hantent et me bouffent un peu plus chaque jour.
Mardi 11 décembre 2007.
A l’aéroport de Blagnac, je replonge dans les souvenirs de mon premier voyage à Londres, en 2001. Six ans déjà que j’ai pris mon premier avion pour aller assister à mon premier concert de Madonna accompagné par ma cousine Elodie.
Mon esprit était alors plus léger qu’aujourd’hui. Enfin, pas vraiment, car à cette époque déjà j’avais une peur panique de perdre Jérém. Mais en 2001, cette peur n’était représentée que par un danger générique. J’avais peur qu’il en ait marre de moi, qu’il me quitte pour aller voir ailleurs. Pour une nana, pour un mec, que sais-je. Mais toujours pour un(e) inconnu(e). En revanche, le danger d’aujourd’hui a un visage. Et des yeux bleus, terriblement bleus.
Aussi, en 2001, j’étais avec ma cousine qui me faisait rire et me remontait le moral. Alors que là, je suis seul, terriblement seul.
En passant la douane, j’ai l’impression d’avoir une boule de plomb au fond de la poitrine. L’heure d’attente avant l’embarquement m’épuise. Dans l’avion, j’ai du mal à respirer. Et quand nous quittons enfin le sol pour nous envoyer dans les airs, je me dis que je fais une grosse erreur. J’ai l’impression de commettre une intrusion impardonnable dans sa vie. J’ai le sentiment que je vais me ridiculiser, que je vais à la rencontre d’une humiliation cuisante.
Oui, j’ai très peur de ce que je vais découvrir à Londres. J’ai aussi très peur de la réaction de Jérém quand il va me voir débarquer comme un cheveu sur la soupe. Mais j’ai plus que tout besoin de savoir.
A la faveur d’un ciel particulièrement dégagé, la Manche défile sous mes yeux. Elle défile à toute vitesse et en même temps comme au ralenti.
Lorsque l’atterrissage s’amorce, ma peur grandit encore. Il est 18 heures, il fait déjà nuit noire. Pour arranger le tout, il pleut des cordes. J’ai l’impression d’arriver en terre hostile.
J’attends d’avoir débarqué pour l’appeler. Et ce n’est pas chose facile. Je n’ose pas. J’ai l’impression que le téléphone me brûle les doigts. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine. Ce n’est qu’au prix d’un effort à la limite de mes capacités mentales que je lance enfin la composition du numéro. J’ai l’impression de faire un saut dans le vide.
Et alors que chaque tonalité semble espacer les battements de mon cœur et mes respirations, jusqu’à les suspendre, je tombe une nouvelle fois sur son répondeur. Je n’ai d’autre option que de lui laisser un message, comme en apnée.
— Salut, c’est moi… euhhh… écoute… je viens d’atterrir à Londres… enfin… à l’aéroport de Heathrow, je suis parti à l’arrache, j’ai envie de te voir, tu me manques trop… je sais que ça se fait pas de débarquer à l’improviste… mais rappelle-moi, s’il te plaît, rappelle moi…
Là, tout de suite, je ne sais pas quoi faire. Prendre le train pour Londres, me taper une heure de voyage, à quoi bon ? Et s’il ne me rappelle pas ? Qu’est-ce que je vais foutre à Londres, seul comme un chien ?
Ne serait-il pas plus judicieux, et moins douloureux, d’attendre un peu à l’aéroport, et s’il n’appelle pas, rentrer à Toulouse par le premier vol pour me morfondre en terre familière ?
Mais je suis incapable de renoncer. J’ai besoin de m’approcher encore de lui. Je prends le train, direction le centre-ville.
Je suis environ à mi-trajet lorsque mon téléphone sonne enfin. Et, comme prévu, je me fais incendier.
— Qu’est-ce que tu fiches à Londres ?!
— J’ai envie de te voir…
— Je suis très occupé…
— Tu as bien quelques heures à me consacrer ? Une soirée, non ? Je peux repartir demain, mais maintenant que je suis là, ne m’oblige pas à partir sans te voir…
— T’es où ?
— Dans le train, j’arrive en ville dans une demi-heure…
Jérém finit par se calmer et m’indiquer le nom d’un pub du centre-ville. Il me dit de descendre à la première gare et prendre un taxi qu’il me paiera.
Une heure plus tard, je suis assis à une petite table face à mon Jérém, dans un pub à l’ambiance feutrée.
Habillé d’une belle chemise blanche, d’une veste super bien coupée, d’un nouveau parfum et d’une nouvelle couche de maturité qui lui vont comme un gant, il est simplement à craquer. J’ai envie de le prendre dans mes bras, de le couvrir de baisers. Et j’ai follement envie de lui.
Nous parlons de choses et d’autres, notamment de banalités. Je sens qu’il y a un malaise, qu’il y a des non-dits, qu’il me cache quelque chose. Je sens que quelque chose a changé.
J’ai la tête pleine de questions que je n’ose pas poser, et Jérém a l’air de marcher sur des œufs. Sa bière descend trop vite, la mienne, pas du tout. Deux différentes façons d’exprimer notre nervosité. Ce que je retiens, c’est que notre belle complicité s’est définitivement évaporée. J’ai plus que jamais envie de pleurer.
— Qu’est-ce qui se passe ? je finis par le questionner, comme un cri du cœur, un cri libérateur de celui qui se lance dans le vide.
— De quoi ? il fait mine de s’étonner.
— Je t’ai demandé ce qui se passe… Je vois bien que tu n’es pas comme avant.
— Nico, tu débarques sans prévenir, qu’est-ce que tu veux que je te dise ?
— Je pensais que ça pouvait te faire plaisir de me voir !
— Pourquoi tu es venu à Londres ? il me lance, sans transition.
— Quelle question ! Parce que tu me manquais ! J’en déduis que je ne t’ai pas manqué un seul instant !
— C’est pas le problème !
— Et c’est quoi le problème, tu peux me l’expliquer ?
— On ne peut pas continuer comme ça…
— C’est quoi, « comme ça » ?
— Une relation à distance c’est trop compliqué, ça nous ferait du mal à tous les deux…
— Je t’ai proposé de te suivre, je te rappelle !
— Tu es bien à Toulouse !
— Pourquoi tu as arrêté de m’appeler et de répondre à mes messages ?
— Parce que…
Et là, mon Jérém s’interrompt net. Un long moment de silence, des regards fuyants, une déglutition presque douloureuse remplacent les mots difficiles qui ont tant de mal à sortir.
— Parce que… quoi ? je m’impatiente.
— Parce que je voulais qu’on tourne la page.
— Qu’on tourne la page ? Après tout ce qu’on a vécu ensemble ? Après tout le bonheur que nous avons partagé ? Mais moi je ne veux pas tourner la page !!!
— Nico !
— Dis-moi ce qui se passe, à la fin ! Je peux tout entendre !
— J’ai un coloc, il finit par lâcher sèchement.
— Un coloc ?
— Je vis en coloc avec un autre joueur de l’équipe.
Cela pourrait expliquer des choses. Il ne vit pas seul, voilà pourquoi il a du mal à m’appeler.
— Tu m’en as pas parlé…
— Je n’en ai jamais eu l’occasion…
— C’est un joueur ?
— Oui, Rod est un coéquipier.
Et là, j’ai l’impression de tomber dans un canyon sans fond.
— Rod… Rodney Williams ?
— Oui, Rod… tu le connais ?
— Rodney Williams, le mec avec des yeux bleus qui donnent le vertige ?
— Oui, il a les yeux bleus. Mais tu le connais d’où ?
— J’ai vu le match à la télé avec Papa…
— Ah…
— C’est lui ton coloc ?
— Ouais…
Oui, la présence d’un coloc explique certaines choses. Pourvu que la présence de CE coloc n’en explique pas trop d’autres.
Derrière les vitres du pub, la pluie tombe toujours aussi drue. J’ai de plus en plus envie de mélanger mes larmes à ces cordes incessantes.
— Ça veut dire que je dois me chercher un hôtel pour cette nuit ?
— Arrête, il pleut à seau. Tu peux venir à l’appart si tu veux, c’est pas loin d’ici.
— Et il y a assez de lits, je dormirai sur le canapé, il s’empresse d’ajouter, les yeux fuyants.
— Sur le canapé ?
A l’approche de l’appart, sous la pluie incessante, j’ai le souffle coupé, le cœur en fibrillation. Par moments, j’ai envie de faire demi-tour, de m’éviter, de m’épargner ce que mon intuition me fait pressentir. Mais j’ai besoin de savoir, et je sais que je n’ai aucun autre moyen d’en avoir le cœur net. Aucun autre moyen que d’aller au casse-pipe.
Jérém s’arrête devant la grande porte en bois verni d’un immeuble cossu et sonne à l’interphone.
— Who is this ? demande une voix masculine grésillante.
— It’s me, répond Jérém.
— With a friend, il s’empresse d’ajouter avec son bon accent frenchie mâtiné d’inflexions toulousaines.
Nous voilà dans le hall, puis dans l’ascenseur. La montée jusqu’au 4éme étage se fait dans un silence assourdissant. Et dans une absence de tendresse totale. J’ai envie de l’embrasser, mais je sens qu’il ne serait pas réceptif.
Les portes de la cabine s’ouvrent sur un couloir lumineux. Une porte est entrouverte, et Jérém s’y dirige d’un pas rapide. J’ai l’impression que je sais déjà ce que je vais découvrir, et que mes jambes sont désormais en coton. J’ai envie de pleurer, de crier, de partir, de savoir. De savoir.
Jérém franchit la porte de l’appart sans se retourner. Je prends une bonne inspiration, comme si je me préparais à une longue apnée et je lui emboîte le pas. L’entrée est spacieuse, bien décorée, on voit de suite que c’est un appartement de standing dans un immeuble de standing. Mais je n’ai pas le temps de trop regarder les détails, car quelque chose attire mon regard, l’aimante, le ferre, le monopolise.
Rodney rentre dans mon champ de vision, et je réalise à cette occasion qu’il est d’une taille moyenne, 1 mètre 70 au plus. Un petit format, donc, mais superbement proportionné.
Oui, Rodney rentre dans mon champ de vision, et son regard s’appareille instantanément au mien.
Je suis ébloui, foudroyé par ses yeux bleus. Pas gris bleu ou bleu clair, mais d’un bleu profond, intense, déroutant, un bleu d’océan qui t’aspire, t’étourdit, te happe, te hante. Ce garçon dégage une aura bouleversante. En vrai, ses yeux sont encore plus troublants qu’à la télé. Son regard bleu à bout portant, c’est insoutenable. Et pourtant, je me laisse happer. Je ne peux résister, je ne peux m’opposer à cette force d’attraction inéluctable.
Rodney connait bien le pouvoir inouï de son regard. Mais il a l’air d’un gentil garçon qui n’abuse pas de son charme. Tout au plus, ça l’amuse. Et c’est certainement de cet amusement que prend naissance ce petit sourire qu’il me lance, en captant mon éblouissement devant son regard. Et ce sourire, putain, ce sourire est une tempête solaire. Elle dérègle tout sur son passage.
Jérém me présente comme un ancien camarade de lycée de passage en ville et venant faire un petit coucou. Et il me présente Rodney simplement comme un coéquipier. Je sais que Jérém ment. Et j’ai l’impression que Rodney le sait aussi. Le garçon aux yeux bleus me tend la main avec un geste amical et un sourire totalement désarmant. Je voudrais pouvoir le détester, mais je n’y arrive même pas.
Quelques instants plus tard, nous nous installons autour d’un comptoir pour une sorte d’apéritif dinatoire. Rodney parle un français qui n’est pas parfait, mais il arrive quand même à se dépatouiller. Il bute parfois sur certains mots, il essaie de les expliquer quand vraiment il ne les trouve pas, il fait des détours parfois très drôles.
Ce garçon est charmant sous tout point de vue. Il est avenant, aimable, chaleureux. Et pas con du tout. Je pense qu’il a compris qui je suis pour Jérém, ou plutôt qui j’ai été pour Jérém. Mais il n’y a pas une once de malaise ni de triomphe dans son attitude, sa voix, son regard. Rodney est un être solaire et souriant. Sa gentillesse arrive à débloquer cette situation qui pourrait être par ailleurs très gênante.
Au fond de moi, je sais ce qui se passe, je sais qui est Rodney pour Jérém et qui est Jérém pour Rodney. Il n’y a pas d’effusions entre eux. Mais certains regards, certaines attitudes ne trompent pas. Les êtres qui s’aiment dégagent une sorte d’aura partagée qui finit toujours par les trahir.
Leur bonheur commun, que je soupçonne de plus en plus, me rend triste, car il me prive du mien. Mais force est de constater, en les regardant, que ces deux garçons sont particulièrement bien assortis et forment un sacré beau petit couple.
Pour la nuit, je suis installé dans une chambre d’amis que Jérém me présente comme étant la sienne. Certes, il y a ses affaires dedans. Des maillots, des t-shirts, des jeans, ses boxers, ses chaussettes, ses chaussures. Son parfum flotte dans l’air. Et pourtant, j’ai l’impression que cette pièce est davantage son dressing room que sa chambre à coucher.
Jérém, quant à lui, s’installe sur le canapé du séjour. J’apprécie la délicatesse de ne pas dormir avec Rodney. J’aimerais bien savoir ce qu’il lui a dit pour justifier sa désertion de celui que j’imagine être le lit commun. Parce que j’imagine bien qu’ils dorment, couchent, font l’amour, se câlinent, dans le même lit. Est-ce qu’il a encore enrobé la réalité en prétextant par exemple une gêne vis-à-vis d’un camarade qui n’a pas besoin de savoir pour ne pas ébruiter son « secret » ? Ou alors, est-ce qu’il a joué franc jeu et il a dit à Rodney qu’il ne veut pas blesser davantage un ex toujours amoureux ?
Dans tous les cas, je suis persuadé que Rodney a deviné ce qu’il y a eu entre Jérém et moi.
Bien évidemment, je n’arrive pas à dormir. Je n’y arrive pas parce que j’ai la tête remplie de cogitations sans avoir encore eu la moindre réponse. J’ai besoin de parler à Jérém. J’ai besoin qu’il me dise les choses en face. Je pourrais aller le rejoindre dans le séjour, essayer d’avoir une discussion avec lui. Mais je n’ai pas envie que ça se passe comme ça, avec Rodney juste à côté.
Je passe une grande partie de la nuit à imaginer le nouveau bonheur de Jérém, ce bonheur qui me prive du mien, à me demander pourquoi il m’a amené ici, pourquoi il m’impose ça. A me demander comment faire pour parler à Jérém et à l’obliger à me parler.
Peut-être que le fait de m’amener dans le lieu de vie qu’il partage avec ce garçon, et de me présenter ce garçon au passage, est sa façon à lui de me parler. Visiblement, Jérém a tourné la page.
A une heure très tardive de la nuit, je prends la résolution de rentrer à Toulouse dès le lendemain matin. Je n’ai rien à faire ici, dans cet appart, dans cette ville. Il n’y a plus rien pour moi ici. Et je finis par m’assoupir, enfin, aux aurores.
Mercredi 12 décembre 2007.
Le lendemain matin (enfin, le matin même, deux ou trois heures après mes dernières cogitation), j’émerge tout sens dessus dessous. Le réveil de la chambre indique 8h13. Le manque de sommeil provoque un épouvantable mal de crâne, j’ai la tête qui tourne, je ressens un vertige, j’ai mal au cœur. Tous mes muscles sont douloureux, j’ai l’impression qu’on m’a arraché le cœur.
Je me lève en sursaut, en me demandant si Jérém et Rodney ne sont pas déjà partis aux entraînements. Pendant un instant, je souhaite que ce soit le cas. Ça nous évitera de nouveaux malaises. Je vais partir sur le champ. Je n’ai pas la force de rester plus longtemps. Rester ne servirait à rien, à part nous rendre encore plus malheureux. Je vais laisser un mot, ou même pas. J’enverrai un message à Jérém lorsque je serai à l’aéroport, ou même pas. Tout est dit, tout est joué. Il n’y a rien à ajouter. Je n’ai pas besoin de plus de drama, ça suffit comme ça. Ici, je suis un étranger.
Il ne me reste qu’à faire le deuil de mon bonheur passé, et je crois que j’y arriverai mieux quand je serai à Toulouse. J’ai besoin de retrouver au plus vite ma ville, la maison de mes parents, mes parents, ma chambre. J’ai besoin d’utiliser mes repères comme des béquilles pour ne pas sombrer dans cet abîme de souffrance qui m’appelle avec de plus en plus d’insistance.
Je me rhabille, je saisis ma valise qui n’a pas été ouverte, je quitte ma chambre, je passe rapidement aux toilettes et à la salle de bain. Dans une panière à linge, des boxers, des t-shirts, des chaussettes, des jeans. Les affaires des deux garçons se mélangent dans cette panière, certainement à l’image de leurs corps, de leurs sentiments. Il faut que je parte au plus vite d’ici, où tout me parle du nouveau bonheur de Jérém loin de moi.
C’est en sortant des toilettes que j’entends des bruits venant de la cuisine. Moi qui voulais partir en douce, c’est raté.
Je m’avance dans le couloir et je vois Jérém derrière le comptoir de la cuisine. Il porte un t-shirt noir bien ajusté à son torse, un t-shirt qui me rappelle celui qu’il portait le premier jour du lycée. Il porte également un jeans déchiré et il est pieds nus. Son brushing est en bataille, il est super beau. Et sa beauté est encore décuplée par le fait qu’elle m’est désormais inaccessible.
— Salut, il me lance, en me voyant arriver.
— Salut.
— Tu pars déjà ? il me demande, après avoir remarqué que je tiens ma valise à la main.
— Tu as raison, ce n’était pas une bonne idée de venir ici. J’aurais dû rester à Toulouse.
— Tu veux du café ? il me demande en me montrant la cafetière encore fumante. C’est une cafetière italienne, comme celle de la petite maison dans la montagne. Jérém n’a pas relevé mes derniers mots, des mots qui appelaient implicitement des mots rassurants qui ne viennent pas. Il semble indifférent face à ma détresse, comme s’il s’en foutait, ou comme s’il voulait à tout prix éviter qu’on se prenne la tête. Ou comme s’il se sentait coupable. J’ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps.
— Je veux bien du café, je finis par répondre, la voix étouffée par ma tristesse.
Jérém pose un mug devant moi et le remplit, le regard fuyant.
— Rodney n’est pas là ? je le questionne.
— Non, il est parti faire son sport du matin avant de filer à l’entraînement. C’est un lève-tôt…
— Et toi, tu n’as pas entraînement ?
— Si, mais j’ai prévenu que je serai à la bourre.
— Je croyais que vous étiez partis tous les deux.
— J’attendais que tu te lèves…
Nous prenons le café assis l’un en face de l’autre, nous cachant chacun derrière notre mug pour ne pas à avoir à affronter le regard de l’autre.
— Nico, il faut que je te parle, je l’entends me glisser après un long silence pesant.
Ses mots résonnent à mes oreilles comme autant de coups de massue. Ça y est, je vais en avoir le cœur net. J’attendais ce moment, mais je suis déjà assommé par le pressentiment de ce que je vais entendre. Alors, autant abréger les souffrances.
— Tu l’aimes ? je coupe court.
Je m’étonne tout seul de ma détermination, de mon sang froid, de mon détachement, de ma force. Mais à ce stade, il n’est plus temps de faire du chichi. Un pansement est plus vite arraché d’un coup sec.
Pour toute réponse, j’essuie un autre silence, pourtant assorti d’un regard défait qui en dit long. Sa déglutition nerveuse en dit long elle aussi.
— Dis-moi, j’ai besoin de savoir. Je n’ai pas fait ce voyage pour repartir avec les mêmes questions qui m’ont conduit ici.
[D’abord, il y a eu le regard. Ce regard d’un bleu presque surnaturel. La première fois où tu l’as croisé, tu as été comme aspiré par et dans ses yeux bleus, bleus d’un bleu que tu ne croyais même pas qu’il pouvait se nicher dans les yeux d’un garçon.
Ensuite, il y a eu le sourire. Un sourire amusé par ton air bête pendant que tu t’empêtrais de plus en plus dans son regard.
Après, il y a eu quelques regards plus appuyés, et tu as commencé à te faire des films. Mais votre complicité naissante a pris le pas sur le désir naissant.
Très vite, il y a eu l’amitié. Sa présence t’a été d’un grand secours pour t’acclimater à ton arrivée, toi qui maîtrisais très mal la langue de Shakespeare. Rod t’a aidé à appréhender l’anglais, mais aussi les uses et coutumes locales. Et, surtout, le rugby d’Outre-Manche. Tu as vu dans son regard qu’il croyait en toi. Tu as toujours besoin qu’on te montre qu’on croit en toi. Tu as retrouvé dans son regard la bienveillance de Thib et l’expérience d’Uly.
Puis, un soir, tu t’es surpris à te branler en pensant à lui.
Par la suite, tu t’es branlé chaque soir en pensant à lui. Mais après la jouissance, tu retrouvais la frustration de le savoir inaccessible.
Quelque temps plus tard, il y a eu cette escapade dans une boîte gay. Tu avais envie de tirer ton coup. Et Rod était là lui aussi. Il t’avait repéré avant que tu le repères. Quand tu l’avais capté, il te souriait déjà. Tu lui as souri à ton tour. Sur un fond sonore aux basses assourdissante, il a traversé la salle, il s’est approché de toi et est venu t’embrasser, sans un mot. Ça coulait de source, comme une évidence.
Tu l’as suivi chez lui, et vous avez couché ensemble pour la première fois. Tu t’es donné à lui sans hésiter. Tu en avais tellement envie ! Sa façon de te prendre, de venir en toi, de te faire sentir à lui, t’a bouleversé. De cette première nuit, tu te souviens du frottement de sa barbe dans ton cou, de son souffle, de son assurance, de sa tendresse.
De son accent si marqué, et follement sexy lorsque, avec un choix lexical qui t’a amusé, il t’a soufflé :
« J’éjacule ».
Depuis ce premier soir, tu passes toutes tes nuits avec lui, tu couches chaque nuit avec lui. Tu es devenu accroc à lui, à son corps, à son parfum, à sa queue, au plaisir que tu partages avec lui. Mais par-dessus tout, tu es devenu accroc à l’étreinte de ses bras puissants dans lesquels tu te sens si bien, en sécurité. Et à son regard bienveillant, à sa présence rassurante dans ta vie.
Tout est allé très vite et tu t’es laissé emporter par sa passion, qui est devenue la tienne. Tu te sens désiré, et tu te sens aimé aussi.
Comme avec Nico.
Tiens, Nico, parlons-en. Tu culpabilises à fond de lui faire ça, d’être si heureux avec un autre garçon. Nico, avec qui tu as partagé tant de choses, tant de moments, Nico qui t’a tant apporté dans ta vie, et avant tout la conscience de qui tu es. Nico qui t’a aidé à te débarrasser de la honte.
A Nico, tu y penses toujours. Tu ne pourras jamais l’oublier.
Mais Rod est là, chaque jour à tes côtés. Il est aussi rugbyman comme toi, il ne te demandera jamais davantage que ce que tu peux lui donner. Vous êtes deux amants qui vivent un amour qui n’emprisonne pas, qui ne demande rien de plus qu’à partager des instants de bonheur. Tout te parait si simple avec Rod. Ça te fait un bien fou de savoir que dans ton équipe il y a un autre joueur gay, un très bon joueur.
Tu ne t’es jamais senti aussi bien dans ta peau que depuis que Rod est entré dans ta vie. Car ce garçon a su t’apporter un équilibre, une stabilité, une sérénité, une réconciliation inattendue et inespérée entre ta passion sportive et ton épanouissement sentimental et sexuel].
— C’était pas prévu, je ne l’ai vraiment pas vu venir… il souffle, la voix coupée par l’émotion.
— Tu m’as oublié, alors ?
— Non, non, non, il s’en défend vigoureusement, je ne pourrai jamais t’oublier !
— Même maintenant que tu aimes ce mec ?
— Jamais !
— Est-ce que tu es heureux avec lui ?
— Sans lui, je ne tiendrais pas le coup…
— Tu n’as jamais voulu t’installer avec moi… et maintenant, avec lui…
— Ici, c’est différent… il a su me rassurer, sur tout…
— Et pas moi…
— Tu m’as énormément apporté, Nico !
— Mais visiblement pas assez…
— Ne dis pas ça, Nico…
— Alors, Ourson et P’tit Loup, c’est fini ? je pleure.
— Nico, ne pleure pas !
— Ce qui s’est passé à Paris nous a fait beaucoup de tort, je glisse, amer.
— Sans ça, je ne serais pas parti…
— Si seulement tu m’avais permis de venir avec toi, on n’en serait pas là !
— Je ne sais pas où on en serait. De toute façon, je ne vais pas rester à Londres…
— Quoi ? Et tu vas aller où ?
— J’ai une opportunité d’aller jouer en Afrique du Sud.
— Avec Rod ?
— En réalité, c’est lui qui a l’opportunité, et il a réussi à faire en sorte que je sois moi aussi du voyage.
Mes larmes coulent sur mes joues, elles se mélangent à celles de Jérém, pendant une longue accolade. Je plonge mon visage dans son cou, et je glisse quelques derniers baisers sur sa peau.
En passant la porte de l’appart, je me retourne et j’essaie de capturer chaque détail de la dernière image de Jérém qui se présente à moi. Car je sais que c’est la dernière.
Son t-shirt enveloppant son torse, son cou, ses pecs, ses biceps solides avec une justesse éblouissante, la couleur noire faisant un pendant saisissant avec sa peau mate, ses cheveux bruns en bataille.
Ses deux tatouages, le brassard tribal et le motif végétal remontant de son épaule vers son cou.
Ce grain de beauté insoutenablement sexy dans le creux de son cou.
Son parfum, un nouveau parfum, délicieusement entêtant, peut être un cadeau de Rodney.
Soudain, je suis saisi, submergé, débordé par la remontée simultanée d’une flopée de souvenirs.
La première fois que je l’ai vu dans la cour du lycée, petit con en train de déconner avec ses potes, habillé d’un t-shirt noir et d’une casquette à l’envers.
Le lycée, le désir de chaque jour, la première fois où je l’ai vu nu, sous la douche, après le cours de sport.
Mon trajet dans les allées toulousaines, en ce jour de mai, le jour de notre première révision pour le bac.
« Je vais jouir et tu vas tout avaler »
Nos révisions très sexuelles rue de la Colombette. Le manque de tendresse.
Les retrouvailles à Campan, sous la halle cernée par une pluie battante, l’amitié instantanée avec les cavaliers. Un Jérém plus nature, qui a fait chavirer une deuxième fois mon cœur.
Ses attitudes pendant l’amour, l’expression de son visage secoué par l’orgasme, son regard amoureux, ses baisers, sa tendresse.
Le premier « je t’aime » dans la petite maison dans la montagne cernée par la neige, un 31 décembre.
Le Noël où, après une période d’éloignement, il a débarqué par surprise à Toulouse.
Nos voyages, en Italie, au Québec, en Islande.
Le séjour dans la maison au milieu des vignes, ce lieu magique où mon Jérém a grandi, et où je me suis senti graviter au-dessus de tous les Jérémies.
Et notre dernier bonheur, notre dernier baiser, dans la rue, le soir de notre agression, le soir de ses vingt-cinq ans.
Ma dernière photo mentale de Jérém s’achève avec la captation de ses beaux traits virils, de cette petite cassure sur son nez, cette cicatrice, cette marque qui rappelle le début de la fin de notre bonheur. De cette chaînette qui dépasse du col de son t-shirt, celle que je lui ai offerte pour l’anniversaire de ses vingt ans et qu’il porte toujours, malgré tout.
Et de ses yeux pleins de larmes.
Je ressens une folle envie de l’embrasser, de le remercier une fois de plus de m’avoir sauvé la vie, de le supplier de ne pas me laisser partir. Mais je n’en fais rien, car je sais que ça ne servirait à rien.
Je le serre une dernière fois dans mes bras, très fort, m’imprégner de la solidité de son torse, de son parfum, de la chaleur de son corps, de sa présence.
Alors, c’est ici que nous nous quittons pour de bon. C’est officiel, Ourson et P’tit Loup ne sont plus qu’un souvenir.
La porte se referme devant moi, et aucun mot de sa part ne vient casser la chape de plomb qui est descendue sur moi. Je reste planté là, mes doigts enroulés dans la chaînette qu’il m’avait offerte avant notre départ de Campan, la veille de son départ pour Paris, pendant un moment dont je suis incapable d’estimer la durée. Je suis figé, incrédule, abasourdi comme devant le final d’un livre ou d’un film qui ne correspond pas du tout à nos attentes. Je suis en larmes. Et au-delà de la cloison, j’ai l’impression d’entendre les siennes se mélanger aux miennes.
Au fond de moi, je sens avec une effrayante certitude que c’est bel et bien la dernière fois que je vois Jérém.
Le voyage en train vers Heathrow est un calvaire trempé de larmes. Le survol de la Manche et d’une grosse partie de la France, un autre. Les moments d’abattement, de désespoir alternent sans cesse avec d’autres dans lesquels je ressens au fond de moi un détachement qui m’étonne, qui me surprend. Je crois que je suis dans une phase de déni. Je sens que le deuil de mon amour pour Jérém va être dur, très dur, je le sais. Et que ma souffrance présente n’est qu’un avant-goût de celle qui m’attend dans les heures, les jours, les semaines, les mois à venir.
A l’atterrissage à Blagnac, je retrouve le même ciel que celui de Londres, la même grisaille de plomb, la même pluie impitoyable, la même tristesse inconsolable, les mêmes larmes incontrôlables.
En descendant de l’avion je réalise ce dont je me doutais pas mal, à savoir que m’éloigner de Londres n’a servi à rien. Ma blessure m’a suivi jusqu’à Toulouse, et je sais qu’elle va me suivre quoi que je fasse, où que j’aille, et pour un sacré bout de temps.
A l’instant où je rallume mon portable, une flopée de notification de messages s’affichent sur l’écran de mon portable. Ils viennent tous du Royaume Uni, et ils contiennent tous ces petites fautes que j’ai toujours trouvées si adorables dans ses messages.
« Desole Nico »
« Je ne voulai pas te faire souffrir »
« Tu seras plus heureux san moi »
« Vis ta vie vis tout ce que tu as a vivre »
« Tu trouvera un gars qui te rendra heureux tu le mérites »
Hélas, tous ces messages ne contiennent pas la moindre note d’espoir. Alors, je me charge de la jouer :
« Je ne t’oublierai pas. Si un jour tu reviens, je serai là. Je t’attendrai »
Et Jérém de la saper :
« Ne m’attends pas »
Ce sera son dernier message.
Décembre 2007.
Décembre avance, les jours se succèdent dans une marche inarrêtable vers Noël. Au plus profond de moi, je suis démoli, le cœur en miettes. Cet air de fête qui parcourt les rues et les allées de Toulouse m’agace, m’attriste, m’assomme.
Je dois me faire violence pour me lever et aller bosser. La reprise du travail est difficile, j’ai du mal à me concentrer, à ne pas pleurer, je ne suis vraiment pas bien. Et quand je suis à la maison, je suis tout aussi mal. En fait, je ne suis bien nulle part.
Je n’arrête pas de penser au bonheur immense que j’ai connu avec Jérém pendant quelques années et à l’injustice du fait qu’il m’ait été arrachée en quelques instants. Je n’arrête pas de penser à cette horrible nuit parisienne le soir de ses vingt-cinq ans, à cette agression qui a déclenché le sinistre effet domino qui nous a conduits jusqu’ici, loin l’un de l’autre.
Ma tête semble devoir exploser, car elle est le théâtre d’un combat qui fait rage jour et nuit, un combat qui m’empêche de dormir et de vivre.
Je crois Jérém quand il dit que son histoire avec Rodney lui est tombé dessus sans qu’il la voie venir. Moi non plus je n’ai pas vu venir l’éventualité que Jérém tombe amoureux d’un autre garçon.
J’essaie toutes les constructions mentales pour tenter de me faire une raison à propos du fait qu’il puisse être heureux sans moi, alors que nous partagions un même bonheur il y a encore un an de cela. J’essaie, j’essaie et j’essaie encore, j’essaie à m’en rendre fou. Mais ma raison bute contre le sentiment de gâchis. Elle bute contre celle de mon cœur. L’une et l’autre sont aspirées par le vertige du bonheur passé qui m’a filé entre les doigts, elles sont terrifiées par la peur de ne plus retrouver un quelconque autre bonheur après ce désastre. Et de ne connaitre qu’un avenir d’errance, voire de misère sentimentale, d’immense solitude. J’essaie de commencer mon deuil de cet amour perdu. Mais pour l’instant, le deuil est impossible.
Renoncer à Jérém, c’est impossible.
Noël 2007.
C’est, sans conteste, le pire Noël de ma vie.
— L’amour est la plus grande source de bonheur, mais peut être aussi la plus grande source de malheur. C’est la vie, mon lapin. Tu peux ne pas le croire maintenant, mais je te garantis qu’un jour tu seras à nouveau heureux.
Maman est là quand j’ai besoin de parler mais elle ne force jamais les choses, elle est très présente, mais sa présence est discrète, jamais envahissante. Elle a toujours les mots qu’il faut, elle est juste parfaite.
C’est idiot, mais le soir du réveillon, que je fête en petit comité avec Papa, Maman, Elodie et sa petite famille, j’espère en un miracle.
Pendant que je joue à la poupée avec la petite Lucie, j’espère de tout mon cœur que Jérém débarque à l’improviste, qu’il sonne à la porte, qu’il m’appelle ou qu’il m’envoie un message pour me dire qu’il est à Toulouse.
Oui, je me prends à rêver qu’il me fasse la surprise comme lors du réveillon d’il y a quelques années, qu’il vienne me chercher à nouveau, qu’on passe la nuit ensemble et que le lendemain on parte une nouvelle fois à Campan et qu’on fête le 31 là-bas, avec les cavaliers ou bien qu’une tempête de neige nous oblige à fêter seuls la venue du Nouvel An, dans la petite maison dans la montagne.
Oui, c’est idiot, car je sais qu’il ne viendra pas. Déjà, parce que je sais pertinemment que le championnat anglais ne fait pas de pause pendant la période de Noël. Et que, de toute façon, même s’il était descendu juste pour réveillonner chez son père, les portes de cette maison dans les vignes ne seraient plus ouvertes pour moi.
Je l’attends, je l’espère de tout mon cœur. Mais aucun signe ne vient de sa part. Minuit arrive, à la télé résonnent les notes de « All I want for Christmas is you » et des souvenirs de bonheur révolu remontent violemment à ma conscience. Quelques minutes après minuit, je n’arrive plus à prendre sur moi, et je m’éclipse pour aller pleurer dans ma chambre.
Un sms arrive et mon cœur fait un bond. Mais mon excitation retombe aussitôt.
C’est bien un Tommasi qui m’envoie des vœux, mais il s’agit du frère cadet.
« Joyeux Noel, Nico. Je pense toujours à toi. On reste potes, ok ? »
Mais même la démonstration d’amitié de l’adorable Maxime ne suffit pas à effacer le fait que, définitivement, ce Noël est incontestablement le plus triste de ma vie.
On m’appelle pour le gâteau, je réponds « j’arrive ». Mais les minutes passent et je n’arrive pas à essuyer mes larmes. On toque doucement à la porte de ma chambre.
— Coucou, cousin, tout va bien ?
Pour toute réponse, je suis pris par une énième crise de larmes.
Elodie s’assoit sur le lit à côté de moi, me prend dans ses bras et me glisse à l’oreille :
— Seul le temps apaisera la blessure.
Vers la fin de l’année 2017.
J’ai souvent repensé, par la suite, à ces mots de ma cousine. J’y ai repensé à chaque fois que la nostalgie me saisissait, que la tristesse m’emportait, que la mélancolie déchirait mon cœur.
Ma cousine avait raison, le temps a apaisé ma blessure. Il l’a guérie, même. Et pourtant, la cicatrice reste. Et parfois, au gré des changements de météo sentimentale et affective de ma vie, elle durcit, se contracte, redevient douloureuse.
Elle est toujours là, et je sais qu’elle ne partira pas. Je la contemple régulièrement, comme le témoin de la fin du bonheur de mes vingt ans, un bonheur dont je n’ai trouvé l’égal depuis, et dont j’ai du mal à imaginer retrouver l’égal un jour.
Vos commentaires : toujours les bienvenus !
 17 commentaires
17 commentaires
-
Par fab75du31 le 12 Avril 2023 à 21:42
Février 2007.
La Saint Valentin arrive, mais Jérém ne semble pas du tout y prêter attention. Déjà, en temps normal, il n’est pas vraiment friand de ce genre de récurrence et de célébration. Et cette année, après ce qui nous est arrivé, avec son angoisse vis-à-vis de son retour sur le terrain qui l’accapare jour et nuit, je peux tout à fait concevoir qu’il n’ait pas du tout la tête à ça.
Mais moi, j’ai envie de marquer le coup. J’ai envie, j’ai besoin de lui montrer, de nous montrer, malgré la difficulté flagrante à retrouver notre complicité d’avant l’agression, que je suis toujours là, que nous sommes toujours Ourson et P’tit Loup.
Pour le 14, je monte à Paris et je nous prépare un petit dîner tranquille à l’appart.
Jérém a l’air d’apprécier, le repas, ma présence, et surtout le fait que ça se passe à l’appart. Je sais qu’il n’aurait pas accepté que je lui propose un resto, car le fait de s’afficher avec moi à cette date particulière le mettrait mal à l’aise. Et de toute façon, je sais qu’il refuserait, car cela risquerait de raviver les rumeurs le concernant depuis l’agression.
Je suis conscient que depuis le triste soir de son dernier anniversaire, mon beau brun vit sur le qui-vive, et que la relative liberté de nous montrer tous les deux en public que nous nous sommes autorisées depuis quelques années appartient désormais au passé. Je sais que le mot d’ordre est désormais de ne prendre aucun risque. D’ailleurs, ai-je l’ai bien senti lorsque je lui ai annoncé ma venue sur Paris. Je l’ai senti réticent. J’ai senti que ça lui faisait plaisir de me voir, mais qu’il avait peur. J’ai senti qu’il était déchiré entre son bonheur et sa peur. J’ai trouvé ça immensément triste.
Après le repas, nous avons fait l’amour. Ou je devrais plutôt dire, nous avons couché ensemble. Car j’ai senti que là aussi Jérém était écartelé entre son plaisir, son envie de me faire plaisir, et cette peur, ce malaise qui le tourmente. Et, une fois encore, ça a tout gâché.
Certes, Jérém était excité pendant que je le suçais, et certes, il a joui dans mon cul. Mais le plaisir ne se prend pas qu’avec la queue, ça se prend aussi et pour beaucoup avec l’esprit. Quand l’esprit n’est pas en phase avec le corps, le plaisir est court et mécanique. Et son esprit était une fois de plus ailleurs. Son corps avait envie, mais son esprit disait « non ».
J’ai l’impression de ne plus être qu’une ombre à ses yeux, tout comme ses amis, sa famille, le rugby, sa vie tout entière. Jérém n'est plus qu'une silhouette sans plaisir ni joie. Il essaie de jouer son propre rôle pour qu’on lui fiche la paix. Mais il n’arrive plus à faire illusion, son mal être est flagrant.
A 22h30, nous étions au lit. Je l’ai pris dans mes bras et je l’ai serré contre moi. Je l’ai entendu soupirer. J’ai senti que lui aussi a perçu que notre complicité était partie, et j’ai aussi senti son inquiétude. J’ai voulu lui parler, mais j’y ai renoncé. Je n’ai pas voulu nous gâcher la Saint Valentin. Enfin, je n’ai pas eu envie de la gâcher davantage. Et, surtout, je n’ai pas eu le courage d’affronter une discussion au sujet de notre présent et de notre avenir, une discussion qui me fait peur.
Fin février 2007.
La reprise des entraînements se poursuit pour Jérém. Mais ce n’est pas un processus facile. J’ai l’impression que depuis notre agression, les entraînements pour mon beau brun sont comme le sexe avec moi. Le physique y est, mais le mental n’est toujours pas là. Et sans le mental, point de réussite.
Jérém scrute avec amertume tous les matches qu’il ne peut pas jouer, avec le Stade, en Top 14, avec le XV de France, pour le Tournoi des Six Nations. Son retour sur le terrain est enfin envisagé. Mon beau brun est à la fois impatient et mort de trouille à l’idée de retrouver le chemin des pelouses.
Mars 2007.
C’est le 17 mars, à la faveur d’un remplacement, que Jérém retrouve enfin la pelouse du Stade de France. Je suis si heureux pour lui, si impatient de le voir marquer ses premiers points pour sceller son grand retour, et pour faire fermer la gueule aux colporteurs de ragots.
Mais très vite, il faut se rendre à l’évidence, mes espoirs, et les siens par la même occasion, sont douchés. Jérém n’est pas du tout dans son assiette. Comme après son accident au rugby, son assurance a disparu. On dirait un lapin pris dans les phares d’une voiture. Il n’ose pas aller au charbon. Par ailleurs, il n’arrive pas à la mettre à profit la seule passe qu’il reçoit d’Ulysse.,.
A la fin de la mi-temps, on le remet sur le banc de touche. Je le regarde quitter le terrain, déçu et en colère. Je sais qu’à cet instant il en veut à la terre entière.
Avril 2007.
Il s’écoule près d’un mois avant que Jérém retourne sur le terrain. Contrairement au match précédent, il apparaît plutôt en forme. Il parvient même à marquer un but, sur une passe de l’irremplaçable Ulysse. Tout semble bien parti, je retrouve l’espoir de voir Jérém revenir au top, et retrouver son bonheur.
C’est un peu plus tard dans la première mi-temps qu’un incident fâcheux se produit. Un joueur de l’équipe adverse fait un méchant croche-pied à mon beau brun, qui le fait s’étaler de tout son long. Heureusement, Jérém se relève aussitôt, il a l’air de s’en sortir sans mal. Le geste du joueur paraît délibéré, gratuit, et pourtant il n’est sanctionné que par un carton jaune. D’ailleurs, la moitié de l’immense enceinte siffle et hue l’injustice arbitrale évidente.
C’est là que l’incident se produit. La caméra montre Jérém en train de s’approcher du jouer indélicat et lui hurler dessus. Le joueur semble se laisser alpaguer sans réagir, tout en affichant un léger sourire narquois qui a sans doute le don de faire monter encore plus Jérém dans les tours.
Les joueurs du Stade tentent de calmer Jérém sous le regard sévère de l’arbitre. Et semblent y parvenir. Mais le joueur fautif se charge de mettre de l’essence sur le feu. Il balance quelque chose à Jérém, et ce dernier redémarre comme une fusée et lui décoche une beigne en pleine figure.
Le mal est fait. Pendant qu’Ulysse arrive à maîtriser son co-équipier, le carton rouge est aussitôt dégainé par l’arbitre. Jérém quitte le terrain, défait. Les commentateurs parlent immédiatement de geste impardonnable, de sanctions, de suspension pendant plusieurs journées.
De retour à l’appart, Jérém est toujours hors de lui, dégoûté, remonté comme une pendule. Les 5 journées d’exclusion dont il a écopé vont l’empêcher de jouer jusqu’à la fin de la saison.
— Pourquoi tu l’as frappé ? Qu’est-ce qui t’a pris ?
— Il m’a pris que ce fils de pute m’a dit « ferme ta gueule, pédé » !
Au plus profond de mes tripes, une petite voix hurle très fort : tu as bien fait de le cogner, tu aurais même dû lui en mettre un deuxième !
Mais je ne la laisse pas s’exprimer, et le « moi » rationnel s’inquiète des conséquences de ce geste. Et surtout, de sa signification. Visiblement, la réalité de notre agression a fuité dans le milieu et la connerie humaine veut que lorsqu’on a la possibilité de donner des coups bas, on ne s’en prive pas.
Visiblement, Jérém ne le supporte pas. Visiblement, Jérém est toujours à fleur de peau. Visiblement, il ne va toujours pas aussi bien qu’il voudrait le faire croire.
— Et tu y as gagné quoi ? C’est toi qui es puni !
C’est triste de voir que le fait d’être gay est toujours une cause de déshonneur et de honte et qu’au final, c’est la victime qu’on traite de coupable.
— Et il aurait fallu que je fasse quoi, que je le laisse dire sans broncher ?
— L’envoyer chier, mais pas le cogner.
— Ça m'a mis hors de moi, j’ai perdu tous mes moyens. Heureusement qu’Ulysse était là pour me retenir, sinon je lui aurais cassé la gueule et ça aurait été un désastre pour l'équipe. Putain, je ne suis qu’une merde !
— Non, tu n’es pas une merde. Au contraire, tu es un garçon formidable qui a subi une violence injustifiée !
— Et pourtant, je me sens comme une merde !
— Ce type qui t’a insulté est un sale con, et il ne mérite pas que tu t’infliges ça !
— Oui, c’est un sale con, mais ce sale con a dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Des réflexions comme celle d’aujourd’hui, j’ai pas fini d’en entendre !
Une immense angoisse s’empare de mon esprit lorsque je réalise avec une violence inouïe que, pendant l’agression Jérém m’a probablement sauvé la vie, mais que ça lui a probablement coûté sa carrière et son bonheur.
Mai 2007.
A l’occasion de l’un des ponts du mois de mai, je retrouve Jérém au domaine, chez son père. Il s’y est installé depuis sa suspension et il donne un coup de main dans la vigne. Le travail physique au grand air semble lui faire du bien.
Mai, c’est le printemps. Mai, c’est le mois qui marque le 6ème anniversaire de nos premières révisions, des voyages à toute heure entre Saint-Michel et la rue de la Colombette. Ce devrait être un anniversaire à célébrer comme il se doit. En réalité, cette année il n’y a rien à célébrer. Cette année, à l’anniversaire de nos premières révisions, je sens que Jérém m'échappe.
Depuis la Saint Valentin, nous n’avons plus couché ensemble. Sa libido est toujours au point mort. Jérém n’a toujours pas envie de sexe.
— J’ai envie de toi, Jérém, je lui glisse un soir, dans le noir, sur l’oreiller.
— Je sais, il me glisse, sans rien ajouter de plus.
— Et toi, est-ce que tu as toujours envie de moi ? je m’entends lui demander après un long silence assourdissant.
— Ce n’est pas la question.
— Et c’est quoi la question ?
— La question c’est que j’ai plus envie de baiser. Et puis, je le vois bien, je n’arrive plus à te faire jouir…
— Mais t’inquiète pas pour ça, Jérém, je vois bien que toi non plus tu ne prends pas ton pied. Tu es trop stressé, et le traumatisme de ce qui nous est arrivé est encore en toi, et en moi aussi.
— Je n’arrive plus à rien !
— Ne dis pas ça, mon amour, je crois que tu as juste besoin de temps.
— Tu parles…
— Tu as essayé de coucher avec d’autres mecs ? j’ai envie de savoir.
— Arrête, Nico !
— Dis-moi !
— Oui !
— Et alors ?
— Ça n’a pas plus marché qu’avec toi. Ce n’est pas toi le problème, le problème c’est que j’ai pas envie, c’est tout.
— J’ai même essayé de coucher avec des nanas… il ajoute, après un blanc.
— Et ça a mieux marché ?
— Non.
— Pourquoi des nanas ?
— Parce que je me suis dit que si ça se trouve, je fais fausse route. Au fond, plus jeune, je me tapais des nanas…
— Mais tu as toujours préféré les mecs, non ?
— Je ne sais plus. Plus personne ne me fait envie, plus personne ne me fait bander.
— Même pas moi ?
— Ne le prends pas mal. C’est pas toi, c’est moi. Vraiment.
— Ces connards qui nous ont agressés t’ont fait assez de mal, ne leur laisse pas te faire cette violence aussi, ne les laisse pas te faire douter de qui tu es et de ce qui te rend heureux. Tu es un garçon qui est attiré par les garçons !
— Je ne sais plus où j’en suis…
— Par rapport à ta sexualité ?
— Par rapport à tout !
— Et le psy ne t’a pas aidé ?
— Non.
— Ça me fait de la peine de voir que tu vas si mal…
— Je ne veux pas de ta pitié !
— Je n’ai pas pitié de toi, je lui lance haut et fort, alors que les larmes coulent sur mes joues. Nous avons vécu la même agression, et je pense que nous ressentons les mêmes choses.
— Ta vie n’a pas été bouleversée autant que la mienne après cette nuit.
— C’est vrai. Mais je ne te reconnais plus, Jérém ! Et ça me fait mal, tu ne sais pas comment ça me fait mal ! Je vois que tu ne vas pas bien et je n’ai aucun moyen de t’aider à aller mieux…
— Je sais que je te fais du mal. Mais je n’arrive pas à faire autrement. Je me sens comme sonné, vidé de toute énergie.
— Tu te rends seulement compte de ce que tu as fait ce maudit soir ?
— Je me suis fait tabasser comme un con !
— Si ce connard s’est autant acharné sur toi, c’est parce que tu l’as provoqué sciemment… et tu l’as provoqué parce que tu voulais qu’il s’en prenne à toi et pas à moi…
— T’as fait la même chose, juste avant.
— Mais je ne pouvais pas le laisser te démonter la gueule !
— Et moi, donc, tu crois que je pouvais ?
— Tu es mon héros, Jérémie Tommasi !
— Je n’ai pas su te protéger, il me glisse tristement.
— Et comment, tu as su me protéger, tu as risqué ta vie pour moi, tu n’as pas hésité un seul instant à te mettre en danger pour me sauver !
— J’aurais tellement voulu faire plus, t’épargner les coups… il insiste.
— Moi non plus je n’ai pas pu te protéger. On a fait comme on a pu, à deux contre cinq. Mais ce qu’on a pu, on l’a fait, on l’a fait !
Il pleure. Je pleure.
— Tout ça, c’est de ma faute !
— De quoi tu parles, Jérém ?
— C’est moi qui nous ai mis dans cette merde !
— Mais de quoi tu parles ?!
— C’est moi qui t’ai embrassé cette nuit-là ! Si je ne t’avais pas embrassé, rien ne se serait passé !
— Arrête de dire ça, ok ? Avec les « si », on ne va nulle part. Une fois de plus, tu n’as rien à te reprocher. Les seuls à blâmer dans cette histoire ce sont ces cons malbaisés qui s’en prennent à des gars comme nous parce que nous sommes heureux, et pas eux !
A aucun moment j’ai pensé que c’était de sa faute si nous avions été agressés. Pas plus que de la mienne.
Mais sur un point il a raison. C’est bien ce baiser qui a entraîné tout ce désastre. C’est inconcevable, et c’est pourtant la vérité.
Comment imaginer qu’un simple baiser, sublime manifestation de l’amour entre deux êtres, puisse provoquer le dégoût et l’hostilité au point d’entraîner ce qui nous est arrivé cette nuit-là, ainsi que ce sinistre effet domino qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd’hui ?
Comment concevoir que, nous les victimes, soyons punis à cause de ce que nous avons enduré ?
Quand je regarde son visage, quand je regarde son nez au profil désormais un peu cassé, son arcade avec cette cicatrice où les cils n’ont toujours pas repoussé, je revois les marques de la violence que nous avons subie. Je revis l’instant où mon Jérém a failli se faire tuer pour me sauver la vie. Une belle preuve d’amour.
Oui, un simple baiser d’amour a fait basculer notre vie.
Comment aurais-je pu imaginer que ce baiser ce serait notre dernier véritable baiser ?
Comment aurais-je pu imaginer que cette nuit ce serait la dernière fois où nous serions Ourson et P’tit Loup ?
Juin 2007.
Juin, c’est le mois des finales du Top 14.
Le vendredi premier, la demi-finale se joue à Bordeaux, entre le Stade Français et Biarritz. Jérém n’a pas souhaité faire le déplacement. Nous avons regardé le match à la télé, et j’ai vu mon beau brun triste et frustré de ne pas être sur le terrain et ne pas contribuer à cette belle victoire. Les Parisiens s’imposent en effet face aux Biarrots avec un score confortable de 18 à 6.
La semaine suivante, le 9, c’est l’heure de la grande finale. Le Stade Français rencontre Clermont au Stade de France. Cette fois-ci, Jérém accepte l’invitation d’Ulysse d’assister au match. Un match qui se révèle particulièrement difficile. Finalement, au bout de deux mi-temps éprouvantes, les Parisiens s’imposent une nouvelle fois sur un score de 23 à 18.
Le Stade Français est champion du Top 14. Quelques minutes après le coup de sifflet final, les joueurs en rose et bleu s’agglutinent au beau milieu de la pelouse et soulèvent le bouclier de Brennus devant une assistance en délire. Jérém refuse de les rejoindre, malgré la demande d’Ulysse.
— Tu vois, ils gagnent quand même, ils n’ont pas besoin de moi ! me lance Jérém, sur un ton agacé mais surtout plein de désespoir, les yeux emplis de larmes retenues de justesse, partagé entre la joie de voir son équipe gagner et la tristesse de la voir gagner sans lui.
— Tu as toute ta place dans cette équipe, je tente de le réconforter.
— Je suis un jouet cassé, je ne sers plus à rien !
— Tu rejoueras quand tu iras mieux.
— Non, le rugby c’est fini pour moi, il assène tristement.
— Je vais avoir des vacances autour du 14 juillet, j’annonce à Jérém au lendemain de la finale du Top14. Et si on repartait quelques jours en Italie ?
Il me semble que parmi les bons moments que nous avons partagés depuis quelques années, ceux passés au Bel Paese ont été les plus doux. J’aimerais tant retrouver le Jérém insouciant, bien dans sa peau, amoureux de ces vacances transalpines. J’aimerais tant retrouver notre complicité et je me dis que c’est là que j’ai le plus de chance de la raviver .
— Je crois que j’ai envie de partir seul cet été…
— Seul ?
— J’ai besoin de faire le vide dans ma tête.
— Et on ne prend pas de vacances tous les deux ?
— Toi tu as des vacances en juillet, et moi j’ai besoin de partir maintenant.
— Et tu veux aller où ?
— Je ne sais pas encore, je vais improviser.
— Et en juillet, on pourra partir ensemble ?
— Je ne sais pas, on verra.
Juillet 2007.
Juillet arrive, mes vacances avec. Après avoir passé un mois de juin sans pratiquement aucun signe de vie de la part de Jérém, après m’être forcé à respecter son besoin de prendre l’air, après trois semaines à tenter en vain de me convaincre que cette morosité n’est qu’une passade et qu’Ourson et P’tit Loup ne sont pas en danger, je me décide enfin à l’appeler pour avoir de ses nouvelles. J’ai également besoin de savoir ce qu’il en est finalement de ma proposition de partir en Italie, ou là où bon lui semblera, n’importe où, l’important pour moi étant d’être avec lui. Je le suivrais au bout du monde, et même au-delà.
J’essaye de l’appeler une fois, deux fois, trois fois. Je tombe directement sur son répondeur. Je laisse des messages, d’abord sur un ton neutre, en essayant de cacher mon besoin de savoir comment il va, mon besoin de plus en plus urgent de le revoir. Puis, au fur et à mesure que les jours passent et que mes messages n’ont pas de réponse, c’est mon inquiétude qui prend le dessus. Alors mes messages commencent à ressembler à des supplications de me donner des nouvelles, de me dire s’il va bien, et tant pis pour les vacances. Les jours passent sans retour de sa part et je commence sérieusement à m’inquiéter.
J’appelle Maxime pour savoir si de son côté il a plus de nouvelles. Il n’en a pas beaucoup plus que moi. Si ce n’est la destination des vacances en solitaire de son grand frère. Et un dernier message rassurant reçu de sa part quelques jours plus tôt, puis plus rien. Jérém a choisi une destination à l’autre bout du monde. Ce qui explique sans doute en partie l’absence de nouvelles. Car je n’ai aucun doute sur le fait que son silence s’explique également par son besoin de faire le vide dans sa tête, de passer à autre chose, d’oublier. Pourvu qu’il n’oublie pas tout, pourvu qu’il n’oublie pas notre amour, pourvu qu’il n’oublie pas qu’Ourson ne va pas sans P’tit Loup et que P’tit Loup ne va pas sans Ourson.
Dans combien de temps va-t-il revenir ? Va-t-il seulement revenir de cette terre au charme envoûtant qui attire tant une certaine jeunesse assoiffée d’un nouveau départ ? Et s’il croise la route d’un beau surfeur blond capable de faire chavirer son cœur et sa braguette ?
C’est la veille du 14 juillet que je reçois enfin un message de sa part. Mais pas de son numéro habituel. Le message porte un numéro commençant par +61. Croyant d’abord à une erreur de destinataire, la curiosité me pousse cependant à en lire le contenu.
« Salut. Je sui bien, je voyage, je travaille. Dsl pas avoir donné des nouvelles + tot. J espere que tu vas bien. Je revien en aout. Bisous de canberra ».
Oui, Jérém a eu besoin de mettre 20.000 bornes entre lui et ses nouveaux fantômes. Cette distance me donne le vertige. Mais au moins, je sais qu’il va bien et qu’il compte revenir. Pourvu qu’il ne change pas d’avis.
Je traverse le mois de juillet dans une morosité sans fin. C’est bien beau d’avoir des vacances, si on n’a pas l’état d’esprit pour en profiter, ça ne sert à rien. Je suis inquiet quant au retour de Jérém. Et s’il ne revenait pas ? Et s’il revenait changé du tout au tout ?
Le 14 juillet, les feux d’artifice de la fête nationale m’agacent plus qu’ils ne me réjouissent. A Gruissan, malgré la présence d’Elodie, je tourne en rond. J’ai besoin de me changer les idées, et j’en viens à croire que me sentir désiré, ou du moins convoité, m’aiderait à me sentir moins mal, à oublier mes peurs.
Je sors dans une boîte gay, je me perds parfois dans les buissons des plages où rôdent les hommes qui cherchent d’autres hommes. Entre les dunes, je couche avec un brun pas mal du tout. Il est plutôt sensuel pendant qu’il me tringle, il est même prévenant. Il est très beau lorsque sa belle gueule se crispe sous la vague de l’orgasme. Il me branle, me fait jouir. Mon torse parsemé de mes traînées brillantes, sa queue aussitôt retirée d’entre mes cuisses, je le regarde enlever sa capote bien remplie et faire un nœud pour la rendre étanche. L’excitation passée, au moment de se dire au revoir, ou plutôt « adieu », je retrouve ma solitude et mon angoisse.
Le fait est que c’est de Jérém dont j’ai envie, dont j’ai besoin. Aucun gars, aucune aventure ne saura combler cette envie, ce besoin, ce manque.
Août 2007.
Juillet se termine enfin et août arrive. Je salue la reprise du taf comme une délivrance. Car je n’en peux plus de tourner en rond, j’ai besoin de m’occuper l’esprit.
Ma mission jusqu’au mois de septembre est de passer de ferme en ferme pour relever les index des compteurs d’eau des irrigants. Je suis heureux d’être sur le terrain, heureux de découvrir le réseau secondaire découlant du Canal de Saint Martory, cet ouvrage impressionnant qui a révolutionné l’agriculture de la Haute Garonne.
Je passe mes journées à chercher des fermes, des lieux-dits aux assonances patoises, à traquer des agriculteurs et des cabanes d’irrigations, à emprunter des chemins en terre, à me perdre dans la campagne, entre les champs de maïs qui bouchent la vue, à demander à droite et à gauche, à me tromper de chemin, à faire demi-tour, à prendre des jets d’eau sous pression sur le parebrise.
Mais j’aime ça, on dirait un jeu de l’oie géant. J’adore l’odeur de la terre humide, du maïs fraîchement arrosé. J’aime le contact avec ce monde de producteurs, d’agriculteurs discrets et travailleurs qui produisent, il faut bien le rappeler, les biens les plus essentiels qui soient. J’aime cette nature calme, où l’on entend le vent et le chant des oiseaux, l’écoulement de l’eau et le bruissement des feuilles. J’aime cette campagne qui me rappelle Campan, mais aussi le domaine de M. Tommasi. Est-ce que je reverrai un jour ces endroits ? Est-ce que Jérém m’y amènera à nouveau ? La nostalgie me tire parfois les larmes.
Où es-tu, mon Jérém ?
Jeudi 23 août 2007.
Hier, Jérém m’a appelé. Il était au domaine, chez son père. Il était rentré deux jours plus tôt et il n’avait fait que dormir depuis. Il m’a proposé de nous voir ce soir pour dîner ensemble.
Ce soir, je suis très heureux de le retrouver. Et pourtant, au fond de moi, j’ai la sensation que ces retrouvailles ne vont pas se passer comme je les imagine. J’ai l’impression que Jérém a quelque chose à m’annoncer. Et j’ai peur d’entendre ce qu’il a à m’annoncer.
D’ailleurs, le vent d’Autan s’est levé ce matin. Et sa caresse insistante m’inquiète, beaucoup.
Je retrouve mon beau brun dans un resto du centre-ville. Ça fait plus de deux mois que je ne l’ai pas vu. Je le retrouve là, beau comme un Dieu, le teint halé, le bronzage marqué, un peu plus sec que la dernière fois, ce qui met en valeur sa masse musculaire, les cheveux assez courts, la barbe d’une semaine, ce qui met en valeur sa sensualité radioactive. Ce soir, il fait très chaud. Le bogoss est habillé d’une chemisette à fines rayures portée bien près de son torse et de ses biceps, les boutons du haut ouverts jusqu’à dévoiler la naissance de ses pecs.
Les stigmates de notre agression marquent toujours sa belle petite gueule, mais elles me paraissent moins choquantes, moins insupportables.
Ce soir, Jérém est beau à en pleurer. C’est peut-être l’effet des retrouvailles, après deux mois à redouter qu’elles ne se produisent jamais. C’est peut-être le changement dans son regard, son allure, son attitude, son sourire. C’est sa nouvelle sérénité empreinte de gravité. A bientôt 26 ans, Jérém semble transfiguré. Ce voyage semble l’avoir changé, fait mûrir. Oui, il y a quelque chose dans son regard et dans son allure qui n’était pas là avant. Comme des nuances de maturité. Il me semble que désormais, l’homme prend le pas sur le petit con.
Je regarde le menu mais rien ne me fait envie. C’est Jérém qui me fait envie, une envie déraisonnable. Et lui, est-ce qu’il a toujours envie de moi ? Est-ce que nous sommes toujours Ourson et P’tit Loup ?
Pendant le dîner, Jérém me parle de son road trip en Australie.
— J’ai fait du stop, j’ai travaillé dans des fermes, j’ai tondu des brebis.
— J’ai traversé le désert, j’ai longé l’océan pendant des centaines de miles.
— J’ai fait du cheval sur la plage.
— J’ai appris à faire du surf.
— J’ai été voir comment on joue au rugby là-bas, j’ai joué au rugby là-bas.
— J’ai vu des requins blancs et des baleines.
— J’ai vu des kangourous et des koalas.
— Je me suis saoulé la gueule, j’ai été impliqué dans une bagarre et j’ai passé une nuit en cellule.
En évoquant toutes ces expériences nouvelles pour lui, Jérém a les yeux qui brillent. Ça a l’air de lui avoir fait vraiment du bien de changer de décor, je suis heureux pour lui et en même temps triste de ne pas avoir pu partager ces moments avec lui.
— J’ai fait de belles rencontres, j’ai dormi chez l’habitant… il continue.
— Et tu as baisé avec l’habitant ? je ne peux m’empêcher de lui glisser.
— Aussi…
Je ne suis même pas jaloux, il a bien fait d’en profiter. J’espère seulement qu’il a pensé à se protéger.
— Alors, tu as retrouvé l’envie de coucher ?
— Il a fallu que je parte à l’autre bout du monde pour me retrouver.
— Eh, bien, tu en as fait des choses ! Je me suis demandé si tu allais seulement revenir un jour ! je le cherche.
— Je n’ai pas arrêté de penser à toi…
— Ah, bah, c’était pas flagrant !
— Désolé de ne pas avoir donné plus de nouvelles. Mais j’avais besoin de me couper de tout.
— De moi aussi ?
— Ne le prends pas mal, il me glisse, la voix douce, en saisissant ma main, ce qui provoque en moi un intense frisson. J’avais besoin de cette pause, de ces espaces, j’avais vraiment besoin de changer d’air. Tu comprends, Nico ?
Je comprends que Jérém avait besoin de prendre de la distance de tout ce qui le ramenait à cette terrible nuit, et je réalise que je fais sans doute partie des « choses » qui le ramènent à cette nuit, que je suis même la « chose » principale.
— Je crois que je comprends, oui. Et ça t’a fait du bien ?
— Un bien fou.
Une question me titille l’esprit depuis début août, depuis le début du top14. Mais où en est Jérém par rapport à sa carrière de rugbyman ? La question clignote de façon encore plus insistante dans ma tête ce soir.
— Et le rugby ? Tu vas jouer où cette saison ? j’ai besoin de lui demander.
— Je vais régler l’addition, tu m’attends dehors ?
Quelques instants plus tard, Jérém me rejoint dans la rue et me propose d’aller marcher sur les quais de la Garonne.
J’ai le souffle coupé, je tremble. Au fond de moi, j’ai l’intuition que cette marche est un préambule à une discussion que je redoute. Le vent d’Autan souffle toujours. J’ai peur d’entendre ce que Jérém a à me dire.
La proximité du fleuve est l’occasion pour Jérém de me questionner sur mon taf, et pour moi de lui raconter à quel point je suis heureux d’avoir choisi cette voie. Après une longue tirade passionnée de ma part, le silence s’installe entre nous.
Mon beau brun me paraît désormais soucieux. Je sens qu’il a quelque chose à me dire mais que ça ne sort pas. Je crève d’envie et je meurs de peur de savoir.
C’est à l’approche du Pont Neuf que ça vient enfin. Le beau brun s’arrête de marcher, me saisit par le poignet, m’obligeant à m’arrêter à mon tour. Et là, il me glisse, la voix étouffée :
— Asseyons-nous.
Assis sur la pelouse rase, je fixe les arcades et les larges trouées qui ont permis à ce pont de devenir le plus vieux pont de Toulouse. Du coin de l’œil, je capte la présence de mon beau brun. Elle a sur moi l’effet d’un aimant ultrapuissant. Je meurs d’envie de me glisser sur lui, de l’embrasser, de le serrer contre moi, de lui montrer à quel point je suis heureux de le retrouver. Mais je sais que ce n’est ni le moment, ni le lieu. J’attends avec impatience et angoisse qu’il me dise ce qu’il a sur le cœur.
— Je vais arrêter le rugby, il finit par me lancer, comme une bombe, après un long instant de silence.
— Quoi ? T’es pas sérieux ?
— J’y ai longuement réfléchi et ma décision est prise.
— Mais pourquoi ?
— Parce que je ne me sens plus à l’aise dans les vestiaires et sur le terrain.
— C’est à cause de ce qui nous est arrivé ?
— Peu importe, Nico. Je n’ai plus le mental. Et un joueur sans un mental solide, ne sera jamais un bon joueur. Alors, autant arrêter les frais avant de me faire humilier davantage. Je n’ai pas envie de terminer ma carrière comme un looser. Si j’arrête maintenant, il y a des chances qu’on se souvienne de moi pour mes exploits. Si je continue, on se souviendra de moi comme d’un joueur qui a planté sa carrière.
— Mais le rugby c’est toute ta vie !
— Il l’était…
— Et tu crois que tu vas réussir à être heureux sans ?
— Il va bien falloir.
Il va bien falloir. Ces quatre mots résonnent à mes oreilles comme un fardeau insupportable à porter. Je le sens au choix des mots, je le sens au ton sur lequel ils sont prononcés. Sans le rugby, il va être malheureux comme les pierres. Quel gâchis, quel horrible gâchis !
— T’es vraiment sûr qu’il n’y a pas moyen ?
— Oui, sûr et certain.
— Mais la proposition de Toulouse tient toujours, non ?
— Je l’ai refusée.
— Mais tu débloques ou quoi ? C’est une occasion en or !
— Je sais. Mais ça ne changerait rien. Où que je joue, je ne serai plus jamais à l’aise. Il y en a qui ont su ce qui s’est vraiment passé cette nuit-là, et ils ne s’en sont pas privés pour en parler. Le rugby est un petit monde. Les ragots vont très vite et ont la vie longue. Ils vont me suivre, où que j’aille. Il y aura toujours un con pour sortir une réflexion à la con dans un match ou dans une soirée. T’as vu ce qui s’est passé la dernière fois ? Ça s’est terminé avec un carton rouge et cinq journées d’interdiction de jeu…
— Mais ça s’est produit une fois, et…
— Et ça se reproduira ! il me coupe net. Et quand ça arrivera, je réagirai de la même façon. Et le rugby ce sera fini pour moi, de la pire des façons. Et même si ça ne se reproduit pas, j’aurais toujours l’impression qu’un me scrute, qu’on se fout de ma gueule dans mon dos. Ça me prendra toute mon énergie et je n’arriverai plus à jouer comme il faut.
— Mais Jérém ! je proteste, sans trop savoir quels arguments opposer à son analyse que je comprends parfaitement par ailleurs.
— Regarde, Thib a arrêté le rugby, et il est heureux.
— Mais lui l’a fait par choix, pas par peur !
— Le choix, je ne l’ai pas, il lâche tristement, et surtout pas ici, en France…
— Pourquoi, il y aurait mieux ailleurs ?
Je le vois hésiter, pousser un long soupir, comme combattu entre l’envie de parler et celle de se taire.
— Il y a autre chose ? je tente de le mettre à l’aise.
— Laisse tomber !
— Dis-moi, s’il te plaît, je peux tout entendre, tu sais ?
— Je te dis de laisser tomber !
— Tu en as trop dit et pas assez dit. Tu ne peux pas me laisser comme ça ! Tu as eu une autre proposition ?
— Ouais.
— Quel club ?
— C’est pas…
— C’est pas quoi ?
— C’est pas en France.
— Et c’est où ?
— En Angleterre.
— Quoi ?
— Je pourrais jouer dans l’équipe des Wasps.
— C’est qui ces Was… ?
— Les Wasps. C’est une grande équipe anglaise. J’ai sympathisé avec certains joueurs lors des matches des Tournois des Six Nations. Et avec leur entraîneur. Un jour, il m’a dit qu’il y aurait toujours une place pour moi dans son équipe.
— Et si tu partais jouer là-bas, tu pourrais revenir au top ?
— J’aurais plus de chances d’y parvenir qu’en restant ici. Là-bas, personne ne sait pour ce qui m’est arrivé.
Mon cœur bat à tout rompre. Je tremble. J’étouffe.
— De toute façon, ma décision est prise, le rugby c’est fini pour moi.
— Et tu comptes faire quoi si tu arrêtes le rugby ?
— J’ai un diplôme, je vais le mettre à profit. J’ai trouvé une offre d’emploi qui a l’air pas mal. J’ai postulé pour un poste de commercial dans une boîte qui vend des équipements informatiques. J’ai passé un entretien et mon profil leur a plu. Il y a de fortes chances que j’arrive à avoir le job.
— An bon ? Et c’est où ça ?
— A Paris.
— Ah… et tu vas rester à Paris, alors ?
— Oui, mais je vais pas mal voyager.
— Tu es sûr de ton coup ? Tu penses que ce job va te convenir ?
— Il va bien falloir…
Il va bien falloir. Deuxième du nom.
Mille questions s’agitent dans ma tête. Elles tapent si fort que l’une d’entre elles finit par glisser sur mes lèvres.
— Pourquoi tu ne veux pas donner suite à la proposition de l’équipe anglaise ?
— Parce que je n’en ai pas envie !
— Je vois bien que tu crèves d’envie de rejouer et de foutre le camp d’ici !
Puis, au prix d’un effort dont je ne me serais pas cru capable, je lui lance :
— Si tu restes pour moi…
— Arrête, Nico ! il me coupe net.
— Ecoute moi, Jérém, je reviens aussitôt à la charge. Si tu restes pour moi, c’est pas le bon choix. Tu vas te rendre malheureux et tu vas nous rendre malheureux.
Et là, après un silence qui me paraît interminable, je l’entends me glisser, la voix pleine d’émotion :
— Et nous deux ?
Soudain, je repense aux mots du pauvre M. Charles de l’hôtel à Biarritz, à son regret de ne pas avoir suivi l’amour de sa vie au bout du monde. Et je lui balance, sans hésiter un seul instant :
— Amène-moi avec toi !
— Nico… ici tu as un travail qui te plaît, tu as ta famille, tes amis. Tu ne vas pas quitter tout ça pour venir avec moi.
— Je peux le faire, il suffit que tu en aies envie.
— Je ne suis même pas certain que ça marcherait là-bas, je ne peux pas te demander de me suivre alors que je ne sais pas où je vais.
— L’Angleterre n’est pas à l’autre bout du monde, nous trouverons le moyen de nous voir, j’arrive à articuler de justesse, alors que les larmes coulent déjà sur mes joues.
Jérém me prend dans ses bras, me serre très fort contre lui et me chuchote, les lèvres très près de mon oreille :
— Je t’aime, Ourson. Et je crois bien que je ne t’ai jamais autant aimé qu’à cet instant.
— Ne m’oublie pas, Jérém, je lui glisse, comme une bouteille à la mer, comme une prière.
— Je ne sais pas encore si je vais accepter, je dois y réfléchir.
— Quoique tu décides, ne m’oublie pas !
— Ça, ça ne risque pas. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivé dans la vie. Tu seras toujours avec moi ! Je ne t’oublierai jamais ! Jamais !
Et, ce disant, il glisse ses doigts dans l’ouverture de sa belle chemisette, il saisit la chaînette que je lui ai offerte pour ses vingt ans et il me la montre.
Pendant que nous remontons vers la place du Capitole, l’air frais de la nuit caresse ma peau, m’apportant un étrange frisson, une sensation de vide, de manque, de déchirement. Jérém est encore là, il marche à côté de moi, mais j’ai l’impression qu’il est déjà loin. J’ai l’impression que je suis en train de vivre un adieu.
Mercredi 23 août 2017.
Aujourd’hui, ça fait dix ans que Jérém est parti. Et ce soir, il me manque horriblement. Ce soir, après ma journée chargée au bureau pour décider de la réduction du débit du Canal et des restrictions d’usage suite à la sécheresse, je n’ai pas eu le cœur de rester seul dans mon appart. Alors, je suis allé dîner chez Papa et Maman, et je compte bien y rester dormir.
Mais, après le dîner, le vent d’Autan s’est levé. Il a tapé à la fenêtre de ma chambre d’enfant, insistant, inlassable, violent. Comme s’il m’appelait, comme s’il voulait me dire quelque chose. Je l’ai écouté, je suis sorti. Je suis parti me balader.
Mes pas m’ont conduit sur ceux des souvenirs des derniers jours avant le bac. Et, en particulier, à ce mercredi 2 mai 2001 où j’ai traversé les allées pour aller à la rencontre de Jérém, le bogoss sur qui je fantasmais depuis le premier jour du lycée. Le garçon qui avait ravi mon cœur depuis le premier jour du lycée.
C’était le printemps, c’était la première année du nouveau millénaire. Mais c’était surtout et avant tout l’année de mes 18 ans.
Ce jour-là, le vent d’Autan soufflait très fort dans les rues de la ville Rose. Puissant, insistant, il caressait ma peau, chatouillait mes oreilles, me parlait du printemps, un printemps qui se manifestait partout, dans les arbres des allées au feuillage triomphant, dans les massifs fleuris du Grand Rond, dans les t-shirts qui mettaient en valeur la plastique des garçons.
J’ai le net souvenir de la sensation de ce vent dans le dos, accompagnant mes pas, encourageant ma démarche, comme pour faire taire mon hésitation.
Ce jour-là, le vent d’Autan me poussait à aller au bout de mon trajet, il me poussait à marcher tout droit vers la première révision de maths avec Jérém, vers la première révision de ma vie sentimentale, et de ma vie d’adulte.
J’avais filé sur le Boulevard Carnot, je m’étais engagé dans la rue de la Colombette, comme sur un nuage. C’était le début de cette histoire, de mon histoire.
On n’oublie jamais son premier amour, son seul amour. Mais où es-tu, Jérém ? Au fond de moi, je sais que nous nous retrouverons, que le destin nous réunira un jour. On se l'est promis tous les deux, on se l'est promis sans mots, sans formule. C’est une promesse que j’ai lue dans tes yeux, une promesse que je serre à moi depuis longtemps déjà. On se l'est promis par une belle soirée d'été d’il y a dix ans, après avoir fait l’amour pour la dernière fois avant de nous quitter.
Tout était beau, tout était parfait ce soir-là. Et je n’ai qu’un seul, immense regret. Celui de ne pas avoir su trouver les mots qui auraient pu t’apaiser, ce petit rien qui aurait pu te retenir.
Il m’a fallu longtemps pour comprendre que ces mots n’existaient pas, et que ce petit rien était en réalité un immense tout qui n’était pas à ma portée.
J’ai parfois regretté de pas m’être battu davantage pour te suivre au bout du monde. J’ai essayé de te détester pour le fait d’avoir pris ta liberté si facilement après avoir reçu ma bénédiction. Je n’ai pas réussi. Car, au fond de moi, je suis heureux d’avoir d’une certaine façon contribué à t’offrir quelques belles années de rugby supplémentaires.
Non, je n’ai jamais oublié la puissance du vent d’Autan cet après-midi de mai d’il y a seize ans. Pas plus que j’ai oublié celle du même vent d’Autan le soir où nous avons marché le long de la Garonne, il y a dix ans déjà. Tout comme je n’ai jamais pu t’oublier, mon Jérém. Bien que depuis tant de temps déjà, nos vies ne marchent plus ensemble.
Ce soir le vent qui frappe à ma porte
Me parle des amours mortes
Et je pense aux jours lointains
(...)
Que reste-t-il de nos amours
Que reste-t-il de ces beaux jours
Une photo, vieille photo…
FIN DE LA SAISON 3 de Jérém&Nico.
Le premier épisode de la saison 4, « JN0401 Le temps apaisera la blessure », est prévu pour le courant du mois de juin 2023.
Alors, à l'occasion de ce dernier épisode de saison, lâche toi, cher lecteur, chère lectrice, je t'invite chaleureusement à t'exprimer, à me dire ce qui t'a poussé à suivre Jérém et Nico depuis bientôt 9 ans, à lire des milliers de pages.Dis moi, dis nous, ce que tu as aimé, et même ce que tu as moins aimé. Raconte moi ce que tu penses de ce final de saison et ce qu'il t'inspire pour la suite.
Au plaisir de vous lire, Fabien, avril 2023
 31 commentaires
31 commentaires
-
Par fab75du31 le 31 Mars 2023 à 23:52
Après l’agression homophobe dont nous avons été les cibles, je reviens voir Jérém chaque après-midi à l’hôpital. Jour après jour, je constate avec une immense tristesse que ce que je redoutais est bel et bien en train de se produire. Jérém est distant, absent, amorphe. Et notre parfaite complicité des derniers mois semble s’être envolée.
J’essaie de me dire que c’est l’effet du choc, et aussi que le fait de se refermer sur lui-même dans l’adversité est un réflexe typique de mon beau brun, et que tout reviendra bientôt comme avant. J’essaie de me dire également que le milieu hospitalier, où l’intimité est presque impossible, doit provoquer en lui un certain malaise, une certaine réticence à se montrer proche de moi.
Mais au fond de moi, j’ai peur que nous ayons perdu la connexion qui nous liait. Et de ne pas arriver à la retrouver de sitôt.
Au bout d’une semaine d’hospitalisation, Jérém est autorisé à rentrer chez lui. Avec toute une panoplie de consignes.
Déjà, celle d’éviter toute activité physique pendant six semaines, ceci afin de permettre à ses côtes cassées de guérir. Mais aussi pour prévenir le moindre coup à son nez encore fragile, ce qui pourrait aggraver son état. Bon, le repos, ça ne devrait pas être trop compliqué à tenir, vu la douleur visiblement provoquée chez mon Jérém par le moindre mouvement.
Autre consigne, celle d’avoir quelqu’un à ses côtés pour l’aider au quotidien, comme pour se lever du lit ou du canapé, pour se déplacer en toute sécurité. Je me suis évidemment porté candidat, et Jérém a validé ma candidature sans broncher.
Et, dernière consigne, ou plutôt une chaude recommandation, d’aller voir un professionnel qui pourrait l’aider à surmonter le traumatisme de l’agression.
D’ailleurs, j’ai moi aussi reçu cette recommandation à l’occasion de ma sortie. Et je l’ai suivie. J’ai pu ainsi me rendre à une première séance chez un psy indiqué par l’hôpital. Et ça m’a fait du bien.
Le type ne m’a pas demandé de parler de l’agression. Il m’a juste demandé comment je me sentais. J’ai parlé pendant une heure. Je me suis laissé aller à un long monologue, ponctué de temps en temps par une question, un commentaire, un simple mot de mon interlocuteur. Une sorte de tutorat verbal et mental. Au bout de la séance, une fatigue vertigineuse s’était emparée de mon corps et de mon esprit. Comme si un rouleau compresseur m’était passé dessus.
Ce qui était vrai, dans un certain sens. Pour aller mieux, il faut laisser s’exprimer ce qui fait mal. Pour retrouver le sourire, il faut parfois passer par les larmes.
Le lendemain de la sortie de Jérém de l’hôpital, Maxime retourne lui aussi dans le Sud-Ouest, M. Tommasi et Alice ayant quitté Paris depuis quelques jours déjà, appelés par leurs obligations professionnelles respectives. Maxime est rassuré par le fait que je puisse passer quelques jours à côté de son grand frère. Ça me rassure aussi, même si je redoute la lourdeur de la tâche. L’expérience me rappelle qu’il n’est pas aisé de s’occuper de Jérém quand il ne va pas bien.
L’expérience ne se trompe pas.
De retour à l’appart, Jérém est en plein dans le déni. Il n’admet pas qu’il va mal, et il se renferme comme une huître. Les maux de tête sont à nouveau là, avec les insomnies. Et les angoisses dont il ne veut pas me parler, dont il nie l’existence même.
— Je vais bien, très bien même, arrête de me casser les couilles tout le temps avec tes questions !
Bien évidemment, il ne veut même pas entendre parler d’aller voir un psy.
Je sens que c’est parti comme il y a trois ans, je vais devoir endurer de longues journées à essayer de passer entre ses sautes d’humeur, outre sa morosité hostile, d’éviter le clash et l’épuisement. Je sais qu’il va mal, et je vais tout faire pour être là pour lui. Je vais prendre sur moi, je vais être aux petits soins
Oui, Jérém va mal. Déjà, physiquement. Je partage avec lui la douleur sourde des coups reçus, dont nos visages et nos corps sont toujours marqués. Mais aussi psychologiquement. Je partage également avec lui le traumatisme d’avoir été agressés en raison de notre orientation sexuelle. C’est-à-dire, gratuitement, sans raison valable. Nous n’avons pas mérité ce qui nous est arrivé, nous n’avons rien fait de mal. Nous avons été les cibles d’une violence inouïe, injustifiée, intolérable.
Oui, nous avons vécu la même agression. Mais Jérém est plus mal en point que moi. Il a enduré plus de violence que moi. Ses côtes lui rendent la vie impossible, le rendent invalide. Et alors que je m’en sors relativement à bon compte, Jérém risque de porter de lourdes séquelles de cette agression.
Six semaines d’immobilisation, ce sont autant de semaines de rugby perdues, sans compter le temps de remise en forme avant de revenir sur le terrain. Et quand je vois ce gros pansement qui défigure sa belle gueule et qui ne doit pas être facile à supporter non plus, je ne peux m’empêcher de me demander si son nez va guérir correctement.
Toutes ces questions, Jérém doit se les poser en boucle H24. Alors, je peux comprendre qu’il n’aille pas bien du tout.
Jours après jour, les bleus évoluent, changent de couleur, se résorbent peu à peu. Le temps calme les douleurs, la chair efface les traces des coups. Mais le traumatisme reste. Je suis persuadé que Jérém est lui aussi hanté par les images de notre agression. Son sommeil est agité, ponctué par des spasmes, peuplé de cauchemars. Ses réveils en sursaut au beau milieu de la nuit sont courants. Je ne peux même pas le prendre dans mes bras, au risque de lui provoquer des souffrances intolérables. Je me blottis tout doucement contre lui, mais je sens qu’il ne supporte pas que je sois témoin de sa souffrance.
L’alcool revient dans son quotidien. Tout comme la cigarette, abandonnée plus d’un an auparavant lors de notre retour du voyage en Italie, moment si heureux. Tout comme le joint, abandonné depuis sa récupération au centre de Capbreton, au moment où il retrouvait espoir dans son avenir.
Je reconnais cette attitude, c’est la même qu’il avait adoptée lors de son accident au rugby. Comment le sortir de cette spirale autodestructrice ?
J’essaie de lui dire que ça nous ferait peut-être du bien de parler de ce qui s’est passé. Mais il balaie ça du revers de la main, avec un agacement agressif.
Jérém est de plus en plus taciturne, de plus en plus distant, de plus en plus irritable, de plus en plus négatif, de plus en plus hostile à mes attentions. Ce qui me rassure, c’est que malgré tout, il accepte ma présence, il accepte que je m’occupe de lui.
Mais jusqu’à quand ? Je sais que je ne suis pas à l’abri du fait qu’il me demande de partir sur un coup de sang. En attendant, j’ai demandé à retarder ma prise de poste à Toulouse de deux mois et cela a été accepté. Ça me laisse du temps pour rester aux côtés de Jérém. Même si j’ai l’impression de le regarder aller de plus en plus mal, et que je me sens impuissant pour l’aider à aller mieux.
Les séances chez le psy m’aident à tenir le coup. C’est surtout le fait de me sentir pris en charge qui me fait du bien. Et d’avoir quelqu’un qui m’aide à remettre de l’ordre dans mes pensées désordonnées et perturbées. J’ai pu me voir dans le regard de ce professionnel comme dans un miroir, un miroir m’obligeant à me regarder tel que je suis, dans mon plus simple appareil psychique.
Je sais que le chemin va être long pour retrouver la sérénité, mais je sais désormais qu’un chemin existe et que je l’ai emprunté. Je ne peux m’empêcher de vanter les bienfaits de la thérapie auprès de Jérém, et de l’inviter à entreprendre cette démarche fortement conseillée aux victimes d’agression.
Mais mon beau brun se montre très agacé :
— Arrête de me les briser avec ton psy ! Tu peux aller en voir dix si ça te chante, je n’irai pas !
Fin octobre, le pansement au nez de Jérém est enfin retiré. Ce que je craignais se confirme. Son arête nasale est désormais légèrement mais définitivement cassée, ce qui lui confère un profil typiquement « rugbyman ». C’est un détail qui n'enlève rien du tout à sa superbe beauté. C’est un détail qui n’aurait presque pas d’importance, et qui ajouterait presque un charme supplémentaire s’il n’était que la conséquence d’un accident au rugby.
Mais ce n’est pas le cas. Car ce détail, au beau milieu de sa belle petite gueule, est la conséquence de notre agression. Alors, c’est un détail qui change tout. Jérémie va porter à vie les stigmates de ce qui nous est arrivé. Il va les avoir sous les yeux chaque fois qu’il se regardera dans une glace, chaque jour de sa vie. Moi aussi je vais les avoir sous les yeux, chaque fois que je vais le regarder.
— Je vais me faire opérer, il annonce solennellement au médecin qui tente de le convaincre en vain que cette petite cassure est presque imperceptible.
— Pour ça, il faudra attendre quelques mois que tout soit bien cicatrisé. D’ici là, vous vous y serez peut-être fait…
— Ça ne risque pas !
Le constat de ce changement physique plonge un peu plus Jérém dans sa morosité. J’ai beau essayer de le réconforter, de lui dire qu’il est toujours aussi beau, je n’y gagne que plus d’agacement de sa part.
Dans cette ambiance étouffante, un rayon de soleil se pointe tous les deux ou trois jours. Ulysse vient régulièrement à l’appart avec des pizzas ou des plats de traiteur.
Lors de l’une de ses visites, le beau blond amène une copie du calendrier et du DVD. La photo de couverture me frappe comme à la première découverte. La beauté, l’insolence, l’assurance et la sensualité bouillantes dégagées par ce garçon qui étire l’élastique de son boxer comme pour inviter à plonger le regard dedans sont juste insoutenables.
J’ai envie de pleurer. Je donnerais tout pour retrouver cette attitude, cette assurance, cette insolence, pour retrouver ce Jérém là, un Jérém conquérant. Je donnerais tout pour retrouver le Jérém qu’on voit sur les images filmées, le Jérém qui fait le con avec ses coéquipiers, qui blague avec les techniciens du studio, qui a un fou rire en essayant de prendre la pose devant l’objectif. Dans ces images filmées, Jérém a l’air si épanoui, si heureux, et ça me fait mal au cœur qu’on l’ait privé de tout ça.
Devant ces images filmées quelques semaines plus tôt, mais appartenant presque à une autre vie, devant le Jérém « d’avant », le Jérém « d’après » a l’air de plus en plus triste et dégoûté. A un moment, il s’arrache du canapé en se contorsionnant, tout en refusant que je l’aide, et disparaît dans le couloir. L’imaginant aux toilettes, Ulysse et moi attendons son retour pendant de longues minutes. Ne le voyant pas revenir, je l’appelle. N’ayant pas de réponse, je pars à sa recherche, Ulysse à mes baskets. Nous le retrouvons au lit, dans le noir.
— Eh, Jérém, ça va pas ? l’interroge Ulysse.
— Je suis fatigué, laissez-moi dormir !
— Tu n’es pas fatigué, tu es blessé, tu es en colère, tu as peur. C’est normal après ce qui t’es arrivé.
— Occupe-toi de ton cul !
— Arrête de te torturer l’esprit, Jérém ! Dans quelque temps, tu vas rejouer, et quand tu retrouveras le bruit du stade, tout ça ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
— Je ne rejouerai pas.
— Ne dis pas de bêtises. Tes blessures ne sont pas si graves. En tout cas, beaucoup moins que celles de l’accident au match il y a trois ans. Ta convalescence ne va pas être aussi longue, d’ici le printemps tu pourras rejouer.
— Non, je n’y arriverai pas.
— Et pourquoi, ça ?
— Parce que je n’y arriverai pas ! Fiche-moi la paix !
— C’est dur ce que tu as vécu, et il faut du temps pour s’en remettre. Mais c’est pas en restant enfermé chez toi que tu vas aller mieux. Tu es fait pour fouler les pelouses, pour marquer des points. C’est là que tu es heureux ! Tu n’as pas pu oublier ça ! Et si tu l’as oublié, compte sur moi pour te le rappeler !
— Est-ce que ça jase dans les vestiaires ?
— De quoi tu parles ?
— Est-ce que tout le monde a cru à cette histoire de vol ?
— Je pense que oui…
— Tu me caches quelque chose, Uly, je le sais !
— Ok, il y a des bruits qui courent. Mais personne n’y croit. Et je travaille dur pour les faire taire.
— Tu vois, c’est foutu pour moi.
— Tu dois revenir. L’équipe a besoin de toi et tu as besoin de l’équipe. Repose-toi bien, et reviens plus fort qu’avant. Quand tu marqueras à nouveau des points, personne n’osera te casser les couilles.
— Je n’y arriverai pas, je te dis, ils ne m’en laisseront pas l’occasion.
— Concentre-toi sur toi-même et sur ta récupération, et ignore le reste.
Soudain, je repense aux mots d’Ulysse après l’accident de Jérém lors du match contre Biarritz :
— Les blessures les plus difficiles à guérir ce sont celles qui ne se voient pas, celles à l’intérieur.
Et la blessure que Jérém porte à l’intérieur semble vraiment profonde, et pas prête de cicatriser.
— Tu es si beau sur la couverture du calendrier, tu es à tomber, tu es le plus beau de tous ! je lui glisse après le départ d’Ulysse.
— Je l’étais…
— Tu l’es toujours !
— Non, je ne le suis plus. Et je ne le serai plus jamais.
Novembre 2006.
Un mois après l’agression, Jérém passe une journée à l’hôpital pour un check-up complet. D’après les médecins, son corps récupère vite et bien. L’épaule démise guérit correctement, les côtes et le nez aussi. On lui annonce qu’il pourra reprendre la musculation dans une quinzaine de jours, et même des entraînements aménagés. Mais Jérém ne semble pas plus ravi que ça. Sa réaction ressemble plutôt à de la peur.
Quelque chose semble s’être brisé au plus profond de lui. Je préférerais de loin le voir éructer sa rage, sa colère, plutôt que de le voir si apathique, si démissionnaire.
Un soir, au lit, j’ai envie de lui donner du plaisir. Mais je ne peux même pas glisser ma main dans son boxer. Dès que mes doigts effleurent son pubis, son corps a une réaction immédiate et violente. Il bondit carrément, comme un ressort. Action, réaction, sa main attrape la mienne et l’éloigne aussitôt.
— Je n’ai pas envie.
— C’est pas grave. Je peux au moins te prendre dans mes bras ?
— Ouais…
La tendresse est tout ce que j’aurai ce soir, et ceux qui suivront. Mais une tendresse à sens unique, sans retour de sa part. Je tente de faire bonne figure, mais j’ai envie de pleurer.
Début décembre 2006.
Les jours passent, et son abattement est de plus en plus flagrant. Ça me fait un mal de chien de le voir dans cet état et de ne rien pouvoir faire pour l’aider à aller mieux. J’ai pensé à une nouvelle excursion à Campan, mais il a refusé catégoriquement.
Puis, un jour, ce que je redoutais depuis des semaines se produit.
— Tu devrais rentrer à Toulouse, il me balance sur un coup de colère, au beau milieu d’une dispute.
Un accrochage parti d’une réflexion que je n’ai pas pu me retenir de lui balancer sur sa façon de se laisser aller, de se fermer en boule et de refuser de l’aide.
— Tu plaisantes, j’espère !
— Pas du tout !
— Mais qui va s’occuper de toi ?
— L’aide-soignante.
— Mais elle ne vient qu’une heure !
— Ça suffit !
— Une heure, ça suffit ? Et le reste du temps, si tu as besoin de…
— Non, toi, ça suffit ! il me coupe net.
— Tu en as marre de moi ?
— J’en ai marre que tu me voies comme ça.
— Pourquoi tu refuses de te faire aider ?
— Parce que je ne suis pas prêt.
— Tu ne le seras jamais ! C’est justement parce que tu n’es pas prêt qu’il faut y aller.
— Arrête, Nico !
— Tu veux vraiment que je parte ?
— Oui. J’ai besoin d’être seul. J’ai besoin de faire le point…
— Le point… sur quoi ? je m’inquiète.
— Sur tout !
— Et sur moi aussi ?
— Va-t’en, Nico ! ce sera son dernier mot.
Quand il va mal, Jérém se renferme sur lui-même et fait le vide autour de lui. Et dans ce ménage radical, Nico est dégagé avec tout le reste. C’est son mode de fonctionnement et je sais que je ne pourrais pas m’y opposer, car ça ne servirait à rien. J’essaie de me rassurer en me disant qu’il y a eu d’autres clashes, d’autre séparations, d’autres moments où Jérém n’allait pas bien. Et qu’il a toujours fini par revenir vers moi.
Et pourtant, quelque chose au fond de moi me dit que cette fois-ci, c’est plus grave, beaucoup plus grave.
C’est un déchirement de partir et de le laisser dans cet état. L’idée qu’il se retrouve seul me terrorise. Il me semble que des idées noires tournent par moments dans sa tête. Pourvu qu’il ne fasse pas de bêtises. Si ça arrivait, je ne me le pardonnerais pas.
Toulouse, décembre 2006.
Comme je l’avais imaginé, Jérém n’est pas vraiment assidu au téléphone. Heureusement, j’arrive à avoir de ses nouvelles par Ulysse qui a intensifié la cadence de ses visites depuis mon départ. Il passe désormais voir son coéquipier chaque soir. Ce gars est vraiment adorable.
A Toulouse, je me fais un sang d’encre. Je ne suis pas bien. A la tristesse et à la frustration engendrées par la distance de Jérém s’ajoute le fait d’avoir de fait interrompu la thérapie avec le psy parisien. Je n’ai pas envie d’aller voir un autre psy, de devoir tout recommencer.
Heureusement mes parents, ma cousine, Thibault et Julien, le beau moniteur d’auto-école, sont là pour me soutenir.
Cependant, ce mois de décembre semble passer au ralenti, plombé par l’inquiétude et la morosité. Noël approche, les illuminations éclairent la ville, le marché éphémère se déploie sur la place du Capitole, l’ambiance de Noël s’installe. L’ambiance est à la fête, mais pas dans mon cœur. Le silence de Jérém m’inquiète horriblement.
Mercredi 20 décembre 2006.
Quelques jours avant le réveillon, sans nouvelles de Jérém depuis près d’une semaine, je suis à deux doigts de prendre le train pour aller le rejoindre à Paris.
Mais le jour même où cette résolution s’impose dans ma tête, le beau brun m’appelle enfin. Il m’appelle pour m’annoncer qu’il va passer Noël chez son père et pour m’inviter à aller le rejoindre.
En voilà une bien bonne nouvelle ! Je suis si heureux. Peut-être que ces dernières semaines n’ont pas été inutiles, peut-être qu’il avait vraiment besoin d’être seul, de faire le point, de se retrouver. Peut-être que ça lui a fait du bien. Peut-être que nous allons enfin retrouver cette complicité que nous avons perdue depuis l’agression.
Samedi 23 décembre 2006.
Je débarque au vignoble l’avant-veille de Noël. Jérém a l’air content de me voir. Il vient m’accueillir dans la cour, il me serre très fort dans ses bras, il m’embrasse. Quant à moi, je suis tellement ému que j’ai du mal à retenir mes larmes.
Les bleus sur son visage ont enfin disparu. Mais son nez a gardé cette légère cassure.
Depuis mon départ de Paris, Jérém a repris la musculation, mais toujours pas les entraînements. Au premier abord, il semble aller mieux.
Pourtant, au fil des heures, je réalise que ce n’est toujours pas ça. Après le sursaut des retrouvailles, Jérém redevient très vite taciturne, distant. J’ai l’impression que s’il m’a fait venir, c’est parce qu’il espérait que ma présence l’aiderait à aller mieux. Visiblement, ce n’est pas le cas.
En attendant, je ne fais rien pour le brusquer, et je m’associe à la bonne humeur de Maxime pour créer l’ambiance la plus festive et décontractée possible.
Le réveillon de Noël arrive, et c’est plutôt un bon moment. Sophie, la belle-mère de Jérém, a mis les petits plats dans les grands, elle nous a concocté un repas raffiné. La conversation à table est riche, amusante. Maxime a toujours quelque chose de drôle à raconter, il est vraiment marrant.
Tout le monde semble se régaler, s’amuser. Tout le monde, sauf Jérém. Mon beau brun semble complètement ailleurs. Il ne décroche pas un mot, et il sourit encore moins. Quand il parle, c’est vraiment parce qu’il y est obligé, parce qu’on le questionne directement. Et le plus souvent, ses réponses sont laconiques. Quand il sourit, c’est pour faire bonne figure. Mais on voit bien que le cœur n’y est pas. Sa morosité m’affecte énormément. Et ça me gâche mon réveillon. Je suis inquiet pour lui. On dirait que la joie des autres le rend d’autant plus triste.
Minuit n’est passé que depuis quelques minutes lorsque mon bobrun annonce son intention d’aller se coucher. Maxime le charrie, lui dit qu’il l’a connu plus fringant, plus fêtard, « avant ».
— Avant, c’était avant, lâche tristement Jérém, avant de disparaître dans l’escalier.
— Je me fais du souci pour ce garçon, j’entends Sophie glisser à M. Tommasi.
— Moi non plus je n’aime pas le voir comme ça, admet ce dernier. Mais ça va lui passer. Il va surmonter ça.
— Ce qu’il a vécu est trop dur, il ne s’en sortira pas tout seul ! considère Maxime avec inquiétude.
— Et toi, Nico, comment ça va ? m’interroge M. Tommasi.
— Pas trop mal. J’ai toujours des flashes de ce qui s’est passé, il m’arrive d’en faire des cauchemars. Mais ça m’a fait du bien d’aller voir un psy.
— Tu peux pas essayer de lui en toucher deux mots ? Il t’écoute, toi !
— Il m’écoute quand il en a envie ! Je n’ai jamais pu le convaincre de faire quelque chose dont il n’avait pas envie.
— Tu veux essayer ?
— Je peux. Mais il va se braquer, et c’est tout ce que je vais obtenir.
Un quart d’heure après le forfait de Jérém, je m’éclipse à mon tour. Je monte l’escalier pour aller rejoindre P’tit Loup dans sa chambre d’enfant.
— Tu dors ?
— Oui !
— Oui, c’est ça ! je le charrie.
— Pourquoi t’es monté si tôt ? il me demande, la voix traversée par un certain agacement.
— Je pourrais te poser la même question !
— J’avais sommeil !
— Eh ben, moi aussi !
— C’est ça, oui…
— Je suis monté parce que je m’inquiète pour toi… tout le monde s’inquiète pour toi…
— Arrêtez de vous inquiéter, vous me cassez les burnes !
— Ok, ok, je suis monté parce que j’avais envie d’être avec toi, si tu préfères.
— Je peux dormir seul.
— Je sais. Mais moi j’ai envie de dormir avec toi. Et j’ai envie de te serrer contre moi. Je peux ?
— Viens…
Son corps musclé emplit mes bras de chaleur, mon esprit de bonheur.
— Je suis content que tu m’aies demandé de venir fêter Noël ici.
Un instant plus tard, mes lèvres se promènent doucement sur son cou, ma langue titille ses oreilles. Mes mains se baladent lentement sur son torse, mes doigts se laissent enchanter par le relief toujours aussi impressionnant de ses pecs, par la délicieuse douceur de sa peau, se perdent dans la contemplation tactile de ses poils, se laissent longuement happer par ses merveilleux tétons saillants. Puis, ils redescendent, parcourent à l’aveugle la gravure de ses abdos, s’amusent à les compter, à en mesurer les creux et les reliefs. Mon beau brun semble apprécier. Il me semble que sa respiration a changé, que son souffle est celui d’un garçon excité.
Je m’enhardis alors. Je laisse le bout de mes doigts se glisser entre l’élastique de son boxer et ses poils pubiens, je les laisse effleurer la naissance de sa queue. Et là, je constate qu’elle est bien chaude, bien tendue.
Je me glisse entre ses cuisses musclées et je pose mon nez et mes lèvres par-dessus le coton élastique, je cherche et je trouve le gland en tâtonnant avec ma langue, je titille le frein à travers le tissu fin. J’ai envie d’exciter mon beau brun, de le faire un brin s’impatienter, de le chauffer, j’ai envie de marquer le coup à l’occasion de nos retrouvailles sensuelles.
Mais ce soir, Jérém n’est pas d’humeur à faire durer les préliminaires.
— Suce-moi ! je l’entends me lancer sèchement.
Je m’exécute sur le champ, avec un bonheur infini. J’attrape l’élastique de chaque côté de son bassin, je fais glisser le boxer le long de ses cuisses. J’avale sa queue bien raide, à nouveau magnifiquement insolente. Je le pompe avec entrain, impatient de lui offrir enfin du plaisir. Quelques minutes plus tard, je suis si heureux de l’entendre me glisser :
— Je vais jouir…
Et je reçois aussitôt dans ma bouche la première d’une belle série de bonnes giclées chaudes, les premières dont il me fait cadeau depuis notre agression.
Entre Noël et le Jour de l’An.
Les jours suivants sont accaparés et quelque part égayés par le travail de la vigne. C’est l’époque de la taille, et tout le monde met la main à la pâte. M. Tommasi et Sylvie, Maxime et sa copine, mais aussi Jérém. Bien évidemment, je suis le mouvement. Au grand air, occupé par une activité physique, Jérém semble plus serein. Toujours aussi taciturne, mais serein. Et toujours aussi furieusement sexy, même avec une cotte de travail.
Le reste du temps, pendant les pauses, durant les repas, sa morosité est toujours aussi présente. Chaque soir, j’ai désormais droit de lui faire une pipe. Et ça, ça fait du bien. Mais ces petits moments de complicité sensuelle ne sont suivis d’aucune avancée de notre complicité affective. Jérém n’a pas envie de parler, et s’endort aussitôt après avoir joui.
Cette année encore, nous passons le réveillon du 31 à Campan. Cette année, Thibault est là aussi, accompagné de son adorable Arthur.
— Mais c’est pas possible, vous allez tous nous les piquer ! fait Satine, dépitée, en contemplant le joli couple de pompiers.
Les Cavaliers ont la délicatesse de croire, ou de faire semblant de croire, ce qu’ont raconté les journaux au sujet de l’agression de Jérém. De ne pas poser trop de questions sur ce qui s’est passé en cette horrible nuit parisienne. Et de ne pas faire de commentaires sur le petit changement de profil de Jérém.
L’ambiance est celle des soirées de fête, une folle ambiance faite de vannes potaches, de rires sonores, d’amitié. Mais même la bonne humeur et la bienveillance des cavaliers n’ont pas raison de la morosité de Jérém. Comme lors du réveillon de Noël, Jérém est taciturne, absent, et il ne se mélange pas à la fête. Il passe quasiment plus de temps à côté de la grande cheminée à griller des cigarettes qu’assis à table.
— Il ne va pas bien, hein ? me questionne discrètement Charlène lorsque Jérém part pisser dehors.
— Non, il ne va pas bien, j’admets, touché et attristé.
— C’est violent ce qu’il a vécu. Il voit quelqu’un ?
— Il ne veut pas. J’ai essayé de lui faire changer d’avis, mais il n’y a rien à faire. Il est têtu comme une mule.
— On dirait que quelque chose a cassé en lui, l’élan de sa jeunesse, son insouciance, sa joie de vivre, avance le sage Jean-Paul.
J’en ai les larmes aux yeux. Parce qu’en une seule phrase, JP a mis le doigt exactement là où le bât blesse.
De retour de sa pause pipi, Jérém est questionné par Martine au sujet de ses entraînements. Je l’entends lui mentir, lui dire que ça fait trois semaines qu’il a repris.
La nuit s’étire comme d’habitude sur les notes de la guitare de Daniel et sur le chœur à trop de voix toutes les unes plus fausses que les autres qui tentent de l’accompagner.
Cette nuit, ça fait cinq ans que Jérém m’a dit « Je t’aime » dans la petite maison. C’était après avoir fait l’amour et c’était la première fois qu’il me disait « je t’aime ».
Cette nuit, nous ne dormons pas à la petite maison, mais chez Charlène. Nous ne faisons pas l’amour. Et Jérém ne me dit pas « je t’aime » non plus. Je lui dis, moi.
— Je t’aime, P’tit Loup !
Pour toute réponse, il attrape mon bras, celui qui l’enlace et m’attire un peu plus contre son dos.
Depuis notre agression, Jérém ne m’a jamais encore pris dans ses bras. Mais il a souvent accepté que je le prenne dans les miens. Il fut un temps où dans ses bras puissants j’avais l’impression que rien ne pouvait m’arriver. Maintenant, c’est à mon tour d’offrir les miens pour le faire se sentir protégé. Je suis heureux qu’il se sente bien dans mes bras.
— Je suis désolé, Nico… je l’entends me glisser à mi-voix.
— Désolé de quoi ?
— De ne pouvoir te donner plus.
— Tu es là, tu es en bonne santé, et c’est tout ce qui compte.
— Je ne suis pas bien, Nico.
— Je sais. Mais je suis là. Tu entends ? Je suis là !
Lundi 1er janvier 2007.
C’est le lendemain que je gaffe. Au détour d’une conversation, j’évoque ma sortie de l’hôpital. Ce qui ne colle pas du tout avec la version officielle de l’accident de Jérém. Dès lors, Charlène nous oblige à lui dire la vérité sur l’agression.
— Cinq mecs pour en agresser deux ? Parce que vous êtes pédés ? Il y en a vraiment qui sont venus au monde juste parce que leurs parents ont oublié de mettre une capote !
— C’est clair ! je confirme.
— Pourquoi vous ne m’en avez pas parlé avant ?
— On ne voulait pas te faire de la peine. Tu n’aurais pas profité du réveillon, lui glisse Jérém.
— C’est pas faux. Mais quand-même !
— Maintenant, tu sais. Le sujet est clos.
— A te regarder, on dirait que ce n’est pas vraiment le cas.
— T’occupe ! Et surtout, tu n’en parles à personne.
— Tu sais que tu peux compter sur moi.
— Même pas à Martine, ok ?
Mardi 02 janvier 2007.
C’est ce matin que nous quittons la maison de Charlène, Campan et les Pyrénées. Cette nuit, Jérém n’a pas bien dormi. Il s’est levé toutes les heures pour fumer. Le fait que Charlène soir désormais au courant, le tracasse. Il a peur qu’elle s’inquiète. Au petit déjeuner, il porte sur lui les traces de la nuit presque blanche, le teint pâle, de beaux cernes.
— Ça n’a pas l’air d’aller, lui glisse la maîtresse de maison.
— Je n’ai pas bien dormi.
— Je ne te parle pas de ce matin, je te parle du fait que tu ne vas pas bien du tout en ce moment.
— Fiche-moi la paix de bon matin ! ! Je vais bien, ok ?
— Non, tu vas mal, tu vas même très mal. Et si tu continues comme ça, tu vas aller de plus en plus mal et tu n’arriveras pas à remonter la pente.
— Tu me casses les couilles à la fin !
— Je sais, j’imagine. Mais je m’en voudrais de te voir déraper sans t’avoir parlé franchement.
— J’ai pas besoin de leçons. Allez, on se casse, me lance Jérém en se levant de sa chaise d’un bond.
Charlène se lève d’un bond elle aussi.
— Assieds-toi ! Tu vas m’écouter cinq minutes, petit con !
— Qu’est-ce qu’il y a encore… fait Jérém, en changeant soudainement de ton.
— Tu t’es vu seulement ?
— Quoi ?!
— Tu as la gueule d’un déterré ! Tu as 25 ans, tu es dans la fleur de l’âge, bordel ! Tu es beau comme un Dieu, tu es en bonne santé, et tu as de l’or dans tes mains et tes pieds.
— Mais je n’ai plus envie de jouer !
— Tu as vécu quelque chose d’horrible et…
— Tu ne sais rien de ce que j’ai vécu !
— C’est vrai, mais je vais te dire les choses telles que je les vois.
— Je t’écoute ! lui lance Jérém sur un ton de défi.
— Oui, tu t’es fait tabasser parce que tu es pédé. Oui, c’est injuste. Et alors ? Tu crois que c’est pire que d’avoir un accident de voiture ? Il y en a qui ont été amochés bien pire que toi et qui se sont relevés et ont su remonter la pente. Il faut que tu t’accroches, il faut que tu te bouges le cul, sinon, tu vas rater le train de ta vie !
— Je n’y arrive pas ! J’ai pas envie de me lever le matin, j’ai même plus envie de baiser ! Je n’ai plus goût à rien.
Ça me fait de la peine de l’entendre exprimer enfin si clairement son mal-être, et ça me fait de la peine aussi de l’entendre l’exprimer de cette façon, parce que Charlène l’a acculé, parce qu’elle l’a obligé à le faire, alors qu’il n’a jamais voulu m’en parler. Mais l’important c’est que ça sorte enfin, d’une façon ou d’une autre.
— Si tu n’y arrives pas seul, va voir quelqu’un qui peut t’aider.
— Personne ne peut m’aider !
— Ne sois pas con, putain ! Je sais qu’au fond de toi tu as l’énergie pour rebondir, tu as juste besoin d’un petit coup de pouce.
— Non, je n’ai pas cette énergie, je ne l’ai plus !
— Il faut au moins que tu essaies, sinon tu finiras par le regretter toute ta vie. Ne te laisse pas couler, Jérém.
— J’ai l’impression de me noyer…
— Les bateaux ne coulent pas à cause de l’eau autour d’eux. Ils coulent à cause de l’eau qui rentre à l’intérieur. Ne laisse pas cette nuit pénétrer ton esprit et te faire couler.
L’année 2007.
En ce début d’année, je suis à Toulouse et Jérém à Paris. Je commence mon taf à Montaudran. Je commence par faire des photocopies et mettre à jour des listings. Pour l’instant, je suis loin de la Garonne. Il me tarde que la saison d’irrigation démarre pour pouvoir enfin être sur le terrain.
Quant à Jérém, il accepte enfin d’aller voir un psy. Les mots de Charlène ont fait leur effet. Sacrée Charlène.
Séance après séance, je sens au téléphone qu’il semble aller mieux. Ce n’est peut-être pas un hasard s’il reprend enfin les entraînements.
Je voudrais être avec lui pour l’encourager au quotidien, pour être le témoin de ses progrès. Au bout de trois longues semaines, l’occasion se présente enfin.
Samedi 27 janvier 2007.
C’est une fois de plus au Stade de France que se joue le choc des Titans, Stade Français contre Stade Toulousain. Hélas, les deux équipes sont privées de deux de leurs meilleurs joueurs. Jérém n’est toujours pas prêt pour revenir sur le terrain. Et Thibault a mis un terme à sa carrière.
Mais l’un et l’autre ne peuvent se priver de se rendre dans les tribunes pour assister au match. Et moi non plus. Je fais la route depuis Toulouse avec Thibault et Arthur. Mon impression au sujet de ce dernier se confirme pendant ce voyage de plusieurs heures. Le compagnon de Thibault est un sacré bonhomme, profondément gentil et attentionné. Et il est vraiment fou amoureux de l’ancien mécano. C’est tellement beau à voir ! Ils sont tellement beaux à voir !
Dans les tribunes, nous assistons à un match intense. Jérém et Thibault sont assis côte à côte et vivent le jeu à fond. C’est la première fois depuis l’agression que je vois Jérém aussi intéressé par quelque chose, aussi passionné. Et ça me fait tellement plaisir !
Le match se termine sur un score de 22 à 20 en faveur des Parisiens qui tiennent enfin une « revanche » face aux Toulousains après les déconvenues à répétition des derniers mois.
— Il a suffi que je me tire, et c’est la débâcle ! se marre l’ancien demi de mêlée.
— Il a suffi que je ne joue pas pour qu’ils gagnent, c’est tout aussi vexant ! fait Jérém.
— Ne dis pas de bêtises, Jé !
— Ça te fait pas quelque chose de voir tes coéquipiers jouer sans toi ?
— Bien sûr que ça me fait quelque chose. Mais je ne regrette rien. Je suis vraiment bien dans ma nouvelle vie, comme un poisson dans l’eau.
— Je suis heureux pour toi.
— Merci, Jé. Continue de te battre, et tu vas vite retrouver tes potes sur le terrain.
— J’espère…
Entendre Jérém « envisager » enfin un retour sur le terrain emplit mon cœur de joie.
Après le match, nous allons tous les quatre dîner en ville. Un peu plus tard dans la soirée, nous nous retrouvons tous à l’appart. Il est prévu que les deux beaux pompiers dorment dans la chambre d’amis cette nuit, avant de repartir demain pour la ville Rose. Je vais devoir repartir avec eux. Si j’étais encore étudiant, je pourrais sécher quelques cours et rester quelques jours. Mais désormais j’ai un travail, et mes obligations m’appellent. Que c’était beau d’être étudiant !
Je n’ai que cette nuit pour profiter de mon Jérém. Alors, je n’ai même pas envie de dormir. J’ai envie de profiter de sa présence, chaque instant.
La soirée s’étire tard dans la nuit, les discussions ponctuées de bières sont agréables. Les souvenirs communs des deux anciens coéquipiers font peu à peu surface dans la conversation. Le degré d’alcoolémie général augmente doucement.
A un moment, je vois le Lieutenant chercher les lèvres de l’ancien demi de mêlée et se lancer dans un baiser aussi doux que passionné. Un baiser qui dure, qui s’étire, et qui ne semble jamais devoir s’arrêter. Les bras enlacent, les mains caressent, cherchent le contact physique, insatiables.
Mais qu’est-ce qu’ils sont beaux ! Et comment je les envie ! J’aimerais tellement retrouver cette fougue avec Jérém. Je l’ai eue, et je l’ai perdue. Est-ce que je vais la retrouver, un jour ?
Lorsque ce long baiser prend fin, les deux pompiers ont l’air dans tous leurs états. Un instant plus tard, ils s’embrassent à nouveau. Lorsque les lèvres se séparent, les regards ne le peuvent toujours pas. Et le petit sourire qui illumine leurs visages donne la mesure du désir réciproque qui les consume. C’est beau, le désir, quand il est aussi brûlant, aussi manifeste.
Tous leurs mouvements sont harmonieux, fluides, animés par une complicité et une fébrilité qui crèvent les yeux. Ils ont envie l’un de l’autre, c’est flagrant.
— Si vous avez envie, ne vous gênez pas, j’entends Jérém lancer.
— On n’est pas des bêtes, on peut attendre, plaisante Arthur.
— Vous ne devriez pas… insiste Jérém.
Arthur sourit, un peu décontenancé par la proposition de Jérém. Mais Thibault saisit son bel Arthur par l’avant-bras, l’attire contre lui et l’embrasse à son tour. Un baiser fougueux, très sensuel.
Un instant plus tard, les deux beaux pompiers disparaissent dans la chambre. Ils vont faire l’amour.
J’ai envie d’en faire de même avec mon Jérém. Moi aussi j’ai envie de faire l’amour avec le gars que j’aime. Je l’embrasse, doucement. Longuement. Mais ses lèvres ne répondent que faiblement à mes sollicitations.
Je tente alors le tout pour tout, je l’embrasse avec plus de fougue. Mais il n’est pas d’humeur non plus.
C’est dur de réaliser à quel point, entre la parfaite fusion des corps et des esprits que partagent nos invités et ce qui est en train de se passer entre Jérém et moi, il y a un monde.
— Je ne sais même plus si j’ai envie de continuer, ou si seulement ça servirait à quelque chose de continuer. Suce-moi ! je l’entends me commander, alors que je suis sur le point de tout arrêter, et de pleurer.
Un instant plus tard, je me glisse entre ses cuisses, et je commence à le pomper. J’aimerais sentir son excitation monter, la vibration du plaisir traverser son corps et le faire exulter. J’ai tellement envie de lui faire plaisir !
Mais rien de tel ne se produit. J’ai l’impression que Jérém ne prend même pas vraiment son pied. Pas de soupirs, pas de ahanements, pas de frémissements de son corps qui traduiraient son excitation. Non, rien de tout ça.
Je l’ai senti lors des quelques pipes que j’ai pu lui faire depuis Noël. Si Jérém me laisse parfois lui offrir du plaisir, notre complicité n’est pas revenue pour autant. Et j’ai l’impression que là aussi quelque chose a cassé pour de bon.
J’essaie de faire bonne figure, mais mon esprit pleure à chaudes larmes.
— Ah, les deux pompiers sont en train de baiser ! je l’entends constater, alors que la cloison laisse passer et venir jusqu’à nous des petits bruits de l’amour.
— J’ai envie de toi, je lui glisse alors.
Une fois encore, je tente le tout pour tout. C’est quitte ou double. Je prends tous les risques. A ma grande surprise, Jérém est partant.
Un instant plus tard, après avoir craché dans sa main et sur ma rondelle, il se laisse glisser entre mes fesses. C’est la première fois que Jérém vient en moi depuis cette baise fougueuse dans le sous-sol de l’immeuble où habite Ulysse. Ça devrait être un moment magique.
Mais ça ne l’est pas. Ce n’est qu’une déception de plus dans une soirée où, décidemment, rien ne va plus.
Jérém me fait l’amour, mais son regard semble perdu dans le vide. Il semble ailleurs, il n’a pas l’air dans son assiette. Ses gestes sont brusques, précipités, presque maladroits. Tout semble forcé, dissonant. Comme si Jérém n’avait pas vraiment envie de me faire l’amour, et qu’il s’était juste laissé entraîner par l’envie de me faire plaisir. Pour faire semblant qu’il y a encore une complicité entre nous. Alors que ce n’est plus le cas. Peut-être qu’en acceptant ma proposition, il a voulu tenter de faire bonne figure, de s’éviter une longue discussion. Peut-être qu’il s’est laissé entraîner par la passion de nos invités. Comme s’il voulait les imiter. Comme s’il voulait se montrer, nous montrer, que c’était encore possible entre nous. Mais visiblement, ça ne l’est pas, ça ne l’est plus.
Car il y a un monde entre la fougue et la tendresse de toutes les fois où nous avons fait l’amour du temps où nous étions Ourson et P’tit Loup, ou même entre la bonne baise le soir de son anniversaire, et cet accouplement où tout paraît mécanique.
Nos corps sont emboîtés, mais nos esprits sont complètement déconnectés. Le plaisir que j’ai retiré de ses premiers coups de reins s’estompe peu à peu, laissant la place à une douleur grandissante. Je ne veux surtout pas priver Jérém de son orgasme, mais je me surprends à souhaiter qu’il ne tarde pas trop à venir. C’est triste.
Je repense à Thibault et Arthur, en train de faire l’amour dans la pièce d’à côté. Certainement en train de prendre leur pied comme des fous. Il n’y a rien de plus beau que deux êtres qui vibrent à l’unisson pour rendre l’autre heureux.
Leur bonheur me rend heureux. Thibault le mérite mille fois, et Arthur m’a l’air de le mériter tout autant.
Mais leur bonheur met aussi en évidence, par contraste, celui que Jérém et moi avons perdu.
Jérém continue de me pilonner, de plus en plus fort, en transpirant à grosses gouttes, comme si son orgasme lui échappait. Quand il arrive enfin à le rattraper, il jouit vite, il jouit seul.
Un instant plus tard, il se déboîte de moi, il repasse son boxer et file à la fenêtre s’allumer une clope, sans rien tenter pour me faire jouir à mon tour. De toute façon, je n’y suis plus, mon plaisir s’est évaporé, mon excitation aussi, et j’ai débandé.
Je repense aux fois où l’amour entre Jérém et moi était un pur feu d’artifice. Je me souviens de son regard excité et amoureux. Je me souviens de ses gestes, de son attitude, de cette envie, de ce besoin viscéral que nous partagions, ceux de s’offrir à l’autre, de nous affairer pour le plaisir de l’autre. Je me souviens de la dernière fois où nous avons fait l’amour, l’après-midi avant de fêter son anniversaire chez Ulysse.
Je me souviens qu’après l’amour, nous étions défaits, épuisés, et heureux. Si heureux.
A cet instant précis, après avoir joui, Jérém a l’air davantage perdu qu’heureux.
Quant à moi, je me sens envahi par une solitude immense, par une tristesse infinie. J’ai l’impression que mon cœur est un trou béant que rien ni personne ne saura plus jamais combler.
Cher lecteur, ton avis sur cet épisode sera le bienvenu.
Merci d'avanceFabien
 6 commentaires
6 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Jérém&Nico - Saison 1