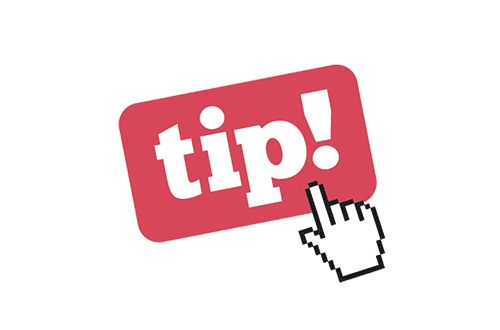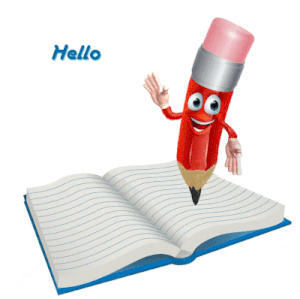-
Par fab75du31 le 22 Novembre 2022 à 21:04
Dimanche 17 août 2003.
Le lendemain de la nuit passée en compagnie de Giovanni, le beau spécimen florentin, nous prenons la direction de Siena. La radio Lattemiele nous fait découvrir « Maledetta primavera » de Lorella Goggi.
Siena.A l’instar de Firenze, Siena est un bijou d’architecture d’une rare beauté. Une autre ville chargée d’une histoire riche et flamboyante dont chaque pierre, chaque brique, chaque pavé, chaque tuile semble se souvenir. En écoutant bien, il semblerait qu’ils se souviennent aussi des ouvriers et artisans qui ont laissé la santé ou même la vie dans ces chantiers pharaoniques à la gloire des puissants et de leurs folies de grandeurs. Oui, la beauté traîne des casseroles elle aussi.
Entre la Toscane et le Latium, Lattemiele nous apporte le son de l’Italie avec :
Nessuno de « Mina ».
Et :
Sarà perché ti amo, des « Ricchi e Poveri ».
Roma.
Nous arrivons dans la capitale del Bel Paese en fin d’après-midi. Et pour la première fois depuis le début de notre périple transalpin, nous avons un peu de mal à trouver une chambre pour la nuit. Le temps de nous loger, il est l’heure du dîner, sans que nous n’ayons eu le temps de visiter quoi que ce soit.
Ce soir, c’est salade avec mozzarella di bufala. C’est la vraie, celle préparée à base de lait de bufflonne, celle qui a du goût, et qui nous régale ce soir.
Pour la suite, ce sera bucatini (des gros spaghettis creux à l’intérieur) all’amatriciana, une sauce tomate légèrement pimentée (au peperoncino) et garnie de lardons.
Ainsi, lorsque nous sortons du restaurant nous n’avons encore rien visité des beautés de Rome. Mais nous n’allons pas tarder à en visiter une, faite non pas de pierre et de bois, mais de chair et de charme. Sur Internet, j’ai cherché les établissement gay friendly de la ville. Nous nous rendons dans l’un d’entre eux, situé dans le quartier de Transtevere.
C’est là que le regard d’un jeune Romain, la vingtaine tout juste, accroche les nôtres. Il est assis seul au comptoir, non loin de nous. Et il a l’air de s’ennuyer ferme. Notre arrivée semble constituer pour lui une diversion intrigante.
Ses regards sont timides. Et néanmoins insistants. J’ai l’impression qu’il se doute que Jérém et moi avons flashé sur lui, sans pour autant arriver à faire confiance à son intuition. Sans trouver le courage de franchir le pas. Es-tu novice de ce genre d’endroit, de ce genre de rencontres ?
Dans son regard, il me semble retrouver la question que je me posais plus jeune lorsque je croisais le regard d’un garçon qui semblait s’attarder sur moi : Voudrais-tu m’amener loin d’ici, et m’offrir le bonheur d’un instant, d’une heure, d’une vie ?
— Il est mignon, me glisse Jérém.
J’adore notre complicité, celle de nos regards, de nos ressentis, cette façon de nous comprendre au quart de tour.
— C’est clair !
— Il me fait penser à toi, il ajoute.
— A moi ?
— Oui, à toi avant nos « révisions ». Il a l’air si timide et si mal dans sa peau…
— Autrement dit, tu penses qu’il est puceau ? je m’avance.
— Je ne sais pas, mais il n’a pas dû en voir beaucoup ! Blagues à part, il a l’air tout timide et hésitant. Il est craquant ! Comme toi !
Moi qui pensais qu’en dehors de moi Jérém n’était attiré que par des gars plutôt virils, je découvre qu’il est aussi, tout comme moi, sensible à la douceur de ce genre de « ragazzo ». Et je comprends par la même occasion ce qui l’a touché en moi, au-delà de l’occasion facile de baiser comme il en avait envie.
Quelques minutes plus tard, nous nous levons de notre table et nous nous apprêtons à quitter l’établissement. Jérém cherche le regard du type, le trouve, le ferre. Il lui sourit et lui balance un signe de la tête pour lui montrer la direction que nous allons emprunter.
— Et maintenant, il ne reste qu’à attendre, fait Jérém, en s’asseyant sur le capot d’une voiture à quelques dizaines de mètres du bar, tout en s’allumant une clope.
— Tu crois qu’il va venir ?
— Il crève d’envie de coucher avec nous.
Jérém ne s’y trompe pas. Quelques minutes plus tard, le petit mec sort à son tour du bar et nous cherche du regard. Il vient vers nous, il nous sourit. Il n’a pas vraiment l’air à l’aise.
— Ciao… il nous glisse, l’air gêné.
— Ciao, nous lui répondons en cœur.
— Scusa, hai una sigaretta ? demande le petit mec.
— Certo ! fait Jérém en lui tendant son paquet de clopes et son briquet.
— Mi chiamo Gianluca.
— Io siamo Jérémie, et lui Nicolas…
— Francesi ?
— Si…
Avec l’adorable Gianluca, c’est un tout autre plan qu’avec le Giovanni de Firenze qui s’engage. Le mec n’est pas contre un peu de tendresse, et il semble particulièrement affectionner les câlins.
Le petit gabarit se laisse volontiers enfiler par Jérém, qui se montre beaucoup plus doux et attentionné qu’avec Giovanni. Le jeune Romain me suce longuement, et me fait gicler en me branlant.
Gianluca n’est pas contre le fait de passer la nuit avec nous, et d’engager la conversation au sujet de la situation des gays en Italie. Il nous explique que dans son pays, encore trop imprégné de préjugés, de machisme et d’influence religieuse, ce n’est pas tous les jours facile d’être différent. Le poids du regard des autres, famille, amis, collègues est encore très important. Et la stigmatisation des minorités sexuelles très ancrée dans les mentalités.
Gianluca n’est pas contre non plus le fait de recommencer à sucer Jérém dans la nuit. Et Jérém n’est absolument pas contre le fait de se laisser sucer. Et après s’être bien fait chauffer la queue par notre amant d’un soir, c’est entre mes fesses que le bobrun vient jouir.
Lundi 18 août 2003.
Après avoir dit au revoir à l’adorable Gianluca, nous rentrons dans le vif de la découverte de la Ville Eternelle. Nous nous dirigeons en priorité vers les grands sites, les Fori Imperiali, le Colosseo, les Terme di Caracalla, le Panthéon.
Au fil des visites, je repense à Ruben et à son récit de son voyage ici-même, en compagnie d’Andréas, le frère de sa copine, dont il était secrètement amoureux. J’essaie d’imaginer comment ça a dû être dur pour lui de partager les chambres avec Andréas, dont il était amoureux, et de se contenter des bribes de sensualité dont ce dernier avait bien voulu lui laisser profiter.
Je ne regrette pas d’avoir quitté Ruben pour m’occuper de Jérém. Je regrette le mal que je lui ai fait, en le laissant espérer en quelque chose que je ne saurais lui donner. J’espère qu’il a trouvé, ou qu’il va bientôt trouver, quelqu’un qui le rendra heureux. Je devrais prendre de ses nouvelles. Ou pas. Peut-être que le mieux, c’est de le laisser tranquille.
Mardi 19 août 2003.
Après avoir visité la Rome des touristes pendant un jour et demi, cet après-midi nous suivons le conseil que nous a donné Gianluca. Celui de mettre de côté nos plans et nos guides et de nous laisser flâner dans la ville sans but précis. De nous surprendre par les découvertes surgissant au gré du hasard.
Nous nous laissons happer par les petits quartiers de Transtevere où la « dolce vita » prend le visage bienveillant de petites places bordées de restaurants et de bars familiaux. Des petits coins sympas en pleine ville mais bien à l’écart de la circulation chaotique et du bruit des grands axes. Des quartiers extrêmement vivants, à l’allure de petits villages en fête, fréquentés par une foule de personnages bruyants mais foncièrement avenants. Ici les Romains se retrouvent pour bavarder, prendre un verre, rigoler, manger un bout, danser, flirter.
Ce soir, le menu au restaurant est constitué par d’autres spécialités de la ville, les calamars frits et les saltimbocca.
Ce soir encore, en rentrant à l’hôtel avec Jérém, je suis comme enivré par le bonheur de la journée passée en sa compagnie. Fatigué, mais tellement heureux ! Notre sérénité, notre bien-être, notre insouciance n’ont jamais été si grands. Ils l’ont été peut-être à Campan, entourés de gens bienveillants et ouverts d’esprit. Mais jamais lorsque nous n’étions que tous les deux entourés d’inconnus, jamais comme pendant ces jours magiques.
Il me semble que le fait de nous autoriser à voyager ensemble, comme un petit couple, même si incognito, nous procure une sensation de liberté un brin sulfureuse qui est tout bonnement grisante.
Malgré la fatigue, nous faisons l’amour. Jérém a retrouvé sa fougue de jeune mâle, et il semble bien parti pour rattraper les longs mois d’hibernation de sa sexualité.
Mercredi 20 août 2003.
Aujourd’hui, avant de reprendre la route vers le sud, nous sortons de Rome pour aller découvrir un endroit qui plonge le visiteur deux mille ans en arrière. C’est un endroit où le temps semble s’être figé à tout jamais. En marchant à pied le long de l’ancienne voie romaine qui conduisait vers Naples, Pompei, et jusqu’aux Pouilles, je repense aux mots de Ruben.
Comme cela a été le cas pour lui, la via Appia est l’un des sites de la Rome Ancienne qui m’a le plus bouleversé. Moi aussi, dans ce décor silencieux et plongé dans la nature, j’ai l’impression de ressentir l’écho des siècles qui se sont écoulés depuis l’Empire Romain. En foulant les grands pavés de cette ancienne voie bordée de pins, de cyprès et de tombes anciennes, j’ai l’impression de marcher dans les pas de cent générations d’hommes et de femmes. Quand on y pense, ça file un sacré vertige.
Le temps d’avaler un plat de gnocchi alla Romana et de poster quelques cartes postales (à cette époque on envoyait des souvenirs de vacances qui survivaient à un changement de téléphone), nous prenons la route vers Napoli.
Au détour d’une conversation, Jérém revient sur ses inquiétudes au sujet du renouvellement de son contrat au Stade Français.
— Je ne sais pas ce que je vais faire s’ils me laissent à la rue.
— Tu vas postuler dans une autre équipe !
— Avec mon dossier médical, ils vont me rire au nez ! Autant que je j’aille directement distribuer des CV dans les restos et brasseries !
— Tu l’auras ton contrat, sois patient.
Entre le Latium et la Campanie, Lattemiele délecte nos oreilles avec « Pensiero Stupendo » de Patty Pravo.
Et avec « Riderà » de Little Tony.
Napoli.
Nous arrivons dans la ville aux 500 églises en fin de journée. Et pour la première fois depuis notre voyage, nous n’avons pas à nous occuper de trouver une piaule pour la nuit. En effet, c’est dans la famille de Jérém que nous sommes hébergés. Si j’avais cru que cela arriverait un jour !
Carmelo, le cousin de Jérém, nous accueille en bas de l’immeuble du quartier de Poggioreale. Carmelo est un garçon à peine plus âgé que Jérém et moi. A l’instar de son cousin toulousain, il est très brun, il a la peau très mate, et il a un putain de sourire à te faire tomber raide dingue. Les gènes ne mentent pas. L’air de famille avec Jérém est flagrant.
Deux choses le différencient cependant de mon bobrun. Un physique un brin enrobé, qu’il semble d’ailleurs assumer parfaitement, et qui n’a rien de rédhibitoire dans le charme de sa personne. Mais aussi un caractère plutôt extraverti. Le jeune Napolitain parle fort, et gesticule beaucoup. Il est d’un naturel drôle, bon vivant, il est plein de joie de vivre. Il appelle Jérém « campione di rugby ». Carmelo nous témoigne son plaisir de nous accueillir avec un enthousiasme qui met de suite à l’aise.
Les parents de Carmelo, dont le père n’est autre que le cousin germain de Mr Tommasi, le papa de Jérém, nous accueillent comme des rois. Jérém me présente comme un « compagno di scuola » (camarade d’école), et ça passe comme une lettre à la poste. Je n’arrive pas encore à croire que Jérém m’amène dans sa famille, même s’il s’agit d’une branche éloignée. Si on m’avait dit ça, à l’époque des « révisions » dans l’appart de la rue de la Colombette, j’aurais cru à une blague cruelle. Et pourtant, c’est devenu une magnifique réalité. Putain, Jérém, tu es vraiment incroyable !
En tant que camarade d’école, j’ai le droit de partager le lit avec mon amoureux. Je doute fort que ce serait le cas en tant que petit-ami. Définitivement, la vie est truffée de paradoxes, de contre-sens et d’injustices.
Au menu du repas du soir, des spaghetti « salsa puttanesca », littéralement « une sauce de fille aux mœurs légères ». Cette sauce, qui est une saveur typique de Napoli, est relevée par l’ajout d’un piment genre Espelette.
Cœurs sensibles (et surtout papilles sensibles), s’abstenir. La première bouchée semble inoffensive. Ça met en confiance. Mais ce n’est que du bluff ! C’est à partir de la deuxième que l’incendie se déclenche en arc dans le palais. Et pour l’éteindre, je vous souhaite bonne chance !
Pendant le repas, il est longuement question de souvenirs liés à l’enfance de Jérém et de Carmelo, et des bêtises qu’ils pouvaient accomplir lorsqu’il se retrouvaient pendant l’été. En connaître davantage sur les origines et l’histoire du garçon que j’aime, c’est fascinant. Mais la barrière de la langue est pour moi insurmontable.
J’ai vraiment du mal à suivre les conversations, et ça me frustre terriblement. Jérém s’efforce de traduire dans les deux sens, mais il fatigue vite, d’autant plus qu’il cherche souvent les mots en italien. Aussi, les parents de Carmelo parlent un dialecte, le napolitain, qui n’a pas grand-chose à voir avec l’italien.
Lorsque les parents parlent, Carmelo traduit à Jérém, en italien, mais avec un bon accent du sud. Jérém essaie de comprendre ce que lui raconte son cousin et tente de me le traduire en français. C’est un joyeux téléphone arabe qui amène toute sorte de quiproquos bien marrants.
Jeudi 21 août 2003.
Cernée par la silhouette imposante du Vésuve, tel un fauve prêt à bondir sur sa proie à chaque instant, Naples a des allures de ville sous menace perpétuelle.
Malgré quelques désagréments – la circulation chaotique, le bruit, la pollution, beaucoup de déchets qui traînent, des tags partout, et pas tous d’un très bon goût – Napoli a énormément de beauté à offrir. L’ordure y côtoie le sublime, la pauvreté l’ostentation de richesse, le faste des édifices anciens, bien que parfois très dégradés, la misère des quartiers pauvres. Si Napoli est si particulière, c’est parce qu’elle a connu plus d’une domination étrangère, et en a retiré une pluralité de visages.
Les habitants sont tout aussi hauts en couleur que leur ville. Bruyants et charmants, avec le sang chaud. Ça parle fort, ça parle avec les mains, ça siffle et ça chante parfois, y compris dans la rue.
Côté sécurité, ce n’est pas non plus la ville la plus tranquille du monde. Il arrive que les balles fusent. Ce sont des règlements de comptes entre clans.
— Mais si tu ne fourres pas le nez là où il ne faut pas, tu ne risques rien, résume Carmelo.
Le marché de quartier où nous amène le cousin de Jérém ressemble au chaînon manquant entre une braderie et un souk arabe. Les contrefaçons de grandes marques, vêtements, montres, chaussures, sac à main s’exposent sans vergogne sur les étals plantés en pleine rue, au su et au vu de tout le monde, y compris les « Guardie Municipali » qui patrouillent avec une allure flemmarde sans inquiéter personne.
Naples est une ville impressionnante. Les rues bouillonnent d’une activité intense, et on peut se sentir mal à l’aise dans cette effervescence.
Oui, ici les habitants sont hauts en couleur. Mais aussi hauts en bogossitude. Jamais de ma vie je n’ai vu autant de mâles typés, bien bruns et à la peau mate, allant du petit con de 17 ans qui se prend pour un caïd, jusqu’au trentenaire bien macho, bien sexy, en passant par le kéké un tantinet bourrin.
Vendredi 22 août 2003.
Cet après-midi, Carmelo nous conduit à Pompéi. La visite de ce lieu si particulier est tout aussi saisissante, si ce n’est plus encore, que celle de la via Appia. Là aussi, le temps semble s’être figé. Avec la différence que là, c’est au sens propre.
Car c’est exactement ce qui s’est produit en cette nuit de l’an 79 de notre ère. L’éruption du Vésuve a été très soudaine. Elle a laissé derrière elle une impressionnante tranche de vie stoppée nette par la fureur de la nature.
Marrante cette plaque avec une bite sculptée en relief qui signalait a priori l’entrée d’une maison close.
Le soir même, le cousin de Jérém nous amène à une fête dans un village de l’arrière-pays. La soirée est très animée et les potes de Carmelo sont avenants avec nous, « i francesi ». Le cousin semble connaître un paquet de monde et nous finissons par le perdre de vue, comme s’il avait été aspiré par la foule.
Il est presqu’une heure du matin lorsque Jérém et moi nous laissons attirer par l’une de ces machines débiles où il faut ajouter des jetons pour faire tomber d’autres jetons, sur lesquels sont posés des bons cadeaux en plastique qui ne tombent jamais. Le genre de machine qui finit par te faire dépenser une fortune pour gagner une babiole que tu aurais payée dix fois moins cher dans le commerce. Mais il faut admettre que ce petit jeu peut être bien marrant à faire à deux.
Nous nous y amusons depuis un petit moment déjà, lorsque je remarque le mec. Il est en train de jouer seul à une machine un peu plus loin. Il doit bien avoir une trentaine d’années, il est brun, poilu, la peau mate, des gros biceps et un regard de braise.
Il est très viril et vraiment typé. Il n’y a pas de doute, c’est un mâle napolitain dans toute sa splendeur. Il l’est dans ses gênes, mais aussi dans son look. Ses cheveux sont fixés au gel, sa chemise blanche est à moitié ouverte, et une chaînette dorée à grandes mailles se balade entre ses pecs bien saillants et bien montrés. Tout est ostentation désinvolte et insolente d’une mâlitude conquérante. C’est plutôt renversant.
Le mec ne tarde pas à me griller. Son regard est très brun, terriblement charmant, pénétrant. Il est empli d’une sensualité animale. T’as l’impression que le mec te baise rien qu’en enfonçant ses yeux dans les tiens. Il a aussi l’air un tantinet macho, un peu bourrin sur les bords. Le gars qui pourrait ne pas être commode, et dangereux, si on le cherche. Et ça le rend sexy à mort.
Même si je pressens que je prends à chaque regard le risque de l’importuner un peu plus, et de le pousser à venir m’alpaguer violemment (le Napolitain a le sang chaud), sa présence est tellement magnétique que je n’arrive pas à arrêter de le mater.
— Ça va, tu mates bien ? j’entends Jérém me lancer.
— Tu l’as vu aussi ?
— Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Il est canon !
— C’est clair ! j’admets.
— Tu veux qu’on se fasse un plan avec ?
— Je ne sais pas trop…
— Il te fait bander, non ?
— Oh oui !
— Moi aussi !
— Mais tu crois qu’il serait partant ?
— Pour le savoir, il faut aller lui demander.
— Moi je ne m’en sens pas le courage. Je trouve qu’il fait très hétéro, et un tantinet macho. Il n’a pas l’air commode. Il me semble qu’il pourrait être très chatouilleux sur le sujet. J’ai peur que s’il n’aime pas ce qu’on lui propose, il pourrait devenir violent.
— Il faut y aller avec assurance.
— Admettons, et on fait quoi de ton cousin ?
— Je ne sais pas où il est. Avec l’une de ses copines sans doute. Il m’a laissé un double des clefs de l’appart, au cas où nous ne rentrerions pas au même moment.
— Et tu veux faire ça où ?
— Peut-être que le type peut nous recevoir…
Autant avec Giovanni et Gianluca, je sentais bien le plan. Autant ce soir, ce gars me fait un peu peur. Jérém doit remarquer mon hésitation car il me questionne :
— T’as peur de quoi ?
— Qu’il nous casse la gueule ! Qu’il pète un scandale qui remonte jusqu’aux oreilles de ton cousin !
— Il ne se passera rien de tel, fait Jérém avec un aplomb impressionnant.
Sur ce, il pousse son dernier jeton dans la fente. Puis, il sort son paquet de cigarettes de la poche de son short, il en allume une, et pose son regard sur le mâle napolitain. Ce dernier le capte aussitôt. Jérém s’avance dans sa direction et lui tend le paquet de cigarettes. Le type allonge le bras et en saisit une. Jérém allume son briquet, l’approche pour que le mec puisse allumer sa clope. L’assurance de mon beau brun m’impressionne.
Un instant plus tard, les deux mâles bruns sont en train de discuter. Le regard intimidant du mec disparaît lorsque son sourire ravageur fait son apparition fracassante.
— Viens, Nico, m’appelle Jérém.
— Voilà Salvatore.
— Ciao, me glisse le mec.
— Io sono Nicolas.
Jérém avait raison, le mec peut nous accueillir chez lui. Nous le suivons dans un dédale de rues étroites et sommairement illuminées. De temps en temps nous croisons des mecs, à l’allure peu recommandable. Certains nous proposent de nous vendre de la drogue. Le quartier ne m’a pas l’air bien sûr. Pendant un instant, je me surprends à craindre que le sexy Salvatore soit en train de nous attirer dans un guet-apens.
Mais ce n’est pas le cas. Quelques minutes plus tard nous sommes dans son appart. Et nous y sommes pour un bon match de jambes en l’air.
Au début de la première mi-temps, les deux mâles bruns se tiennent debout devant moi, les queues bien tendues pointant le zénith. Je les suce et je les branle à tour de rôle.
Dans une autre action de jeu, Jérém est à genoux devant le dieu mâle Salvatore et le pompe avec vigueur.
Dans la suivante, nous sommes tous les trois sur le lit, je suce Jérém qui est toujours en train de sucer Salvatore.
Dans la suivante encore, je suce le mâle napolitain, alors que Jérém est en train de me tringler par derrière.
La pause dure le temps de fumer un bon joint.
A la reprise de jeu, Salvatore passe une capote et s’enfonce lentement mais assurément entre les fesses de mon Jérém. Il baise avec une attitude sauvage, animale. Jérém semble bien prendre son pied lui aussi. Que de chemin parcouru en deux ans !
Action suivante, Jérém vient en moi et jouit entre mes fesses.
Dans la troisième mi-temps (dans ce genre de match, il n’y a rien de réglementaire, surtout pas la durée de jeu), Salvatore passe une nouvelle capote et me baise à son tour. Et je kiffe un max. Ce n’est que de la baise, mais c’est terriblement bon.
Salvatore me rappelle un gars que Jérém et moi avions levé une nuit au On Off à Toulouse, un beau gosse brun, barbu et terriblement viril prénommé Romain. Il est tout aussi charmant et charmeur, tout aussi intimidant, et tout aussi fougueux en tant qu’amant.
Nous quittons l’appart du mâle napolitain au milieu de la nuit. Dans la cage d’escalier, Jérém me pousse contre le mur délabré et m’embrasse fougueusement.
— C’était marrant… il me glisse, alors que nous quittons l’immeuble.
— C’est clair.
— Et ce qui est encore meilleur, c’est de rentrer avec toi, il ajoute.
Ce n’est pas encore un « je t’aime », mais ça lui ressemble quand-même. Et ça me touche profondément.
Je sais que Jérém a des besoins, je sais que pour les satisfaire il aura des aventures, que son corps exultera avec d’autres garçons. Mais je sais aussi que ce qu’il y a entre nous est désormais tellement fort que personne ne pourra nous l’enlever. Je sens que ma jalousie s’évapore. En regardant Jérém baiser avec les quelques gars que nous avons levés au cours de notre voyage, je me dis qu’avec aucun d’entre-eux, même pas avec un gars comme Gianluca par qui il a été drôlement touché, il est comme il est avec moi.
Autour de ces plans « récréatifs », Jérém et moi faisons l’amour presque chaque soir. Le plaisir se mélange avec la tendresse et cela donne un feu d’artifice avec des couleurs qu’aucun plan ne sait offrir. Nous sommes Ourson et P’tit Loup, et je sens qu’il n’y en aura pas d’autres dans notre vie.
Pendant le trajet pour rentrer à l’appart des oncles de Jérém, je pense au fait que nos vacances touchent à leur fin. Dans trois jours, nous serons rentrés. Je sens que ça va être dur de redescendre du petit nuage sur lequel j’ai voyagé depuis deux semaines.
Je me projette encore plus loin, quand Jérém aura terminé sa rééducation à Capbreton, quand il recommencera à jouer à Paris. A ce moment-là, il n’aura plus besoin de moi, et je n’aurai plus qu’à rentrer à Bordeaux. Nous serons à nouveau séparés, souvent, trop souvent.
Samedi 23 août 2003.
Après un petit déjeuner et des adieux à rallonge avec Carmelo et ses parents, nous reprenons la route en direction de la dernière étape de nos vacances.
Nous arrivons à l’hôtel que Carmelo nous a réservé à Sorrento en début d’après-midi. Et la première chose que nous faisons après avoir posé nos valises, c’est l’amour. C’est un besoin soudain, violent. Et, surtout, partagé. Jérém ouvre ma braguette, me fait m’allonger sur le lit, sur le ventre. Il descend mon boxer et mon short, puis les siens. Il crache sur ma rondelle et il glisse sur moi, en moi. Il me pilonne pendant une poignée de minutes et il jouit profondément enfoncé en moi, son souffle chaud caressant mes oreilles et mon cou.
Une heure plus tard, nous embarquons sur un ferry pour Capri. Les notes festives et estivales du tube « Dolce vita » résonnent dans les enceintes du bateau.
Elles me donnent la mesure de mon bonheur présent avec ce garçon, un garçon qui vient de me faire l'amour et qui me regarde avec des yeux aimants. Quand je pense qu’il y a deux ans, jour pour jour, nous venions de nous disputer violemment chez mes parents et de nous taper dessus, je me dis qu’il ne faut vraiment jamais perdre espoir.
La promenade sur la corniche est un incontournable du tourisme de l’île. Le paysage entre terre et mer y est époustouflant.
Et c’est dans ce lieu enchanteur qu’une magie d’un tout autre genre se produit. Nous venons de prendre place à la table de notre dîner lorsque la sonnerie du téléphone de Jérém retentit.
Le bobrun regarde l’écran et soudain son visage s’illumine.
— Putain, c’est mon agent ! il me lance, l’air déboussolé.
— Réponds !
Jérém décroche. Et la bonne nouvelle tombe enfin. Le jeune ailier est reconduit au Stade Français. Et même si ce n’est que jusqu’à la fin de la saison, en attendant d’apprécier sa récupération, c’est déjà une immense victoire.
— Je suis tellement content pour toi ! Je te l’avais dit que ça arriverait !
— Je pensais que seul un miracle aurait pu me faire retrouver ma vie d’avant.
— Le miracle est accompli, tu l’as accompli !
— Non, c’est toi qui l’as accompli, Nico. Ma cheville, mon genou, mon énergie pour me battre et revenir au top, tout ça, c’est à toi que je le dois. En fait, je te dois ma vie tout entière.
— Jérém… je tente de l’arrêter, alors que je sens l’émotion monter en moi.
— Sans toi, je n’aurais pas réussi. Sans toi, j’aurais tout balancé, il continue sur sa lancée. Je n’aurais pas réussi non plus sans ce chirurgien que tu as sorti de nulle part comme un magicien. Quel exploit, putain ! Chapeau, l’artiste ! Merci, merci mille fois, merci un million de fois !
— Tu sais, j’ai été tellement heureux d’être à tes côtés…
— J’ai été horrible avec toi, et tu es resté !
— Jamais je n’aurais pu partir quand tu avais le plus besoin de moi.
— T’es un sacré bonhomme, toi !
— Merci P’tit Loup !
— Et désolé pour les horreurs que je t’ai dites à l’hôpital, il continue, tout en prenant ma main dans la sienne, je ne le pensais pas, j’étais juste en colère. Et j’avais une trouille terrible.
— Je sais, je sais. Ça fait longtemps que j’ai oublié ce que tu m’as dit quand tu étais au plus mal.
— Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée, Ourson !
— Et toi, alors, mon P’tit Loup !
Non, à Capri, rien n’est fini pour nous. Bien au contraire, je sens que je vis ici, dans ce cadre magnifique, quelque chose de fabuleux. Je crois que je n’ai jamais été aussi amoureux de mon beau brun.
En regardant en arrière, je réalise que pendant un temps j’étais amoureux non pas de Jérém, mais du plaisir sensuel qu’il m’apportait, et de la stabilité affective que j’espérais il pourrait m’apporter.
Je crois que je l’aime désormais pour ce qu’il est, avec ses qualités et ses défauts, ses craintes, ses angoisses, ses hauts, ses bas. Certes, ce garçon sait m’apporter un immense bonheur. Et ce bonheur, je le prends tout entier. Mais ce dont je suis certain désormais, c’est que la chose au monde qui me rend le plus heureux c’est de le savoir heureux, lui. Et quand je vois dans son regard et ses attitudes qu’il en est de même pour lui, je me considère comme un garçon chanceux, très chanceux.
Je n’ai jamais été aussi heureux que de pouvoir être à ses côtés pour l’aider à remonter la pente, pour l’encourager, le soutenir, même si ça n’a pas été évident tous les jours. Je suis content de l’entendre dire à quel point ça l’a touché.
Dimanche 24 août 2003.
Aujourd’hui, nous remontons la Botte en direction de la France. Et voilà, nous sommes déjà sur le retour. Ces deux semaines ont filé si vite ! Heureusement, je vais passer encore quelques jours à Capbreton avant de rentrer à Bordeaux pour la reprise des cours.
Ça, c’est ce que je pensais jusqu’à midi, en gros jusqu’à hauteur de Rome. Car le téléphone de Jérém sonne à nouveau à ce moment-là. A l’autre bout des ondes, un dirigeant de son club. Il appelle pour lui annoncer qu’il a été décidé qu’il terminerait sa rééducation dans un centre spécialisé à Paris. Le type lui rappelle que son contrat n’est renouvelé pour l’instant que jusqu’à la fin de la saison, dans l’attente de voir comment les choses évoluent. En gros, il faut que sa rééducation soit terminée mi-novembre, date à laquelle il devra avoir retrouvé le chemin du terrain de jeu. En clair, il est en sursis. Soit, ça passe, soit, ça casse. Et si ça casse, c’est le rebut. Une belle pression sur ses épaules, l’ambiance idéale pour terminer la rééducation dans de bonnes conditions.
— Tu crois que ça va aller ? je le questionne. C’est pas un peu court comme délai ?
— Je vais y arriver, t’inquiète ! Je suis motivé à bloc !
— Ne fais pas de bêtises, Jérém, ne te mets pas en danger pour vouloir aller trop vite !
— Je ferai attention.
— De toute façon, je vais être là pour te surveiller.
Et là, après quelques instants de silence, j’entends Jérém émettre une hypothèse inattendue qui me déstabilise comme un coup de massue sur la tête.
— Pourquoi tu ne rentrerais pas à Bordeaux pour te consacrer au rattrapage des examens que tu as ratés en juin ?
— Tu en as déjà assez de moi ? je m’entends lui répondre, sonné par ses mots.
— Non, pas du tout, au contraire. Mais ça fait près de six mois que tu t’occupes de moi. Je crois qu’il est temps que tu t’occupes un peu de toi. Tu n’as pas passé d’exams en juin, tu peux les rattraper en septembre. Rattrape ton semestre, Nico.
— Mais c’est trop court !
— Si moi je peux arriver à rejouer, toi tu peux arriver à rattraper ton année. Nous pouvons y arriver tous les deux !
Je sais qu’il a raison, mais l’idée de me séparer de lui dans quelques heures à peine me rend infiniment triste.
A l’instant où nous avons quitté l’hôtel ce matin pour prendre la route du retour, j’ai ressenti au fond de moi un immense coup de blues. Mais j’avais trouvé de quoi m’apaiser avec la perspective de passer encore quelques jours à ses côtés. Désormais, cette perspective s’est évaporée. Laissant à sa place une immense désolation.
Borne après borne, ma tristesse ne fait que grandir. Je sais que je devrais être heureux pour ce qui arrive à Jérém, enfin sur la bonne voie pour renouer avec son rêve. Je le suis, vraiment. Mais l'idée d'être séparé de lui si brusquement après ces jours magiques me semble excessivement cruelle.
Désormais, tout ce qui me reste pour prolonger le bonheur de ce voyage est cette radio qui amène à moi le son de l’Italie. Comme avec la chanson, Zingara d’Iva Zanicchi.
Nous décidons de ne pas passer la frontière ce soir. L’un comme l’autre, consciemment ou inconsciemment, avons besoin de rester encore quelques heures en Italie pour nous préparer à lui dire au revoir. A nous dire au revoir.
Nous trouvons notre salut dans une petite pension à une demi-heure de Vintimille, sur les hauteurs. Le logement est situé dans un corps de ferme rustique entouré d'oliviers. Depuis la cour, nous apercevons, entre deux pentes contraires, un petit triangle d’eau bleue. Nous sommes accueillis par un couple de trentenaires d’une gentillesse exquise. Le repas méditerranéen concocté par nos hôtes est un régal.
Ce soir, nous sommes les seuls clients de cette petite pension qui ne compte que deux chambres à louer au total. Nos hôtes sont également producteurs d’huile d’olive, qu’ils vendent aux clients, entre autres. A table, malgré leur connaissance sommaire de la langue française, ils essaient de nous faire la conversation. Jérém se prête au jeu, il est avenant et drôle, et nous finissons par sympathiser avec ce couple charmant. Nous passons une très agréable soirée.
Pourtant, au fond de moi, j’ai l’impression que Jérém est tout aussi triste que moi, et qu’il surjoue sa bonne humeur pour essayer de me remonter le moral. Pendant quelques instants, l’illusion fait effet, et j’en arrive presque à oublier que dans quelques heures nous serons séparés.
Mais ma tristesse revient dès que nous quittons nos hôtes, lorsque je me retrouve seul avec Jérém, et que le silence s’installe à nouveau entre nous. Au lit, ce sont les baisers et les caresses qui prennent la place des mots qui ne sauraient certainement rien ajouter de plus. Nous faisons l'amour dans cette petite chambre de cette petite masure au milieu des oliviers. C'est un petit adieu, du moins c'est ainsi que je le ressens.
Lundi 25 août 2003.
Malgré le petit déjeuner copieux et varié préparé par nos hôtes, malgré leur bonne humeur matinale, je quitte ce petit coin du Paradis au milieu des oliviers avec le cœur bien lourd.
C’est toujours un petit déchirement que de quitter un endroit si beau. De plus, c’est notre dernière étape avant Capbreton. C'est la dernière scène avant le générique de fin. Ou peut-être que c’est déjà le générique de fin. Quoi qu’il en soit, c’est la dernière journée en compagnie de Jérémie. C’est surtout ça qui rend mon cœur lourd.
Nous approchons de Vintimille lorsque Lattemiele nous apporte la douce mélancolie de « Una lacrima sur viso » de Bobby Solo.
Nous passons la frontière, nous changeons de pays, et j’ai envie de pleurer à l’idée de quitter cette terre qui m’a offert tous ces moments inoubliables avec le garçon que j’aime. Au revoir, Italie, terre de mon bonheur avec Jérém. Il n’y a qu’à Campan où j’ai été si heureux.
Nous changeons de pays, mais je ne change pas de radio. Je reste sur Lattemiele jusqu’à ce que son signal se dissolve en un bruit de fréquence perdue. Lorsque la radio recommence à parler et à chanter en français, je sais que ces vacances sont terminées pour de bon.
Une partie de moi est toujours sur un petit nuage, et refuse catégoriquement d’en redescendre. Et pourtant, c’est bien ce qui est en train de se produire, borne après borne. Le nuage se dissipe, je tombe. C’est violent, insupportable.
Les larmes coulent de mes yeux, des sanglots incontrôlables secouent mon corps.
— Eh, qu’est-ce qu’il y a, Ourson ? me questionne Jérém, inquiet et touché.
— C’était tellement bien ce voyage ! Merci, merci Jérém de m’avoir offert tout ça ! Merci pour ce cadeau !
— C’est toi le cadeau, Nico ! il me répond du tac-au-tac, en posant sa main sur ma cuisse.
— Je ne veux plus qu’on soit séparés !
— Moi non plus !
— Je pourrais réviser à Paris ! je réfléchis soudain à haute voix.
L’idée me paraît lumineuse, imparable. Mais Jérém n’est pas de cet avis.
— Tu as besoin de te concentrer sur tes rattrapages. Et si tu restes à Paris, tu n’y arriveras pas, parce que tu ne feras que t’occuper de moi.
— J’adore m’occuper de toi !
— Je sais, Ourson, je sais. Tu m’as déjà tellement aidé ! Mais maintenant je peux y arriver seul. Toi aussi tu as des choses importantes à faire. Il n’y a pas que ma carrière au rugby qui compte. Tes études et ton avenir comptent tout autant.
— Tu seras à Paris et moi à Bordeaux, je considère avec tristesse.
— Oui, mais on va se revoir. Tu vas monter à Paris et je vais venir te voir à Bordeaux.
— Mais moi j’ai envie d’être avec toi tout le temps !
— Je te promets que nous nous reverrons plus souvent qu’avant !
— Maintenant que tu es de plus en plus connu, ça va être de plus en plus compliqué pour toi !
— Je m’en fous ! Je ne veux pas te perdre, et je ne veux pas non plus être loin de toi. On trouvera le moyen, je te le promets !
En France, non ne faisons plus que des étapes physiologiques. Toilettes, repas, cigarettes. Lors d’une halte près de Montpellier, après avoir écrasé son mégot, Jérém me lance :
— C’est la dernière, tout en me montrant son paquet vide.
— On trouvera un bureau de tabac, je fais, arrangeant.
— Pas besoin. C'était ma dernière. Ma toute dernière cigarette.
— Quoi ?
— Je crois que je n’ai plus besoin de ça.
— Tu es sérieux ?
— Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Et c'est grâce à toi, Nico.
Mardi 26 août 2003.
Ce matin, je me sens terriblement triste. Je voudrais arriver à prendre sur moi, je voudrais pouvoir ne pas lui saper le moral. Mais je n’ai pas très bien dormi, et j’ai du mal à cacher ma morosité.
Pendant que je ramasse mes affaires à l’appart de Capbreton, j’ai envie de crever. J’ai du mal à retenir mes larmes. Je réalise que nos vacances ensemble sont finies pour de bon. Je réalise que le petit nuage sur lequel je planais depuis quelques semaines s’est dissipé pour de bon. J’ai l’impression que j’en suis redescendu tellement brutalement que me suis cassé quelque chose. Mon cœur, certainement.
Mes sanglots éclatent à nouveau, comme la veille, pendant que je ferme mon sac de voyage. Ses bras passent autour de ma taille, son torse enveloppe le mien, ses baisers se posent sur mon cou. Même si je sais que demain j’aurai encore envie de pleurer, et qu’il ne sera plus là pour me prendre dans ses bras, ça me fait un bien fou.
Je passe régler mes dernières semaines de location et nous allons au Centre pour récupérer les affaires de Jérém et accomplir les formalités de sortie. Cette dernière étape prend un certain temps, et nous ne repartons qu’à midi.
Nous arrivons à Bordeaux dans l’après-midi. J’aurais tellement envie que Jérém reste avec moi cette nuit, mais il ne peut pas. Il doit être à Paris demain matin, et il a besoin de faire la route calmement. Ça me déchire le cœur de le voir partir. Je le serre très fort contre moi et je le couvre de bisous. Dès qu’il quitte l’appart, je m’effondre en larmes.
Les jours d’après.
Les jours qui suivent ce voyage et cette nouvelle séparation, sont difficiles. L’éloignement de Jérém me pèse, surtout après un voyage comme celui que nous avons partagé. J’ai vraiment du mal à revenir mon quotidien. Mais je finis par retrouver le chemin des bouquins et des notes.
Jérém m’aide beaucoup en cela. Il m’appelle presque chaque soir, et je le sens très proche. Il me pousse à réviser comme je l’ai poussé à suivre son programme de rééducation, malgré les difficultés de la tâche. Il m’aide à surmonter mon découragement, à aller de l’avant.
Le beau brun me raconte ses nouveaux exercices, ses petites victoires quotidiennes. C’est le récit de progrès continus, d’un objectif de reprise de sa carrière de sportif professionnel qui se rapproche de jour en jour. Et ça me fait un plaisir fou.
Pour moi aussi la préparation des examens semble bien avancer. Les premiers jours ça paraissait une chimère. Au bout d’une semaine, ça me paraît faisable.
Chaque soir, je regarde les photos que j’ai fait développer après notre retour d’Italie. 36 poses, dont un quart de ratées, dans lesquelles est fixée à tout jamais la magie de ce voyage. Apricale, Cinque Terre, Firenze, Siena, Roma, Napoli, Capri, Sorrente, autant de noms qui défilent sous mes yeux et m’apportent des souvenirs mêlés de nostalgie.
Je suis assez fier de ma collection de photos de Jérém avec toute sorte de fonds de paysage de rêve (j’ai fini par le saouler en lui demandant de prendre la pose). Jérém devant la mer des Cinque Terre, photo prise depuis la corniche. Jérém devant la Cathédrale de Firenze. Jérém juste à côté de la statue de David piazza de la Signoria, essayant de prendre la pose de David, avec un sourire à tomber par terre (je me souviens de sa réponse de petit con quand je lui avais dit qu’il avait bien réussi son essai : « Mais moi je suis mieux monté que David ! »). Jérém devant le Colisée, Jérém dans une perspective de la Via Appia, Jérém dans une pose prise à Capri depuis la corniche.
A Napoli nous avons les deux seules photos où nous sommes tous les deux, grâce à Carmelo. Je me suis demandé à un moment s’il s’était douté de quelque chose pour Jérém et moi. Il n’a jamais posé la moindre question, et la complicité avec Jérém n’a jamais changé, mais j’ai eu parfois l’impression qu’il avait capté. C’est bien lui qui nous a proposé de nous prendre en photo, à deux occasions différentes.
Il n’y a que deux photos de moi, prises par Jérém, l’une devant le Colisée aussi, l’autre à Capri.
Je rangé religieusement toutes ces photos à la suite de celles que m’avait données Thibault et celle de Campan, dans cet album qui constitue à mes yeux un trésor inestimable.
Lundi 15 septembre 2003.
La veille de mes examens, Jérém me manque tout particulièrement. Car aujourd’hui c’est aussi le jour de mon anniversaire. Et je le passe seul dans mon appart à réviser. Et même si mes adorables voisins ont prévu un apéro pour l’occasion, passer cette journée loin de Jérém s’avère vraiment triste. D’autant plus qu’il semble avoir oublié qu’aujourd’hui est un jour spécial pour moi. Parmi les quelques SMS ou appels qui sont arrivés tout au long de la journée, aucun ne vient en effet de mon bobrun.
Je réalise que ça fait déjà trois semaines que nous sommes rentrés d’Italie, trois semaines que je n’ai pas pu le serrer dans mes bras. J’ai beau regarder les photos pour me souvenir des bons moments passés ensemble. Je suis à Bordeaux, Jérém à Paris. Je crains que nous reprenions notre train-train d’avant, qui consiste à nous voir une fois par mois, ou moins encore.
Il est 18 heures quand la sonnette de mon appart retentit. J’ouvre la porte et Jérém est là, habillé d’une chemise bleu clair et d’un jeans, beau comme un Dieu. Je me jette à son cou, fou de joie. L’espoir que j’ai secrètement nourri pendant toute la journée est finalement devenu réalité.
— Bon anniversaire, Ourson !
Mardi 16 septembre 2003.
Ce matin, Jérém repart de bonne heure. Faire l’amour avec mon bobrun, dormir dans ses bras, me réveiller à ses côtés m’a fait un bien fou. Ça m’a reboosté le moral et je me sens d’attaque pour tout déchirer.
Et en effet, ma semaine d’examens se passe plutôt bien. J’ai la moyenne partout et ma deuxième année de fac est validée.
— Je n’aurais jamais cru que j’y arriverais ! je lance à Jérém lorsqu’il me félicite pour ma réussite.
— Moi je l’ai toujours cru !
— Il en faut bien un qui y croit !
— Tu as cru en moi pendant des mois !
Jeudi 16 octobre 2003.
Aujourd’hui, Jérém a 22 ans.
Je monte voir mon beau brun à Paris le week-end après son anniversaire. La date de son retour sur le terrain se précise. Ce sera pour le match du 29 novembre. Le compte à rebours est enclenché.
Mon beau brun a l’air en pleine forme. Il est de très bonne humeur. La musculation sans réserve et les entraînements en situation réelle ont commencé depuis deux semaines et tout se passe bien. Tout a tenu bon, sa cheville, son genou, et il n’y pas de douleurs.
D’ailleurs, la musculation lui réussit à merveille. Son corps a retrouvé la tonicité d’avant l’accident. Ses biceps, ses pecs, ses abdos sont à nouveau merveilleusement saillants.
— Je suis comme neuf ! il me lance, l’air heureux comme un gosse, lorsque je le lui fais remarquer.
— Là aussi je suis comme neuf ! il me glisse, lorsque j’avale sa queue bien tendue.
Et c’est ce que je constate lorsque ses giclées brûlantes percutent mon palais avec une délicieuse puissance.
Il est vrai que mon beau rugbyman est chaud comme une patate. J’ai l’impression, une impression qui est fondée sur rien, certes, mais qui s’impose avec force dans ma tête, que depuis que nous sommes revenus d’Italie, il n’a pas eu d’aventures à Paris.
Vendredi 14 novembre 2003.
Le premier match de Jérém est dans moins de deux semaines. Au téléphone, j’ai l’impression qu’au fur et à mesure que la date se rapproche, mon beau brun recommence à stresser à bloc. J’ai l’impression qu’il doute à nouveau.
C’est pourquoi ce week-end je remonte à Paris pour passer du temps avec lui. Je me charge de l’encourager, de chasser les doutes de son esprit. Mais aussi de le détendre. Je le fais jouir autant de fois qu’il faut pour que les endorphines libérées par les orgasmes le fassent planer très loin.
Samedi 29 novembre 2003.
Aujourd’hui, c’est le grand jour. Jérém va jouer son premier match de championnat, huit mois après son accident et ses blessures multiples. Après un long parcours de soin et de rééducation. Après beaucoup de souffrance. Je prie pour que tout se passe bien, pour qu’il n’y ait pas d’autres blessures, pour que Jérém redevienne le champion qu’il était avant.
Évidemment, je fais le déplacement pour assister à son grand retour. Pour veiller sur lui. Bien sûr, ma présence ne va le préserver de rien. Mais je me persuade que si je ne le quitte pas des yeux, il ne peut rien lui arriver. Ou alors, je me libère au moins de la peur qu’il puisse lui arriver quelque chose si je suis loin. Ce ne sont que des superstitions, bien entendu.
De toute manière je ne pourrais pas rater cette journée si importante pour Jérém. D’autant plus que j’ai senti que c’était important pour lui que je sois présent à son premier match.
Le stade se remplit peu à peu et l’effervescence monte en pression. C’est beau un stade qui vibre, qui acclame, un public qui s’agrège autour d’une passion, d’un amour, d’un partage. J’ai connu ça lors du concert de Madonna il y a deux ans. J’ai connu ça lors de la finale du Top16 en juin dernier. Mais jamais l’émotion que j’ai ressentie n’a été aussi forte que celle que je ressens aujourd’hui. Je suis à la fois impatient et mort de trouille à l’idée de voir Jérém débouler sur le terrain.
Le stade est presque plein. Les deux commentateurs du match, qui est télévisé, égrainent des statistiques des deux équipes et de leurs joueurs respectifs.
— Aujourd’hui, c’est un jour important, lance l’une des voix diffusées par les enceintes du stade.
— Nous avons appris que Jérémie Tommasi va faire son grand retour après son terrible accident au printemps dernier.
— Nous lui souhaitons la bienvenue, avec les meilleurs vœux d’une reprise sur les chapeaux de roues !
— Il me semble qu’on dit tout simplement un mot qui commence par « m » dans ce genre d’occasions… fait son acolyte.
— C’est vrai. Alors, un grand « m » pour toi, Tommasi !
Le stade, du moins une grosse moitié, rugit sa liesse. Ça produit une onde de choc qui fait tout vibrer, les tribunes, les sièges, tout mon corps, et mon cœur avec.
Les joueurs débarquent sur le terrain. L’enceinte remplie à ras-bord réitère sa ferveur lorsque la belle petite gueule de Jérém apparaît sur les écrans géants. Mon beau brun a l’air touché, ému, et un tantinet perdu. Son expression me rappelle celle qu’il avait lors de son tout premier match en championnat, un an plus tôt. D’une certaine façon, c’est à nouveau son premier match, ses débuts. Aujourd’hui comme alors, il doit se demander s’il va être à la hauteur.
Il a perdu l’assurance effrontée qu’il avait pendant les derniers matches avant l’accident, lorsque tout lui réussissait et qu’il se croyait invincible. Depuis son accident, il a pris conscience qu’il est vulnérable. Qu’il est fait de chair et de sang. Que tout peut arriver lors d’un match.
Une poignée de minutes après le début du match, Jérém reçoit son premier ballon. Il a l’air surpris. Un joueur fonce sur lui. Il a l’air effrayé. Après une courte hésitation, il fait une passe à un coéquipier. Il en fait de même quelques minutes plus tard. Puis, une troisième fois. Lorsqu’il reçoit le ballon, il s’en débarrasse aussitôt, comme si ça lui brûlait les doigts.
Ça, ce n’est pas le Tommasi que je connais, celui qui marquait essai sur essai lors des matches de la saison dernière. Le Jérém d’avant aurait esquivé l’adversaire, et il aurait foncé vers la ligne de but, sans se préoccuper des obstacles qui se seraient posés sur son chemin.
Le Jérém d’aujourd’hui a visiblement peur du contact physique. Il a peur de se faire mal.
Le ballon est récupéré par l’équipe adverse, qui marque un essai. Jérém a l’air déçu et frustré.
Les actions se succèdent, et Jérém ne va jamais au but. Il n’a pas l’air dans son assiette. La fin de la première mi-temps approche, le Stade est mené par 6 à 11. Jérém reçoit le ballon suite à une passe d’Ulysse. Il fonce vers la ligne de but. Un joueur de l’équipe adverse fonce sur lui et le percute. Il tombe, il perd le ballon.
Oh non ! Pas encore ! Pas d’autres blessures !
Heureusement, Jérém se relève aussitôt, et c’est un grand soulagement. Mais le ballon est déjà loin, et l’autre équipe marque à nouveau. 6-14. La cata.
L’entraîneur du Stade demande un temps mort. Sur le bord du terrain, je le vois gesticuler, s’énerver, discuter de façon très animée avec un autre membre du staff. Je devine qu’il n’est pas content, et qu’il n’est pas content tout particulièrement de la prestation de Jérém. Je devine qu’il envisage de le faire sortir et de le remplacer.
L’entraîneur fait un signe à l’un des joueurs assis sur le banc de touche. Ce dernier se lève et commence à faire des petits exercices d’échauffement.
Non, non, non ! Il ne faut pas qu’il fasse ça, pas maintenant ! Jérém a besoin d’un peu de temps encore pour reprendre confiance. S’il est remplacé maintenant, il va prendre ça comme une punition, un désaveu, un manque de confiance. Et ça va lui foutre le moral plus bas que terre. Son corps est guéri, il faut que son moral guérisse aussi. Je repense aux mots qu’Ulysse m’avait dits lorsque je l’avais croisé à l’hôpital à Paris juste après l’accident de Jérém, comme quoi les blessures au moral sont les plus difficiles et les plus longues à guérir. S’il vous plaît, Monsieur l’entraîneur, donnez-lui le temps de panser cette blessure, faites-lui confiance ! N’aggravez pas la situation, n’hypothéquez pas son avenir sportif en le remplaçant maintenant !
Je voudrais quitter ma place, courir vers l’entraîneur, lui dire d’attendre, de ne pas faire l’immense bêtise qu’il s’apprête à faire. Mais je me sens impuissant. Je suis conscient que je n’ai aucune autorité pour aller souffler quoi que ce soit à un professionnel qui a l’habitude de gérer ses joueurs et qui a de surcroît un match très mal engagé à redresser.
Non, moi je n’ai pas cette autorité, ni ce cran. Mais Ulysse, lui, il les a.
Le boblond quitte le terrain et fonce sur son entraîneur. Il s’entretient avec lui. L’échange a l’air très animé. Mais lorsque le demi de mêlée revient sur le terrain, le joueur qui s’apprêtait à remplacer Jérém est à nouveau assis sur le banc de touche. L’entraîneur a l’air toujours en pétard, mais un brin plus calme, comme rassuré. Visiblement, les arguments du beau blond, et j’aime bien penser que ce sont les mêmes que ceux qui ont traversé mon esprit, ont fait le poids.
Ulysse se dirige alors vers Jérém, lui glisse quelque chose à l’oreille. D’un geste rapide, mais extrêmement émouvant, il pose une main sur son cou, puis sur son épaule.
Le jeu reprend. Au bout d’une poignée de minutes, Jérém reçoit une nouvelle passe d’Ulysse. Et là, je vois que quelque chose a changé dans son attitude. Exit la posture craintive et démissionnaire des actions précédentes. Dans son attitude et dans son regard, je retrouve enfin cette flamme qui l’animait avant son accident. Jérém se tape un sprint qui surprend ses adversaires. Le vent n’a qu’à bien se tenir. Il a retrouvé son maître. Le lapin Duracell est de retour. Il court, il court, il court, il évite deux adversaires, il se fait percuter par un troisième, mais il ne tombe pas, il fonce droit vers la ligne de but. Et il pose le ballon juste au-delà.
Jérém vient de marquer le premier essai depuis son retour en championnat. Une grosse moitié du stade exulte de joie. Ulysse se précipite sur mon bobrun, le serre fort dans ses bras et lui glisse quelque chose à l’oreille. Jérém est visiblement touché. Les écrans montrent son visage ému, et moi qui le connais bien je sais que les larmes sont retenues de justesse.
La fin de la première mi-temps est sifflée.
Dès le début de la deuxième, Jérém marque un nouvel essai. Mais il semble fatiguer. Il est finalement remplacé à la 21ème minute de jeu. Mais là, son remplacement ne se fait pas sur un échec, mais sur une réussite. C’est la sauvegarde d’un joueur qui reprend peu à peu le jeu après un grave accident et non pas un désaveu.
D’ailleurs, lorsque Jérém quitte le terrain, l’entraîneur lui met une tape sur l’épaule qui montre son bonheur d’avoir retrouvé son ailier vedette.
Le match est finalement remporté de justesse par le Stade. Un score de 18-20, dans lequel le poids des points marqués par Jérém est de 30%. Pas mal du tout pour un premier match après huit mois loin de la pelouse.
La caméra s’attarde sur mon bobrun qui a regagné la pelouse pour partager la joie de ses coéquipiers, tandis que l’assistance fait trembler l’enceinte de sa vibration puissante. La joie de Jérém à cet instant précis me donne envie de pleurer tellement c’est beau.
Entre démonstrations de liesse des gagnants et accolades viriles, les équipes s’apprêtent à quitter le terrain. Je quitte mon siège, et grâce à mon badge passe-partout, je peux accéder à la pelouse. A côté des entrées des vestiaires, je retrouve les Tommasi, père et fils cadet.
Ils ont l’air tout aussi émus l’un que l’autre. Maxime vient me faire la bise et me prendre dans ses bras.
Quant à monsieur Tommasi, il me serre la main très fort. Il me regarde droit dans les yeux. Les siens sont humides. Les larmes sont retenues. Un bonhomme ne pleure pas. C’est ce qu’il a appris à Jérém depuis toujours.
[Tu aperçois ton père sur le bord du terrain. Son seul regard brise les restes de ton armure. Lui qui t’a appris qu’un bonhomme ne pleure jamais, aujourd’hui il a les larmes aux yeux. Lui par qui tu t’es longtemps senti rejeté, a l’air enfin fier de toi. Lui qui ne t’a jamais dit le moindre mot d’encouragement, par qui tu n’as jamais reçu la moindre félicitation pour ta carrière naissante, est désormais ton premier fan. Lui qui t’a dit que tu le dégoûtais et qu’il ne voulait plus te voir quand il a compris pour Nico et toi, il est là pour fêter ton retour sur le terrain de jeu. Ton père te montre enfin son amour et c’est comme si un poids immense cessait d’écraser ton esprit].
Mais un bonhomme qui voit son enfant renouer avec ses rêves après qu’il a cru les avoir perdus à tout jamais, peut craquer quand-même. Lorsque Jérém s’approche de lui, Mr Tommasi fond en larmes. Il le serre très fort dans ses bras, et il plonge son visage dans le creux de son épaule. Les deux hommes pleurent ensemble, de joie.
Quelques instants plus tard, alors que Maxime n’en finit plus de féliciter son grand frère, Mr Tommasi s’approche de moi et me lance :
— Merci, Nicolas, merci infiniment. Tout ça, c’est à toi qu’il le doit.
— C’est à lui qu’il le doit, il s’est battu comme un lion !
— Je sais ce que tu as fait pour mon fils.
— J’ai fait ce que je devais faire.
— Non, tu as fait beaucoup plus. Tu as été à la hauteur même quand je ne l’ai pas été. Et je t’en serai reconnaissant à tout jamais.
Et puis, c’est enfin à mon tour de féliciter le champion qui a retrouvé sa forme. Jérém me saute littéralement au cou. Il est si heureux et je suis si heureux pour lui ! Mon beau brun pleure de joie. Il me serre très fort contre lui, il plonge son visage dans le creux de mon cou. Dans cette étreinte, il n’y a pas de place pour les mots. Mais je ressens toute sa joie, et toute la reconnaissance qu’il me porte. Je suis aux anges.
Ulysse prend Jérém dans ses bras et l’embrasse sur le front, sur les joues. Quelques instants plus tard Jérém est soulevé par les bras puissants de ses coéquipiers dans une scène de liesse touchante et merveilleusement virile.
[Aujourd’hui, après ce premier match, tu sens en toi tellement de choses trouver leur place, se ranger, s’apaiser. Tu ne t’es jamais senti si bien dans tes baskets de toute ta vie.
Tu en arrives même à te dire que finalement cet accident, malgré toute la souffrance que tu as dû endurer, a été le déclencheur de quelque chose de merveilleux. La découverte d’à quel point tu comptais pour tant de monde.
C’est grâce à cet accident, que tu as renoué avec ta mère, et que tu t’es rapproché de ton père. C’est aussi grâce à cet accident que l’amour de Maxime, ainsi que l’amitié de Thibault et d’Ulysse t’ont sauté à la figure comme jamais auparavant. Que les retrouvailles avec tes coéquipiers et tes supporteurs ont été si chaleureuses et émouvantes.
Et c’est encore grâce à cet accident que l’amour de Nico t’a bouleversé. Tu savais que tu comptais pour lui. Mais là, il te l’a montré au-delà de toutes tes attentes. Tu sais désormais que ce petit mec à les couilles d’un grand. Qu’il a la patience, l’endurance, l’intelligence du cœur. Tu sais que sans lui, tu ne serais pas sur ce terrain aujourd’hui. Et tu sens que tu l’aimes comme tu n’as jamais aimé personne.
Un journaliste se jette sur toi avec son micro, son opérateur te braque avec sa caméra épaule avec torche ultrapuissante. Sa voix résonne dans les enceintes du stade, ton image s’affiche sur les écrans. Tu sais que tu ne vas pas y échapper.
— Alors, Tommasi, satisfait de votre retour dans le Top16 ?
— Très satisfait !
— Vous revenez de loin…
— Je reviens de loin, et…
Puis, après un instant d’hésitation, tu trouves la force de continuer, d’exprimer ce qui te tient à cœur :
— Et je ne serai pas là aujourd’hui sans le soutien de tout le personnel hospitalier qui s’est occupé de moi. Je pense bien sûr au Professeur Dupuy, mais aussi à tous les infirmiers, infirmières, aides-soignants, médecins, kinés, toutes ces personnes qui ont fait un travail formidable. Un merci de tout cœur, mon retour sur le terrain est le fruit de votre travail. Cette victoire, est votre victoire.
— C’est gentil à vous de penser à eux, lance le journaliste. Et qu’est-ce que vous avez ressenti en marqua…
— Il y a aussi d’autres gens qui m’ont soutenu, tu le coupes net.
Car tu as envie de remercier d’autres personnes, et une en particulier. Tu ressens le besoin de le faire, après tout ce qu’il a fait pour toi. Mais comment le faire, sans que ça se retourne contre toi ?
— Votre famille, j’imagine.
— Ma famille, oui, et les amis… et… et…
Tu as envie de prononcer son prénom, mais la première lettre reste coincée entre le bout de ta langue et tes incisives].
Jérém est submergé par l’émotion. Je sens qu’il n’arrivera pas à terminer sa phrase, mais je sais pertinemment quel est le mot qui n’a pas pu sortir de sa bouche après ces « et » répétés. C’est un prénom, le mien, qu’il n’ose pas prononcer devant la France entière.
— L’émotion est là, coupe court le journaliste, c’est l’émotion d’un retour triomphal. On vous souhaite le meilleur pour la suite.
Oui, Jérém est submergé par l’émotion, mais aussi par la frustration. Une frustration qu’il trouve pourtant le moyen d’évacuer. Au dernier instant avant que la caméra et le micro ne se détournent de lui, je le vois glisser ses doigts dans le col de son maillot, et en sortir la chaînette que je lui ai offerte, et l’embrasser.
Novembre et décembre 2003.
Les matches suivants sont les chapitres d’une histoire de récupération fulgurante. Très vite, Jérém retrouve sa niaque, et recommence à marquer à tout va. Quant à moi, je ne rate pas un seul match. Je suis souvent présent dans les tribunes, et quand ce n’est pas possible, je suis devant ma télé.
Jérém tient sa promesse. La porte de son « chez lui » est désormais grand ouverte pour moi. Je peux y aller quand je veux, comme je veux. Non seulement mon bobrun m’a payé un abonnement de train à l’année, mais il m’a même filé une clé de son appart.
Bien entendu, la discrétion fait toujours partie du deal. Pas question de sortir dans Paris main dans la main ou de nous afficher devant ses coéquipiers, exception faite pour Ulysse. Mais je sais que Jérém est heureux de me retrouver après sa semaine d’entraînement, après son match du samedi, de passer le dimanche à se reposer et à faire l’amour avec moi.
Mi-décembre, la bonne nouvelle tombe. Le contrat de Jérém est renouvelé non seulement jusqu’à la fin de la saison 2003-2004, mais pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en août 2006. L’avenir sportif de Jérém n’a jamais été aussi radieux. Jérém n’a jamais été aussi radieux, aussi bien dans sa peau, dans ses baskets, dans sa vie. Tout semble lui sourire.
Mercredi 31 décembre 2003.
Pour le réveillon de fin d’année, le choix de Campan s’est imposé comme une évidence. C’est là que Jérém retrouve ses racines, c’est là qu’il est le plus heureux. Tous les cavaliers sont au rendez-vous. Thibaut, Maxime et même Ulysse sont de la partie. Jérém est chaleureusement félicité pour son grand retour dans le Top16. Nous sommes entourés par la bienveillance et la bonne humeur habituelles, nous sommes bercés par la guitare de Daniel qui nous fait voyager, chanter, rêver. C’est une soirée riche en émotions, une soirée qui réchauffe le cœur. Comme toutes celles passées en ce lieu, avec cette compagnie.
Jeudi 01 janvier 2004.
La nouvelle année est déjà âgée de trois bonnes heures lorsque le joyeux comité se disperse. Les adieux sont comme toujours touchants, émouvants. Nous nous sommes retrouvés comme si nous nous étions quittés hier. Nous nous disons au revoir comme si nous devions nous revoir le lendemain, mais sans savoir quand nous allons nous retrouver. Ce que nous savons en revanche, c’est que quand le moment des retrouvailles viendra, que ce soit dans une semaine, dans un mois, dans un an, elles seront toujours aussi chaleureuses. Nous savons que notre amitié perdurera malgré la course du temps et la distance. Et ce genre d’amitié est celle qui réchauffe le cœur avec la plus belle flamme. Car elle nous fait oublier la course du temps. Car, dans une vie où tout change en permanence, ce genre d’amitié pose des repères sacrement rassurants.
De retour à la petite maison, Jérém et moi faisons l’amour devant le feu. Le plaisir se mélange à une tendresse débordante. J’ai l’impression de flotter, de m’envoler vers une dimension de bonheur total où les incertitudes de l’avenir, et même la sensation du temps qui passe, sont des notions dont j’ai perdu toute conscience. Certains appelleraient cela le Paradis.
Je ne peux m’empêcher de comparer ce réveillon à celui d’il y a un an, ce triste 31 décembre passé loin de Jérém. Mais aussi, et surtout, à celui d’il y a deux ans, à ce merveilleux 31 décembre passé ici même, dans cette petite maison isolée du reste du monde par une importante chute de neige. Ce 31 décembre où pour la toute première fois, à la tombée de minuit, Jérém m’a dit « Je t’aime ».
A minuit, cette année, nous étions encore au relais.
A minuit, cette année, Jérém m’a pris dans ses bras, il m’a regardé droit dans les yeux et il m’a lancé, devant tout le monde :
— Tu peux pas savoir à quel point je t’aime !
La joie que m’a procurée le retour de ces trois petits mots entre ses lèvres est tout bonnement indescriptible.
— Je t’aime comme un fou ! j’ai répondu, fou de joie.
Et là, sous les quolibets bienveillants de l’assistance, il m’a embrassé longuement.
Non, il ne faut jamais perdre espoir. L’année 2003 qui avait si mal commencé, se termine de la plus belle des façons. Et l’année 2004 s’annonce sous les meilleurs auspices.
 13 commentaires
13 commentaires
-
Par fab75du31 le 28 Octobre 2022 à 21:53
Depuis que sa récupération est enfin sur de bons rails, depuis que son attitude laisse deviner qu’il recommence à croire en la perspective de retrouver son niveau sportif d’avant, Jérémie s’intéresse à nouveau au rugby. Il regarde les matches du Stade à la télé, je les regarde avec lui. Il est heureux de voir son équipe gagner et se qualifier, mais il bout à l’intérieur de ne pas pouvoir apporter sa contribution à cette belle épopée sportive. Il regarde aussi les matches de l’autre Stade. Et il est tout aussi heureux de voir l’équipe de Thibault faire un très beau parcours et se qualifier également.
Cette saison, les deux Stades du Top 16 ne sont jamais dans la même poule, ni dans la phase de classement, ni dans celle de qualification. Ce qui fait que leurs chemins ne se croisent que dans la grande finale du Top16.
Le match le plus attendu de la saison est fixé au 7 juin au Stade de France.
— Putain, le Stade de France, en plus ! Le Stade de France ! s’emporte Jérém, l’air à la fois emballé, excité, impressionné et terriblement frustré.
Je sais qu’une telle finale, Stade Français contre Stade Toulousain, ça le fait rêver, ça le fait bander même. Car c’est une finale qui lui aurait enfin permis de jouer un match de championnat, le plus prestigieux de tous, qui plus es, face à son ami d’enfance, dans ce lieu démesuré. Alors, la perspective de ne pas pouvoir être présent sur le terrain, de rater ce grand moment sportif, lui plombe sacrément le moral.
Samedi 07 juin 2003, Stade de France.
Le match doit démarrer à 14 heures. Mais une bonne heure avant le coup de sifflet, l’immense enceinte commence à être bien remplie et à devenir bruyante, démonstrative, vivante, vibrante, impressionnante.
Jérém a été invité à suivre le match, et il a été installé sur le banc de touche pour être au plus près de l’action. Curieux paradoxe que ce placement qui le met au plus près de cette action, tout en lui rappelant sans cesse à quel point il en est loin.
Quant à moi, Ulysse a pu me trouver une place en Tribune Bas Ouest.
Quelques minutes avant le début du match, les écrans géants du stade affichent mon Jérém en gros plan. Qu’est-ce qu’il est beau en costume, chemise blanche et cravate ! Il est à la fois très élégant, mais aussi terriblement sexy dans son style particulier, un style qui consiste à porter la chemise ouverte de deux boutons en haut, la cravate lâche, une dégaine rappelant des ambiances de fin de soirée arrosée et de relâchement de mœurs. Si je m’écoutais, j’irais le sucer sur le champ.
En même temps, les béquilles posées à ses côtés me font mal au cœur. Et la vulnérabilité qui se dégage de cette image, d’un joueur mis sur le banc de touche par une sale blessure, un joueur au moral cassé, le rend à mes yeux terriblement touchant. Si je m’écoutais, j’irais le prendre dans mes bras sur le champ.
Le commentateur parle de Jérémie et de son accident, « nous lui souhaitons de retrouver le chemin du terrain de jeu pour bientôt ».
Cet après-midi, la pelouse du Stade de France reçoit la fine fleur du rugby français. Deux Titans du championnat s’affrontent. Le choc est brutal. Le match est serré. Je n’ai que rarement vu Thibault jouer, mais je le trouve très tactique, fin stratège, il semble toujours avoir au moins deux coups d’avance sur tout le monde. Thibault est un facilitateur d’actions, on dirait que le jeu des Toulousains gravite autour de lui. Son jeu est à son image, adroit, futé et respectueux.
Je peux juste imaginer ce que Jérém ressent pendant ce match, lorsque les points sont marqués par son équipe ou par celle de Thibault. Il doit se sentir terriblement frustré. Vers la fin de la première mi-temps, la caméra refait un plan sur Jérém et sur ses béquilles. Jérém les tient désormais dans ses mains, comme s’il était à deux doigts de se lever et partir. Il a l’air dépité, dégoûté.
Le beau brun finit par lever le regard et il se voit sur les écrans. L’image qu’il voit de lui ne doit pas lui plaire. Avec un geste un brin agacé, il repose les béquilles à côté de lui.
Les actions se suivent, les points s’enchaînent. Les deux forces en présence sur le terrain sont toutes deux aussi remarquables. Mais il ne faut qu’un seul gagnant.
Au coup de sifflet final, le score affiché est de 32-18 en faveur du Stade Français. L’équipe de Jérém a gagné et la caméra fait un long plan sur Ulysse et sa belle crinière blonde, sur son visage en nage mais heureux, elle le montre en train d’échanger des accolades à répétition avec ses coéquipiers, mais aussi avec ses adversaires.
La caméra montre ensuite d’autres joueurs. Mais elle revient vite sur Ulysse. Et l’image qu’elle va montrer, me remue les tripes et m’arrache les larmes. Le beau blond au maillot bleu traversé par deux éclairs rouges a filé droit vers Jérém, et il est en train de le serrer très fort dans ses bras. Jérém est en larmes et son coéquipier lui caresse les cheveux, il pose des bisous sur son front. Un instant plus tard, un autre joueur, avec un maillot aux couleurs rouge et noir, s’incruste dans l’image. Thibault est là, et Ulysse lui cède sa place sur le champ. L’accolade entre les deux potes d’enfance est tout aussi émouvante, et elle dure longtemps, alors que le commentateur parle des deux champions toulousains, dont l’un très malchanceux, lui souhaitant une nouvelle fois un prompt rétablissement.
Je réalise que le stade est en train de scander « Tommasi ! Tommasi ! Tommasi ! ». Le stade ovationne mon beau brun et lui tire d’autres larmes. Non, Jérém n’a pas joué aujourd’hui. Mais il s’est quand même payé une sacrée démonstration d’affection, d’amitié, d’amour.
Quelques minutes plus tard, les joueurs parisiens soulèvent le bouclier de Brennus. Ulysse est tout proche de Jérém et le soutient lorsqu’il est obligé d’abandonner ses béquilles pour soulever le trophée que ses coéquipiers veulent à tout prix partager avec lui. L’image est belle, et terriblement émouvante.
Sur le bord du terrain, à proximité des entrées des joueurs, je reconnais Maxime. Je savais qu’il viendrait assister au match, et il n’est pas venu seul. Mr Tommasi est là aussi. Ils attendent certainement que l’équipe gagnante quitte le terrain pour aller à la rencontre de Jérém.
Maxime me voit et me fait signe d’approcher. J’accepte son invitation, malgré quelques réticences à approcher son père après l’accident diplomatique à l’hôpital, après qu’il a découvert que Jérém et moi n’étions pas que de simples amis. Je me dis que s’il est venu, ce n’est pas pour faire la guerre à Jérém, et que l’intense émotion du moment le mettra dans de meilleures dispositions vis-à-vis de moi.
Lorsque j’arrive près d’eux, Maxime me fait la bise et me prend dans ses bras. Je tends la main à Mr Tommasi, il la saisit. Et là, j’ai la surprise de sentir son bras m’attirer contre lui, et de recevoir la bise de sa part.
— Salut, Nico.
— Bonjour, Monsieur.
— Je te dois des excuses, Nico. J’ai été trop con avec Jérém et toi à l’hôpital. Je suis vraiment désolé.
— Ne vous en faites pas, c’est oublié.
— Je te dois aussi une fière chandelle. Maxime m’a dit tout ce que tu as fait pour mon fils. Alors, merci, Nico, merci infiniment !
— Je n’ai fait que ce que le cœur m’a dit de faire.
— Alors ton cœur a été sage, plus sage que ne l’a été le mien.
Les joueurs de l’équipe gagnante quittent enfin le terrain. Jérém avance à son rythme, qui est celui de ses bras et de ses béquilles. Il est escorté par l’adorable Ulysse. Maxime et son père se dirigent vers lui. Maxime le prend dans ses bras en premier. Et son père, en fait de même dans la foulée.
La suite de cette journée si riche en émotions est un grand dîner dans un restaurant parisien. Autour de la table, en plus de Jérém, Papa et moi, Ulysse et Thibault qui ont pu s’échapper pendant une partie de la soirée aux programmes mondains de leurs équipes respectives, Maxime et son père, mais aussi Thierry et Thomas, qui ont eux aussi fait le déplacement pour la finale.
Jérém est comme ivre de toute cette avalanche d’affection qu’il a reçue en une seule journée.
La conversation tourne longuement autour de la finale. Thibault et Ulysse détaillent les actions, échangent leurs ressentis, ils les comparent aux impressions des quelques spectateurs présents à ce dîner. Non seulement les deux demi de mêlée affichent une belle complicité, mais aussi un humour des plus vifs et joyeux. Thibault ne semble en rien affecté par la défaite de son équipe. C’est un garçon intelligent, et il sait que le Stade toulousain n’a pas démérité aujourd’hui. C’est aussi un vrai sportif, qui sait que l’important dans le jeu, c’est le jeu, pas la victoire.
Jérém les écoute, mais je vois bien qu’il se tient en retrait. Je sais à quoi il pense, et je sais que malgré toute l’affection qu’on lui a témoignée, cette finale vécue en costard cravate demeure une plaie béante pour lui.
— J’aurais tellement aimé être sur le terrain, cet après-midi ! il finit par lâcher.
— On se retrouvera l’année prochaine, en finale, et on vous mettra une sacrée raclée, fait Thibault, en provoquant Jérém et Ulysse.
— Le jour où vous allez jouer l’un contre l’autre, nous autres on ne va pas savoir pour quel stade courir ! plaisante Thierry.
— N’importe quoi ! On est Toulousains, et le cœur d’un Toulousain ne peut battre que pour l’équipe de sa ville natale… il n’y a qu’un seul Stade, enfin !
— C’est vrai, il n’y a qu’un Stade, celui de la capitale ! fanfaronne le beau blond. Et personne ne peut gagner contre le seul et l’unique !
— T’as qu’à croire ! le mouche Thibault.
— On a gagné cette année alors que Jérém a raté une bonne partie de la saison… alors, l’année prochaine, quand il sera de retour, je vous raconte pas les dégâts !
— J’espère seulement pouvoir revenir !
— Moi je ne l’espère pas, moi j’y compte. Je courais beaucoup moins quand tu étais sur le terrain ! lance Ulysse.
— Moi aussi j’y compte, ajoute Thibault. C’est moins marrant de jouer en pensant que toi tu te fais chier en rééducation.
Il est près de minuit lorsque cette belle soirée prend fin, lorsque ce beau comité se sépare. Thibault et Ulysse sont appelés par leurs troisièmes mi-temps respectives. Mr Tommasi accuse le coup du voyage en voiture après un départ au petit matin depuis Toulouse. Maxime doit retrouver sa copine chez une amie à elle. Thierry et Thomas semblent quant à eux bien décidés à profiter de tout ce que peut leur apporter la nuit parisienne.
Jérém et moi rentrons à l’appart. Nous sommes en train de nous câliner lorsque la sonnette déchire le silence nocturne. Jérém referme sa braguette, il reprend ses béquilles et se dirige vers l’entrée.
— Je n’avais pas envie de faire la fête avec l’équipe. J’avais envie de passer un peu plus de temps avec vous deux, nous explique l’adorable Thibault.
Jérém a l’air content que son pote soit là. Je suis content aussi, car je sais à quel point la présence de Thibault peut faire du bien à mon beau brun.
Autour d’une bière, la conversation entre Thibault et Jérém tourne autour de la pression psychologique dans le rugby professionnel, une pression pour la performance qui a été amenée par la professionnalisation.
— L’argent est partout, et il prend beaucoup trop de place, commente Thibault. Le besoin de gagner à tout prix fait perdre le plaisir simple du jeu, et provoque un jeu plus violent, plus dangereux. Il est important que les joueurs en prennent conscience, et que le respect de l’intégrité physique de tout le monde, y compris les adversaires, soit la priorité absolue.
Jérém a l’air vraiment touché par la présence et l’affection de son pote. Je suis soulagé qu’il ait bien pris ce qui s’est passé entre Thibault et moi en début d’année. Le beau pompier aussi avait été soulagé quand je lui avais dit que j’avais tout raconté à Jérém et qu’il ne s’en était pas offusqué.
Cette nuit, c’est Thibault qui prend les choses en main. C’est lui qui embrasse Jérém en premier, qui le caresse, le déshabille. C’est lui qui glisse sa main dans son boxer, qui le branle doucement.
Cette nuit, Jérém laisse Thibault venir en lui. C’est la première fois que je vois Jérém s’offrir à un autre gars que moi. C’est tellement beau de voir Jérém enveloppé par la virilité de Thibault. C’est tellement beau de voir deux si beaux garçons se faire du bien, s’offrir mutuellement du plaisir !
En m’approchant de près de ce magnifique spectacle, avec mes yeux, mes mains, mes caresses, mes lèvres, mes baisers, ma langue, mon désir, je suis enivré par les tièdes effluves virils, par le bonheur sensuel qui se dégagent de cette étreinte entre ces deux splendides Dieux Mâles.
Cette nuit, chacun de nous s’offre aux autres, chacun de nous possède l’autre à tour de rôle. Nous empruntons des chemins de plaisir encore jamais sillonnés, nous explorons de nouvelles voies de sensualité. Il n’y aucune réticence, aucune jalousie, aucune possessivité, juste l’envie d’être bien entre potes, une communion d’Etres qui s’aiment de la façon la plus pure et plus belle qui soit, celle qui consiste à être comblé en faisant du bien à l’autre.
Et lorsque je me retrouve allongé sur le lit, entre les deux mâles repus, assommés de plaisir, je sens qu’une immense tendresse perdure entre nous, une tendresse qui se manifeste avec des câlins, des caresses, des baisers, des petites conversations légères, une belle complicité, des confidences, des rires.
Juin 2003.
A partir du lundi qui a suivi la finale du championnat de rugby et cette nouvelle nuit magique en compagnie de Thibault, la rééducation de Jérém reprend de plus belle. Pendant deux semaines, les progrès sont encourageants. Jérém est d’une humeur sereine, voire joyeuse.
Par ailleurs, nous faisons l’amour aussi souvent que nous le pouvons. C’est à dire, aussi souvent que je peux dormir avec lui. C’est-à-dire à chaque fois que l’équipe de Laetitia est de garde, soit quatre fois par semaine.
Il m’arrive également de le sucer vite fait entre midi et deux. Qu’est-ce que c’est bon de retrouver sa virilité bouillonnante, conquérante. Et cette étincelle de fierté masculine dans son regard !
Juillet 2003.
Début juillet, la rééducation en piscine s’alterne avec celle sur vélo d’entretien articulaire. Peu à peu, le tapis de marche est introduit dans le protocole de rééducation. Durant la deuxième quinzaine de juillet, Jérém est autorisé à marcher sans béquilles. Le premier essai pour se mettre debout sur le seul appui de ses jambes est un moment très émouvant. Au début, il n’est pas très confiant. Il fait la grue. Il tremble sur sa jambe valide, comme si elle était en coton. Il manque de peu de perdre l’équilibre, le kiné le rattrape de justesse.
— Faites-vous confiance, Mr Tommasi, l’encourage son kinésithérapeute, la cicatrisation est terminée et parfaitement réussie, là vous ne risquez plus rien.
Progressivement, la marche en extérieur est introduite dans le protocole. Un coach l’accompagne, et Jérém accepte que je me joigne à eux pendant les sorties. Des sorties dont la durée augmente chaque jour et qui se passent la plupart du temps sur la promenade qui donne sur le spectacle majestueux offert par l’océan.
Oui, la rééducation marche plutôt bien, et tout semble se dérouler pour le mieux. Et Jérém se montre de plus en plus reconnaissant vis-à-vis de ma présence et de ma persévérance à ses côtés.
Août 2003.
En ces premiers jours du mois d’août, la progression de sa reprise de mobilité semble ralentir, et Jérém a très vite l’impression de faire du sur place. Ce qui provoque chez lui la remontée de vieilles inquiétudes, une nouvelle perte de confiance, et une nouvelle baisse de moral. Sa motivation vis-à-vis de son protocole de rééducation faiblit à nouveau.
Je sais que Jérém fait aussi face à un autre gros sujet d’inquiétude, celui concernant le renouvellement de son contrat pour la saison à venir. L’actuel se termine à la fin du mois, et personne ne l’a contacté pour lui proposer une rallonge. Il semblerait que la direction de l’équipe attende de voir la progression de sa rééducation pour prendre une décision. En gros, si le jouet Tommasi est irréparable, ils vont le laisser sur le bord de la route comme une épave. L’agent de Jérém est aux abonnés absents, ce qui ne fait qu’amplifier toute cette incertitude, toute cette inquiétude.
Mon beau brun se fait à nouveau plus taciturne. Mais ses accès de colère ne reviennent pas pour autant. Malgré son air soucieux, il se montre toujours aussi respectueux et reconnaissant vis-à-vis de moi.
Son découragement, il l’intériorise. Et ce n’est pas mieux. A la limite, je préférerais qu’il passe ses nerfs sur moi un bon coup, qu’il le regrette juste après, qu’il culpabilise, et que ça le fasse rebondir !
Je le pousse à tenir bon, à continuer à aller aux séances de kiné et aux exercices. Je le pousse à être patient, à ne pas baisser les bras. Mais son abattement est coriace.
Alors, je cherche à le faire réagir, par tous les moyens, y compris la provocation.
— Je trouve que tu baisses les bras trop facilement. Montre-moi que tu as des couilles !
— Avec tout ce que je te mets, tu es bien placé pour savoir que j’en ai !
— Oui, tu as des couilles pour me sauter, ça c’est sûr ! Mais est-ce que tu as des couilles pour tenir le coup ? Est-ce que tu as des couilles pour continuer à poursuivre tes rêves, même si c’est dur et que tu ne vois pas encore le bout du tunnel ?
Puisque la fin semble justifier les moyens, rien ne m’arrête, pas même le chantage affectif.
— Montre-moi que tu as envie de te battre, montre-moi que je n’ai pas passé les trois derniers mois avec toi pour rien !
Avant, j’aurais pris sur moi, car j’aurais eu peur de me faire jeter (Casse-toi !), ou de me faire lancer des mots blessants à la figure (Je ne t’ai jamais demandé de rester avec moi !).
Au fond, ce risque existe toujours. Mais c’est devenu un risque calculé. Je sens que j’ai désormais une cote, une confiance, une estime auprès de Jérém qui me permettent de lui parler franchement sans craindre de me faire jeter comme un malpropre. Jérém sait que j’ai raison, il prend sur lui et il maîtrise sa colère. Ce qui ne l’empêche pas d’exploser par moments :
— Tu fais chier !
Quand rien d’autre ne marche, j’ai aussi appris à le travailler au chantage sexuel. Un jour, excédé par son manque de motivation, je lui balance :
— Si tu ne vas plus chez le kiné, je te suce plus !
— Tu ne tiendrais pas deux jours ! relance le petit con.
Ça, c’est vrai, il a parfaitement raison. Mais je ne m’avoue pas vaincu pour autant.
— J’ai bien tenu six mois, c’est pas quelques jours de plus qui vont me faire vaciller ! je bluffe.
— T’es vraiment qu’une salope ! il me balance, mi agacé, mi amusé.
— Allez, file à ta séance, sale gosse ! Et si tu es sage, quand tu reviens, je te lèche tout ce que tu veux, autant que tu veux !
Ce jour-là, Jérém est parti à ses séances. Ce soir-là, je l’ai fait jouir comme un malade.
Lundi 11 août 2003.
Au vu de l’avancement de la rééducation de Jérém et de sa récupération physique, mon beau brun est autorisé à quitter le Centre pendant deux semaines pour prendre des vacances et se changer les idées.
Je suis tellement content que la récupération physique de mon beau brun avance bien, qu’il remarche enfin sans béquilles. Certes, il a gardé de ses accidents, une légère boiterie. Mais j’ai l’impression que c’est surtout psychologique, comme une façon de se protéger contre la crainte de refaire des dégâts, de cette peur qu’il n’arrive pas à se sortir de la tête.
J’ai bon espoir que ces quelques jours de vacances vont lui faire du bien.
Nous partons de Capbreton le lundi matin, moi au volant de sa belle allemande, Jérém à la place passager.
C’est marrant cette inversion des rôles. A l’époque de nos révisions, j’étais monté quelques fois en voiture avec Jérém. Je me souviens avec émotion et un certain émoustillement de certains retours de boîte de nuit dans sa 205 rouge, direction l’appart de la rue de la Colombette. A l’époque, je n’avais pas encore le permis. Jérém était au volant, et moi à la place passager.
Il fumait en conduisant. C’était dangereux certes, mais terriblement sexy. Le regarder conduire m’impressionnait. Inconsciemment, je trouvais que cette image de Jérém tenant le volant de sa voiture et contrôlant la direction de sa voiture était une analogie de ce qui m’attendait une fois arrivé à destination, le bonheur de lui laisser au pieu aussi le contrôle de la direction à suivre, de le laisser imposer ses envies, de me faire baiser jusqu’à ce que sa queue lui en tombe. Alors, oui, le regarder conduire m’excitait énormément.
La 205 rouge sera à tout jamais associée dans mon esprit à ces premières révisions, à ces nuits, à ces retours de boîte de nuit, à ce sexe animal avec un Jérém dominant et macho qui me faisait jouir à m’en rendre dingue, mais qui me refusait toute forme de tendresse.
D’ailleurs, je crois bien que c’est un peu dans sa nature de se comporter en mâle dominateur, d’être fier de sa queue et du plaisir qu’elle peut lui offrir, et offrir à ses partenaires. Hier soir encore, après avoir bu quelques bières, il m’a bien fait comprendre qui était le mec dans notre pieu. Et c’est lorsqu’il se lâche, notamment après un peu d’alcool ou un joint, lorsqu’il montre cette nature, ce côté un brin animal qu’il me rend complètement dingue.
Et après de délicieux jeux sexuels, je redouble désormais mes effusions de tendresse. Des effusions qu’il reçoit avec bonheur et qui arrivent parfois même à remplacer la cigarette dont auparavant il ne pouvait en aucun cas se passer après nos ébats.
Je suis tellement heureux d’avoir réussi à mettre en phase le Jérém amant fougueux et le Jérém sensible, tendre et attentionné.
— Je m’habitue bien à avoir un chauffeur, je l’entends me glisser, me tirant ainsi de mes cogitations.
— Je veux être ton chauffeur toute ma vie, tu m’embauches ?
— Avec plaisir !
— Je serais ton chauffeur et tu me paierais en nature… tu me donnerais autant de primes que tu voudrais !
— Petit coquin, va !
— Plus que ça !
— T’es une bonne salope, toi !
— Et comment !
La première étape de notre summer trip est la Ville Rose. Quand je leur ai annoncé que je partais quelques jours en vacances avec Jérém, Papa et Maman ont insisté pour que nous passions à la maison.
— T’es sûr que ce n’est pas une embuscade ? plaisante Jérém. Ton père ne va pas profiter du fait que je ne peux pas courir vite pour m’attraper et me casser la figure ?
— Désormais, mon père te vénère. Tu es son joueur préféré. Et aussi son beau-fils préféré.
— Il n’a pas le choix, je suis le seul !
— Oui, mais il t’adore. Et depuis ton accident, il prend régulièrement de tes nouvelles.
A la maison, Jérém est reçu non seulement comme un roi, mais surtout comme un membre de la famille. Papa se montre très aimable, et plein d’affection. Il se renseigne sur l’avancement de sa rééducation, et sur son moral. Il ne le lâche pas d’une semelle et il ne tarit pas de compliments au sujet de son début de saison qu’il qualifie de « brillant » et « spectaculaire ».
— J’ai hâte de te revoir sur le terrain. Tu as une belle carrière devant toi ! Le Stade doit être heureux de tes progrès à Capbreton !
— En fait, je n’en sais rien. Mon contrat arrive à échéance fin août, et c’est toujours silence radio…
— Ton contrat sera renouvelé, tu verras. Ils ne vont pas laisser filer un joueur comme toi.
— Je ne me fais pas trop d’illusions. Ils ont des piles de CV de bons joueurs prêts à être embauchés, et qui n’ont pas un genou et une cheville rafistolés…
— Certainement. Mais dans ces CV, les joueurs comme toi il n’y en a pas des masses. Tu as un don, tu es fait pour ça. Tu as le rugby dans le ventre. Beaucoup de mecs savent jouer au rugby. Mais peu d’entre eux savent jouer comme des champions. Et toi, tu joues comme un champion.
Jérém est visiblement touché par l’estime, le soutien, la bienveillance, la confiance en sa récupération que Papa vient de lui témoigner.
Nous passons à table, et Maman est au petit soin pour tout le monde, et en particulier pour Jérém. Elle a mis les petits plats dans les grands et nous a concocté un repas de fête. Dans mon cœur réchauffé par tant d’amour, une évidence s’affiche : Papa, Maman, je vous aime comme un fou !
Puisque nous passons la nuit à Toulouse, à la maison (bien évidemment, nous n’avons pas pu refuser), une bonne soirée entre mecs s’impose. Thibault, Thierry, Thomas, Maxime sont de la partie, ainsi que d’autres gars de l’ancienne équipe amateur de Toulouse.
La soirée démarre au restaurant. Et au bout de quelques verres, c’est ambiance troisième mi-temps. Les joyeux lurons installent une belle complicité virile rythmée par de bonnes tranches de franche rigolade. C’est beau de voir des garçons qui prennent du bon temps.
Jérém est évidemment la vedette de la soirée, et les questions fusent au sujet de ses premiers mois au « Stade Parigot », comme ils le surnomment, ainsi qu’au sujet de sa récupération.
Mon bobrun se fait évidemment tanner avec cette histoire de pouffiasse dans les journaux. Chacun y va de sa vanne : « Même à Paris, il fallait que tu te fasses remarquer », « Tu as raison, montre-leur qu’à Toulouse on en a des grosses », « Ta bite à tête chercheuse a encore frappé », et j’en passe et des meilleures.
Bon, allez, je ne dis rien, je les laisse fantasmer. Je trouve très marrant ce décalage entre l’illusion qu’on prend pour la réalité et la réalité cachée derrière l’illusion. D’autant plus que le sourire en biais que Jérém me lance, un sourire amusé et un tantinet malicieux, me fait comprendre qu’il se dit la même chose.
La soirée se poursuit ensuite dans ce temple de la vie nocturne hétérosexuelle toulousaine qu’est la Bodega. La Bodega, dont les toilettes ont été le théâtre d’une bonne pipe dispensée à mon bobrun. C’était il y a deux ans déjà, pendant la soirée qui fêtait la fin du bac. Tous nos camarades étaient là en train de faire la fête, et moi j’offrais à mon beau brun son premier orgasme de la soirée. Le premier, car il n’avait absolument pas été le dernier. Ce soir-là, un retour de boîte de nuit en 205 et un passage par l’appart de la rue de la Colombette m’attendaient…
Jérém et ses potes font quelques parties au billard. Je suis également invité à jouer. Ça me fait énormément plaisir, car jamais on ne m’avait invité à jouer au billard. Un seul hic, je ne sais pas jouer. Mais cela est vite rattrapé par la bienveillance de Thibault et de Jérém qui me montrent les rudiments du jeu avec une patience et une pédagogie qui me touchent énormément. Chance du débutant assurément, j’arrive même à marquer quelques points. Mon équipe, celle que je forme avec Thibault, finit même par gagner face à celle de Jérém et Thierry, même s’il est évident que les points marqués par mon coéquipier d’un soir ont été clairement déterminants.
Au bout de quelques parties, deux de nos acolytes quittent le groupe pour aller discuter avec d’autres gars. Jérém est reconnu par un mec et très vite entouré par une petite foule. Le groupe se disperse.
Les bières commencent à faire de l’effet, et je dois partir aux chiottes. Ces dernières étant désertes, je fais mon affaire à l’urinoir. C’est lorsque je me poste devant le lavabo pour me laver les mains que la porte battante qui donne accès aux toilettes s’ouvre d’un coup bien énergique, et que mon beau brun apparaît.
— Viens ! il me lance, alors qu’il se dirige tout droit vers une cabine.
Ah putain ! Ça fait toute la soirée que le souvenir de cette soirée passé me hante. Ça m’excite et me fait bander. Mais je me disais que, si ça se trouve, Jérém ne s’en souviendrait même pas. Et pourtant, si ! Je me disais que jamais il n’oserait ! Et pourtant, si !
J’ai tellement envie de lui offrir le premier orgasme de sa soirée, comme il y a deux ans ! Mais cette fois-ci, à ma grande surprise, c’est lui qui se met à genoux en premier devant moi. Il me suce, avec un entrain et une fougue qui m’excitent au plus haut point. Je sens très vite mon plaisir monter, et l’orgasme approcher. Je pose mes mains sur ses épaules, je me retire de sa bouche.
Un instant plus tard, Jérém est debout, et il défait sa braguette. Je suis déjà à genoux, et je baisse son boxer. Je prends en bouche sa queue tendue et je le pompe avec un bonheur immense.
Comme la dernière fois, des gars viennent pisser dans les urinoirs à côté. Dans un souci de discrétion, je ralentis mes va-et-vient sur sa queue, jusqu’à presque les arrêter. Mais le bobrun n’est pas de cet avis. Il pose sa main sur ma nuque et il imprime le mouvement qu’il exige de moi. Cela m’excite terriblement. Je recommence à le pomper avec une énergie de dingue. Mais je n’ai pas besoin d’aller bien loin. Ses giclées chaudes et puissantes atterrissent dans ma bouche, son goût de jeune mâle tapisse ma bouche, et ravit mes sens comme une petite ivresse.
Jérém vient en moi, et me branle pour me faire jouir. Et avant de se retirer, il attrape mon menton, il retourne ma tête contre lui et m’embrasse avec une fougue qui me touche énormément.
Cette nuit-là, nous dormons à la maison. La fatigue se fait sentir et nous ne recommençons rien de sexuel. Nous nous contentons d’un peu de tendresse, du bonheur de s’endormir dans les bras l’un de l’autre.
Mardi 12 août 2003.
Papa et Maman voudraient que nous restions un jour de plus, mais nous ne pouvons pas. Les vacances de Jérém sont limitées, et le programme qu’il a prévu est très chargé. Très beau, mais très chargé. Les étapes sont nombreuses, nous allons passer une frontière, et nous éloigner de Toulouse de plus de 1500 bornes.
La prochaine étape de notre trip, c’est la mer. Le soleil nous accompagne sur l’autoroute vers l’Aude.
Je n’arrive pas encore à croire que nous en sommes enfin là, que je conduis la voiture de Jérém et que nous allons passer deux semaines ensemble. C’est la première fois que nous passons autant de temps rien que tous les deux. Ce sont nos premières vacances, en dehors des escapades magiques à Campan, nos premières vacances en amoureux.
Je mesure la distance parcourue entre nos premières « révisions », cette période où Jérém s’entêtait à me voir comme un défouloir de ses envies sexuelles refoulées, et cet instant où, après nous être séparés, après avoir passé tant de mois difficiles, nous partons en vacances ensemble. Et ça me donne le vertige.
Jamais mon Jérém ne m’a autant touché. Ce garçon a ravi mon cœur et m’apporte un bonheur immense. J’ai besoin de le toucher pour être sûr que cela n’est pas un rêve. Je pose ma main sur sa cuisse, il tourne aussitôt la tête vers moi, il me regarde. Et il me sourit. Puis, il se penche vers moi et il pose un bisou dans mon cou. J’ai envie de pleurer de bonheur.
Dès la sortie d’autoroute, un Concerto en C majeur nous attend. « C », comme cigales. Un concert à la fois monophonique et symphonique, une boucle répétée à l’infini pour souhaiter la bienvenue aux vacanciers dans cette région de vacances. Un Concerto pour nous annoncer qu’on y est presque, que la mer est proche, et que dans quelques minutes les pieds toucheront le sable et l’eau salée.
Je retrouve avec émotion les étangs de Gruissan, le massif de la Clape, ce paysage sauvage composé de forêts de pins méditerranéens, de garrigue, de roche affleurante, de vigne, de soleil. Et de cigales. Je suis comme toujours fasciné par ce terroir de caractère, cet environnement sec et caillouteux, difficile pour l’Homme, mais d’une beauté époustouflante.
Tant de souvenirs remontent en moi. Mes étés d’enfance, lorsque je venais à Gruissan avec Elodie et ma marraine, sa maman. Puis, mes étés d’adolescent, lorsqu’Elodie et moi avons commencé à venir seuls. Je me souviens des longues heures sur la plage, glissées entre baignade, bronzette, lectures diverses, discussions avec Elodie sur les sujets les plus divers, et les bonnes tranches de rigolade. Et aussi, évidemment, ces longs moments à laisser mon regard vagabonder à la recherche de la beauté masculine, à regarder les petits mecs sur la plage. Au début, je culpabilisais. Je ressentais un sentiment de honte. Je ne comprenais pas ce qui se réveillait en moi. Puis, j’ai dû me rendre à l’évidence. Regarder les garçons m’apportait un bonheur immense, un émoustillement certain, et une frustration tout aussi immense de ne pas pouvoir, de ne pas savoir les approcher. Tant d’émotions qu’aucune nana ne m’a jamais apportées.
Gruissan a également été le théâtre, les dernières années, de séjours plus difficiles. Jérém était loin, et il me manquait horriblement. D’autant plus que je n’avais aucune garantie de le retrouver à mon retour à Toulouse. Les premiers mois de notre relation ressemblaient à un intérim sexuel à la fois enivrant et terriblement déstabilisant.
Et maintenant, me revoilà, Gruissan ! Je reviens te voir et je suis bien décidé à créer de nouveaux souvenirs sur ta plage, dans tes restaurants, dans tes rues, avec Jérém. Les souvenirs du bonheur d’être avec lui.
La première chose que nous faisons à notre arrivée à la plage, c’est l’application de la protection solaire. J’ai attrapé assez de coups de soleil par le passé, que j’ai retenu la leçon. A ma grande surprise, Jérém me propose de m’en mettre dans le dos, là où il est le plus difficile de le faire par soi-même. Je suis touché par sa proposition, lui qui, il y a peu de temps encore, ne tolérait aucun contact entre nous en public. Le contact un peu abrupt avec la fraîcheur de la crème est vite rattrapé par la chaleur de ses mains, par la douceur virile de son toucher, par la tendresse qu’il sait insuffler dans ses doigts. Dans ce simple contact, j’ai l’impression de sentir toute notre complicité, notre tendresse, notre amour, notre sensualité. Et ça fait un bien fou.
Je lui propose de l’aider à mon tour. Il accepte également. La simple sensation de toucher sa peau me fait bander. J’ai aussitôt envie de lui. Mais en même temps, le fait de rendre service au garçon que j’aime, de lui éviter des coups de soleil, me comble de bonheur. Aussi, j’adore l’idée de caresser les épaules et le dos de Jérém en lui faisant ressentir l’immense tendresse que je ressens pour lui, tout en la cachant à aux regards extérieurs qui pourraient capter cette scène.
Nous nous baignons aussitôt. Et ce, malgré une eau pas vraiment engageante. Mais peu importe, nous avons envie de rencontrer la mer. Jérém disparaît sous l’eau. Et lorsqu’il réapparaît, avec sa peau mate ruisselante, ses cheveux bruns et les poils de son torse plaqués par l’eau, les tétons qui pointent délicieusement à cause de la fraîcheur, un beau sourire sur son visage, il est beau comme un Dieu. Un Dieu qui a l’air si heureux. Le regarder m’emplit de joie.
Nous nous allongeons sur nos serviettes, l’un à côté de l’autre. Sa peau mate perlante d’eau, sa musculature parfaite attirent les rayons du soleil tout autant que les regards des nanas qui passent à proximité. Eeeeeehhhhh, je vous ai à l’œil ! Pas touche, même pas du regard !
C’est une journée parfaite pour la plage. Il n’y a pas de vent, et le soleil n’est pas aussi féroce qu’il peut l’être parfois sur cette plage. Nous passons la matinée et l’après-midi entre le sable et l’eau.
Le soir, nous achetons des pizzas et nous bivouaquons sur la plage. Nous nous approchons d’un petit groupe qui a eu la même idée que nous, qui a aussi allumé un feu, et apporté une guitare en prime. L’un des mecs improvise des grands standards de la musique française, et ses potes, filles et garçons, tentent de le suivre en chantant les paroles. Le tout dans une ambiance bon enfant et pleine de bonne humeur qui fait du bien.
Il est près de deux heures du mat’ lorsque Jérém et moi décidons de rentrer. Ma cousine Elodie a été heureuse de me prêter l’appart à la plage, ce qui nous rend bien service. Je l’adore !
Dans le clic clac où j’ai dormi enfant tout seul, nous faisons l’amour, et nous nous endormons très vite.
Jeudi 14 août 2003.
Après deux jours passés à la plage de Gruissan, nous reprenons la route. C’est une très belle matinée d’été et il fait déjà chaud. Je regarde Jérém assis à côté de moi, affalé dans le siège passager, ses biceps enserrés par les manchettes de son t-shirt blanc, son short en jeans laissant admirer ses beaux mollets délicieusement poilus, ses lunettes noires très stylées. Les rayons du soleil accentuent le contraste entre sa peau mate et la couleur immaculée du coton, redessinent sa musculature, font briller sa chaînette et ses tatouages. Il est tout simplement à craquer J’ai envie de lui à en crever.
Près d’Avignon, nous nous rendons compte que nous n’avons pas pris la bonne direction. Nous n’aurions pas dû monter si haut. Ah, si seulement on avait un GPS ! Car les cartes papier ne savent pas dire « Faites demi-tour dès que possible ».
Peu importe, nous ne sommes pas pressés et Jérém a envie de sortir de l’autoroute pour chercher un vrai resto pour déjeuner. Nous roulons quelques minutes au milieu des vignes en direction d’une petite ville. Jusqu’à ce que nous arrivions à hauteur d’un vignoble avec un beau château.
Et une décharge d’émotions intenses me submerge lorsque je reconnais l’endroit. Je reconnais le nom du domaine, ses abords, ses bâtisses, son chemin d’accès, son somptueux portail en pierre et en bois. Je le reconnais comme si j’y étais allé hier. Je le reconnais parce que cet endroit est indissociable d’un souvenir très marquant au sujet de Jérém, un souvenir de désir brûlant et d’immense frustration.
Ce souvenir remonte à quatre ans. Cette année-là, le voyage de fin d’année de seconde nous avait amené en Italie, à Turin, sur le lac de Garde, à Bergame, à Vérone, à Venise. Un voyage magique, à la découverte d’un pays fascinant. Mais aussi, en grande partie, magique grâce à la présence de Jérém, une présence tout aussi délicieuse que déchirante.
Pendant tout le voyage, le beau brun avait papillonné de nanas en nanas, et ça me déchirait le cœur. D’autant plus qu’il n’avait pas le moindre regard pour moi, comme si je n’existais pas à ses yeux.
Pour la pause déjeuner du dernier jour, nous avions fait une étape gourmande dans un vignoble du Vaucluse. Ce vignoble précisément.
— Tu le reconnais ? je demande à Jérém, en m’arrêtant sur le bas-côté pour prolonger ces retrouvailles.
— Bien sûr que je le reconnais !
— Tu te souviens quand on était partis se balader avec Malik et Nadia ?
— Evidemment !
— J’étais très pote avec Nadia…
— Malik était mon pote.
— Nadia était une grande gueule, et elle a toujours été sympa avec moi. Parfois elle a même pris ma défense quand certains camarades se payaient ma tête.
— Je m’en souviens.
— Parfois, j’ai eu l’impression qu’elle savait que je n’étais pas un mec à nanas, mais elle n’a jamais essayé de savoir. Elle n’a jamais posé de question, ni même fait la moindre allusion. Elle était juste mon amie. De toute façon, je n’étais pas encore prêt pour assumer tout ça. Il m’a fallu plus de temps que toi pour assumer, il admet.
— Ce jour-là, elle voulait se rapprocher de Malik.
— Et Malik avait bien envie de la pécho aussi !
— Je me souviens très bien le moment où ils sont partis tous les deux.
— Ils nous avaient plantés comme deux cons !
— J’étais content de rester un peu seul avec toi. Ça n’arrivait jamais. Mais j’étais tellement stressé ! Je te kiffais à en crever, tu m’impressionnais tellement !
— Je sais, ça se voyait…
— A ce point ?
— A ce point…
— Tu étais tellement sexy, ce jour-là, avec ton t-shirt blanc collé sur sa peau mate et moite de sueur ! Je me souviens que tu avais attrapé le bas de ton t-shirt pour t’essuyer le front. Quand j’ai vu tes abdos, j’ai failli faire un malaise !
Le bobrun sourit, l’air à la fois amusé et flatté.
— J’ai vu à quel point je te faisais de l’effet !
— Et ça te faisait quoi de voir que je te faisais de l’effet ?
— Ça me faisait bander !
— Oh putain, quel gâchis, quand on y pense ! Si on avait su, on aurait pu se trouver un, deux, trois ans plus tôt !
— Tu l’as dit, tu n’étais pas prêt. Et moi encore moins que toi.
— J’avais l’impression que j’étais transparent pour toi, tu faisais comme si je n’existais pas…
— Tu me faisais de l’effet, Nico ! C’est pour cette raison que je faisais semblant de t’ignorer. J’avais peur que ça se voie. Alors, je gardais mes distances.
— Elle est marrante la vie. Cruelle, mais marrante !
— C’est clair ! il admet.
— Je me souviens que tu avais enlevé le t-shirt parce que tu avais chaud, je poursuis. Là, je n’en pouvais plus ! Ta peau était moite de transpiration. En plus, tu avais fumé un joint avec Malik, tu planais, tu étais à craquer !
J’ai toujours en tête cette image de toi, debout devant moi, appuyé dos contre un arbre, torse nu, avec le t-shirt blanc sur l’épaule. Et moi, assis sur le petit rocher, le regard pile à la bonne hauteur pour mater la bosse de ton jeans.
Et tu m’as achevé quand tu as dit que tu avais trop chaud et que tu as défait ta ceinture et les deux premiers boutons de ton jeans. Quand j’ai vu les poils au-dessus de l’élastique de ton boxer j’étais à deux doigts de devenir fou pour de bon….
— J’avais envie de t’allumer et de voir dans quel état ça te mettrait. Je voulais te pousser à m’avouer que tu avais envie de moi. Peut-être que si tu l’avais fait, je t’aurais jeté. Mais j’avais tellement envie que tu me dises que tu avais envie de moi !
— Je regrette de ne pas t’avoir dit ce jour-là à quel point j’avais envie de toi !
— Tu ne me l’as pas dit, mais ton regard l’a crié haut et fort !
— Mon cœur battait la chamade, j’avais le ventre en feu, je poursuis. J’aurais donné une fortune pour avoir la chance de te faire plaisir ! Mais je pensais que tu m’étais inaccessible, et te voir si près et en même temps si loin de moi était une véritable torture. Et pourtant, j’aurais tout donné pour que ce petit moment ne s’arrête jamais ! Parce que je pensais qu’il n’y en aurait pas d’autres. Ça me rendait malade de me dire que je ne t’aurais jamais, que je ne serais même jamais pote avec toi, car je n’existais même pas pour toi.
— Et pourtant, tu existais déjà, et comment !
— Si seulement, j’avais su !
— Ralentis, prends ce chemin, il me commande de but en blanc, en m’indiquant un parcours qui s’engouffre dans les vignes.
Je ne bronche pas, croyant à une envie soudaine de pause pipi.
— Continue encore un peu, il insiste, alors que je m’apprête à m’arrêter à quelques dizaines de mètres de la route.
Je continue de rouler, sans poser de questions.
— Arrête-toi ici, il me lance, à hauteur d’un chêne, lorsque nous avons parcouru assez de distance pour que la route ne soit plus visible.
— Viens ! il me lance, le regard fripon.
Je crois que j’ai enfin compris où il veut en venir. Jérém sort de la voiture et ôte son t-shirt. Aujourd’hui aussi, il porte un t-shirt blanc parfaitement ajusté à son torse, exactement comme ce jour-là. Et comme ce jour-là, il l’enlève d’un geste rapide et très sensuel et le pose sur son épaule. Et comme ce jour-là, il prend appui avec ses épaules contre un arbre, il ouvre sa ceinture et les deux premiers boutons de son short.
C’est la même tenue, la même position, le même paysage. La même promesse de bonheur que je n’ai pas pu concrétiser à l’époque. Et mon Jérém me propose de rattraper ça maintenant. Il ne manque que l’effet du joint. Mais Jérém s’allume une cigarette. Et là, je suis fou. Je suis comme un gosse devant un cadeau qui dépasse de très loin ses attentes.
— Montre-moi ce que tu m’aurais fait ce jour-là ! il me lance entre deux taffes, devant mon éblouissement.
Un instant plus tard, je suis à genoux devant lui. Je finis de défaire sa braguette, je descends son short et son boxer. Je libère sa belle queue magnifiquement tendue. Je la prends en bouche et je la pompe. Cet après-midi, les éléments s’allient pour décupler notre plaisir.
Mon excitation et ma fougue sont démultipliées par le baiser du soleil et par la caresse du vent sur ma peau. Et par cette sensation de liberté, doublée d’un délicieux parfum d’interdit, de risque que seuls savent apporter les ébats en pleine nature. Et puis, il y a les caresses terriblement sensuelles que Jérém n’a de cesse de m’offrir. J’ai l’impression de planer dans un bonheur sensuel inouï.
— Je vais jouir… je l’entends m’annoncer, dans un long soupir. Ahhhh, putain, vas-y, avale, avale tout ! il m’intime un instant plus tard, la voix étranglée par la vague de plaisir qui submerge sa conscience et fait trembler tout son corps.
— Maintenant tu sais, il me glisse à l’oreille, alors que je viens de jouir à mon tour, sa queue enfoncée entre mes fesses.
— Qu’est-ce que je sais ?
— De quoi j’avais envie ce jour-là, il lâche, en se déboîtant de moi.
— Si j’avais su, si tu me l’avais fait comprendre, je t’aurais offert tout ça, ce jour-là !
— J’ai essayé. Tu crois vraiment que ce jour-là j’avais chaud au point d’ouvrir ma braguette devant toi ? Enfin, si j’avais chaud… à la bite !
— Quel petit con, tu fais !
Pour toute réponse, il me lance un sourire des plus charmeurs.
Après une pause resto, nous reprenons la route. Nous passons la frontière à Vintimille vers 18h00. Nous quittons l’autoroute pour chercher une piaule pour la nuit.
Lorsqu’on voyage, lorsqu’on s’éloigne suffisamment de chez soi, on est tôt ou tard frappés par la délicieuse sensation de changer radicalement de décor. Les changements de paysage, de couleurs, de formes, d’architecture, de senteurs, de sons nous impressionnent et nous enchantent. C’est le charme d’un terroir, d’une culture, d’une Histoire.
Parfois, il est suffisant de changer de région, de département ou juste de canton, pour ressentir cela. C’est le cas de mon département, la Haute Garonne. Des grandes plaines du nord, en passant par les collines de Toulouse et du Lauragais, jusqu’aux Pyrénées tout au sud, le dépaysement est flagrant.
Mais cette fascination de la découverte est d’autant plus marquante lorsqu’on change de pays. Car en plus de tout le reste, c’est la langue qui change, une langue dont le premier contact nous vient des panneaux routiers et des enseignes des magasins. La langue et la toponymie contribuent de façon déterminante à la sensation de dépaysement. Se sentir « perdu » dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue peut avoir quelque chose de grisant, en particulier lorsqu’on s’y rend en compagnie de l’être aimé. Les quiproquos engendrés par la barrière de la langue constituent une source intarissable de fous rires, de découvertes à deux, de bonheur.
Je ne parle pas un mot d’italien. Mais mon Jérém, sans vraiment parler la langue de Dante, se démerde quand-même pas mal.
— Por favore, mi puoi dire où trouvare un hotello ? je l’entends demander à un passant.
Si je connaissais l’italien, je saurais que dans sa question pour se faire indiquer un hôtel, il y a une flopée d’erreurs. Mais je ne le sais pas et je suis impressionné. D’autant plus que mon beau brun a l’air de comprendre les indications que lui fournit le type.
— Qu’est-ce qu’il t’a dit ? je le questionne lorsque nous reprenons la route.
— Je crois qu’il m’a dit de continuer par-là…
En gros, il n’a rien compris. Mais je continue « par-là », sans demander plus d’explications, je continue, amusé et excité, tout droit vers cette magnifique aventure. Nous suivons une route sinueuse qui s’éloigne de la mer et qui continue vers la montagne. Au bout de quelques kilomètres, nous tombons sur un village au nom prometteur de Dolceacqua, littéralement « L’eau douce ».
— Ça doit être ici… fait mon bobrun.
Dolceacqua est un village qui se déploie le long d’une rivière surmontée par un petit pont en pierre très ancien. Sur la droite, une grande église domine le village du haut d’une colline. Les couleurs des façades des maisons varient entre le blanc, le jaune, l’orange, le rose. Les toits sont en terre cuite. Le tout donne une impression d’homogénéité, d’harmonie, comme si tout le village avait été construit à la même époque et que le temps s’était arrêté juste après.
Nous faisons un tour à pied, et nous trouvons une petite pension bien charmante. Notre hôtesse est une femme d’une cinquantaine d’année, avec des formes généreuses et l’air d’être une bonne vivante. Elle parle fort, mais sa voix est douce. Elle parle un peu le français, mais elle laisse souvent glisser des mots d’italien dans la conversation.
— Vous voulez mangiare questa soirée, ragazzi miei ? elle nous interroge.
C’est la première fois que je me fais traiter de « ragazzo ». Je trouve que ça sonne bien.
Jérém et moi avons tous deux envie de découvrir la cuisine maison, alors nous acceptons volontiers. Nous n’allons pas le regretter. Elle nous prépare des « orecchiette al ragù », et c’est un délice.
Ce soir-là, dans cette petite chambre au décor suranné mais charmant, au beau milieu de ce petit village mignon comme tout, dans ce pays que nous allons découvrir ensemble et dont la première mise en bouche nous enchante, nous faisons l’amour. C’est bon, tendre, sensuel. Je n’arrête pas de me dire que ça valait vraiment le coup de m’accrocher pendant tous ces mois, et même avant, pendant les hauts et les bas de notre relation pendant deux ans. Ça valait le coup d’attendre pour en arriver là, pour être récompensé par ce bonheur immense.
Vendredi 15 août 2003.
Le lendemain matin, notre hôtesse nous donne des sandwiches et des boissons pour la route, et nous recommande un petit crochet par Apricale avant de continuer notre route. Quelque chose dans son regard me laisse imaginer qu’elle a compris pour Jérém et moi. Mais ça n’a pas l’air de l’offusquer. En tout cas, ça ne lui a pas enlevé son sourire et sa bonhomie.
Apricale est un village dont le nom décrit une destinée. Ou du moins l’intention de ses bâtisseurs. Apricale signifie en effet « exposé au soleil ».
Accrochées sur un flanc de colline exposé plein sud et posées au milieu d’un paysage verdoyant, ses nombreuses maisons semblent collées les unes aux autres, comme des moules sur un rocher, comme des fruits sur un gâteau.
Apricale se découvre en laissant la voiture à ses pieds, et en remontant à son sommet par des ruelles minuscules, escarpées, constituées de pierres polies par les innombrables pas des hommes à travers les siècles. Les passages étroits, tous invitant à l’ascension, la pierre omniprésente, son charme si singulier lui conféreraient presque des allures de Mont Saint Michel.
Oui, la montée est rude. J’ai hâte de tout voir, de découvrir le cœur du village. Mais je m’adapte à l’allure de Jérém pour ne pas le fatiguer. Et surtout pour ne pas le pousser à prendre le moindre risque avec son genou et sa cheville.
Je le laisse passer devant et donner le rythme de la marche. En le regardant par derrière, si tant est qu’il soit possible que j’arrive à décrocher mon regard de son magnifique dos en V, sa boiterie attire mon regard.
— Tu as mal au genou ? je le questionne.
— Non.
— Au pied ?
— Non plus, pourquoi ?
— On dirait que tu n’oses pas poser ton pied.
— Je n’ose pas le poser !
— Tu as peur de quoi ?
— J’ai peur de casser quelque chose !
— Le médecin a dit que tu ne crains plus rien.
— Je sais, mais c’est plus fort que moi. Je n’arrive pas à être serein.
— Tu sais que quand tu vas recommencer à jouer, tu auras besoin de tes deux pieds bien collés au sol…
— S’il le faut, je ne recommencerais jamais à jouer…
— Pourquoi tu dis ça ?
— J’ai peur qu’ils ne renouvellent pas mon contrat !
— Ils le renouvelleront, je lui lance, sur le ton le plus formel dont je suis capable.
Mais il est vrai qu’il y a de quoi s’inquiéter. Si le club a vraiment suspendu le renouvellement du contrat à la récupération de Jérém, maintenant que les résultats sont là, maintenant que les médecins annoncent un possible retour sur le terrain avant la fin de l’année, il devrait se manifester. Et pourtant, ce n’est pas le cas. Le contrat arrive à échéance le 31 août, soit dans deux semaines et aucune nouvelle ne filtre de la part de la direction. Personne n’appelle et personne ne peut renseigner Jérém. Même pas son agent, qui est toujours aux abonnés absents. Voilà l’unique bémol dans la parfaite symphonie que sont nos vacances en Italie.
La place d’Apricale est petite mais magnifique, entourée de bâtisses imposantes et harmonieuses, dont l’église et l’hôtel de ville. Sur un côté fermé par une rambarde, elle s’ouvre sur la vallée. Le paysage est époustouflant.
A l’opposé, se trouve un bar avec des tables en terrasse. Nous nous asseyons et Jérém commande un cappuccino et un croissant. Je fais de même. Quelques minutes plus tard, une vérité fondamentale me saute aux yeux. Il faut être en France pour acheter un bon croissant. Mais il faut l’amener en Italie pour l’accompagner d’un bon cappuccino.
Dans l’après-midi, nous faisons escale aux Cinque Terre. Encore un lieu à la beauté singulière et ravageuse. Il s’agit de cinq villages l’un à la suite de l’autre, accrochés à la montagne et surplombant la mer. Les vagues s’écrasant sur les rochers laissent apparaître les bleus turquoise des profondeurs.
Là encore, la palette chromatique de l’œuvre de l’Homme (le blanc, le jaune, l’orange, le rouge, le rose, le violet des façades, le vert et le bleu des volets) se combine à merveille avec les tonalités de la nature (le turquoise de la mer, le blanc de la roche, les nuances de la végétation) et crée ce feu d’artifice de couleurs dont l’Italie semble détenir le secret.
Cinque Terre est un endroit féerique. Nous déjeunons à Monterosso sur une terrasse de restaurant avec vue plongeante sur la mer. Le soir, nous faisons la randonnée qui longe la côte des cinq villages. La vue est à couper le souffle.
Nous n’avons toujours pas de réservation, mais nous n’avons aucun mal à trouver une petite pension tout aussi agréable que celle de Dolceacqua.
Samedi 16 août 2003.
Sur conseil de notre hôte, ce matin nous prenons le bateau pour découvrir un autre regard sur ce site exceptionnel. Depuis la corniche, le spectacle offert par la mer est grandiose. Depuis la mer, le spectacle offert par les villages aux mille couleurs accrochés à la montagne est époustouflant.
En quittant la Liguria pour rentrer en Toscana, nous tombons sur une station radio qui ne passe que des grands classiques de la variété italienne. « Latte Miele, 88.3 » indique l’affichage du poste.
La chanson qui accroche mon oreille en premier est « Il cielo in una stanza » de Gino Paoli.
Quando sei qui con me/Quand tu es ici avec moi
Questa stanza non ha più pareti/Cette chambre n'a plus de murs
Ma alberi, alberi infiniti/Mais des arbres, des arbres infinis.
Quando sei qui vicino a me/Quand tu es ici à côté de moi
Questo soffitto viola/Ce plafond violet
No, non esiste più.../Non, il n'existe plus ...
Io vedo il cielo sopra noi/Je vois le ciel au-dessus de nous.
Ça résume tellement bien ce que je ressens pendant ce voyage aux côtés de Jérém. Mon présent ne m’est jamais apparu si heureux, et mon avenir ne m’a jamais semblé plus radieux.
Et ça enchaîne avec « Nel blu dipinto di blu » de Domenico Modugno.
Lattemiele, « du lait et du miel », cette radio porte si bien son nom. Car ses ondes semblent décrire une certaine idée de la « dolce vita ». Cette radio devient la bande son de notre escapade au « bel paese ».
Je repense au voyage en Italie que Maman et Papa ont fait pour leur lune de miel et dont Maman m’a souvent parlé comme de l’un des moments les plus heureux de sa vie. Le fait que l’Italie soit un pays bourré de charme doit certainement tenir un rôle dans le souvenir ému qu’elle en garde 25 ans plus tard. Et pourtant, je pense que c’est surtout le fait d’avoir accompli ce voyage à côté de l’homme qu’elle aimait, mon papa, qui rend son souvenir de l’Italie si précieux à ses yeux.
Je suis conscient que je suis moi aussi en train de vivre l’un des moments les plus heureux de ma vie, si ce n’est le plus heureux. Moi aussi je me sens comme dans ma lune de miel. Alors, je savoure chaque paysage, chaque ville, chaque rue, chaque kilomètre, chaque bouchée de pâtes, chaque mot, chaque sourire, chaque chanson qui passe à la radio, chaque nuit passée à faire l’amour. Oui, je savoure chaque instant avec un émerveillement et un bonheur qui ne cessent de se renouveler.
Firenze.
Firenze et typiquement le genre de ville qui en impose un max. Un endroit qui semble t’accueillir en te disant : Ferme ta gueule et admire.
Il faut dire que lorsque tu te retrouves sur la piazza del Duomo, devant la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, cet imposant édifice tout habillé en marbre blanc aux finitions roses et vertes, un édifice qui peut se vanter de posséder une coupole créee par Brunelleschi, véritable prouesse technologique pour l’époque, en plus d’un clocher réalisé par Giotto, excusez-moi du peu, sans compter ce bijou architectural qu’est le Battistero di San Giovanni situé au milieu de la place, là oui, ça donne définitivement envie de fermer sa gueule et d’admirer. Du haut de mes vingt ans, confronté à la grandeur de ces beautés architecturales âgées de sept siècles, je me sens vraiment, vraiment tout petit.
Jérém a l’air tout aussi impressionné que moi.
Et nous ne sommes pas moins impressionnés lorsque nous pénétrons dans cet espace à l’allure solennelle qu’est la Piazza della Signoria.Déjà, la silhouette du Palazzo Vecchio et de sa tour imposante suffirait à en mettre plein la vue. Mais c’est sans compter sur la présence des statues géantes qui ornent les quatre coins de cet espace grandiose. Et parmi elles, l’une des vedettes incontestées de la sculpture de tous les temps, j’ai nommé le David de Michel-Ange, avec ses cheveux bouclés, son corps musclé mais un brin trop petit par rapport à la tête, son air sévère et sa teub à l'air. Je sais que ce n’est qu’une copie, mais ça m’impressionne quand-même. Et pas qu’un peu.
Je me dis que depuis sa réalisation il y a un petit demi millénaire, cette statue du David incarne la quintessence de la beauté masculine. Michel-Ange, qui savait très bien de quoi il retournait, a su lui insuffler des proportions parfaites, un canon esthétique qui n’a guère évolué en cinq siècles. Quand je pense que vingt générations d’hommes et femmes ont contemplé et apprécié sa plastique parfaite, ça me donne le tournis.
En dépit de ses origines, Jérém non plus ne connaît pas grand-chose au « bel paese », à part Napoli et ses alentours, où il a de la famille qu’il est allé voir quelques fois pendant son enfance.
Alors, nous sommes tous deux avides de découverte. Nous visitons tout ce qui est visitable, nous goûtons tout ce qui est goûtable. Il est impossible de passer par Firenze sans goûter la « bistecca fiorentina », ou le « Lambrusco », un vin léger et pétillant qui ressemble à un Beaujolais qui serait agréable à boire, ou encore le « tiramisù », ou bien le vin « Chianti », le vin le plus emblématique de la terre de Toscane.
L’Italia est le pays des pâtes et chaque région a les siennes, sèches ou fraîches, aux mille formes, aux mille assaisonnements. Les plus typiques de la région de Firenze sont les Parpadelle (de larges bandes de pâtes, un peu comme des « tagliatelle » mais en beaucoup plus large) et les Pici (sorte de gros spaghetti, un peu comme les Bucatini mais sans trou au milieu).
Oui, nous goûtons tout. Y compris un mets particulièrement délicieux qui se décline lui aussi en une infinité de nuances suivant les régions et les rencontres : je veux bien entendu parler des « ragazzi ».
Le soir, alors que nous nous baladons sur les quais le long de l’Arno, nous croisons un gars qui vient dans le sens opposé par rapport à nous. Il est grand, brun, il est beau et plutôt bien sapé, jeans, chemise blanche et veste bleu. Et il nous regarde. Je suis sûr qu’il nous regarde. Plus il approche, plus il nous regarde. Il doit avoir 25 ou 27 ans, et il est vraiment très sexy. Je finis par me rendre compte qu’il regarde surtout Jérém. Rien d’étonnant, vu sa belle gueule et son panache.
Pendant un instant, je commence à croire qu’il va carrément venir nous aborder. Mais nous continuons d’avancer en sens contraire jusqu’à ce que nous nous passions à côté sans nous rencontrer. Ou presque.
Au moment de nous croiser, il m’a semblé que le gars avait fait exprès de dévier un peu sa trajectoire pour effleurer le bras de Jérém.
Surpris, ce dernier se retourne aussitôt. Je me retourne aussi. Le gars se retourne aussi, il ralentit son allure jusqu’à s’arrêter à une vingtaine de mètres de nous. Il s’appuie à la rambarde de la promenade et s’allume une cigarette. Le tout, sans jamais vraiment nous quitter du regard. On dirait qu’il attend.
— Qu’est-ce que tu en dis ? me glisse Jérém.
— Je ne sais pas trop…
— Il est beau, non ?
— C’est sûr…
— Ça te dit ou pas ?
Je ne sais pas quoi dire, j’hésite. C’est tentant, certes.
— Si ça te dit pas, je m’en fous. On rentre et je te baise. Mais si ça te dit, ça peut être marrant…
— Je pense en effet que ça peut être marrant. Mais il faudrait des capotes…
— Je crois qu’il m’en reste, et du gel aussi.
Oui, Jérém a eu une vie sexuelle pendant notre séparation. Je le sais. Mais je ne peux m’empêcher de ressentir un pincement au cœur en ayant la confirmation de cette façon, à ce moment précis. Mais au fond, je suis content qu’il ait pris toutes ses précautions.
Jérém lui fait signe d’approcher.
— Ciao belli, nous lance le type.
— Ciao, fait Jérém.
— Io sono Giovanni, il se présente.
— Io sono Jérémie, et lui est Nicolas, fait mon beau brun.
— Francesi ? demande Giovanni, l’œil pétillant.
— Si, francesi.
L’œil pétillant est alors embrasé par une belle étincelle lubrique.
Une minute plus tard, Giovanni nous suit pour rentrer avec nous. A l’hôtel, il nous suce tous les deux. Puis, il se fait baiser par Jérém.
— Dai, scopami bene, fighetto francese ! (Allez, baise-moi bien, le bogoss français !) il soupire, alors qu’il se fait bien tringler par le beau rugbyman.
Après s’être fait démonter par mon bobrun, Giovanni ne demande pas mieux que je lui offre le même plaisir. Je m’applique à faire de mon mieux, car il est toujours délicat de passer après un champion.
Mais il « ragazzo fiorentino » semble bien apprécier mes coups de reins aussi. La puissance de mon orgasme est décuplée par le contact du torse de Jérém dans mon dos, par les caresses dispensées par ses mains délicieusement adroites.
Giovanni prend congé de nous juste après s’être fait doublement sauter, tout en nous remerciant de lui avoir procuré autant de plaisir.
— French boys do it better, il nous glisse en partant.
Dans ma tête, je me dis que ce n’est pas exactement ce qu’affirmait Madonna sur un t-shirt qui a fait sensation à son époque. Mais bon, toute opinion en la matière est subjective.
Après une bonne cigarette, Jérém vient en moi et commence à me tringler. Mais pas du tout de la même façon où il avait tringlé notre amant d’un soir.
Avec Giovanni, il s’est bien éclaté, il a pris son pied, ça a dû faire du bien à son égo d’inscrire un autre beau mec à son tableau de chasse. Son attitude était dominante, un tantinet macho. Tout ce qu’on demande pour une bonne baise. Giovanni avait envie de se faire baiser, et Jérém l’a bien baisé. Ma présence a contribué à lui apporter du plaisir. Je suis certain que ça l’a excité de me voir me branler pendant qu’il baisait ce type, tout comme je le suis que ça l’a bien chauffé de me voir en train de le baiser à mon tour. Mais ça s’arrête là. Il n’y a eu aucune tendresse, aucune complicité avec ce gars.
Et maintenant, alors qu’il coulisse lentement en moi, que son torse effleure le mien, que ses mains me saisissent fermement, que ses lèvres m’offrent d’infinis frissons, et que son regard recherche en permanence le mien, là il est bel et bien en train de me faire l’amour.
 15 commentaires
15 commentaires
-
Par fab75du31 le 11 Octobre 2022 à 06:47
Alors que la rééducation de Jérém entrait dans une phase prometteuse, un nouvel accident est venu ternir l’horizon de mon beau brun. Le tendon d’Achille a lâché de nouveau. Et une nouvelle opération s’avère nécessaire. Mais Jérém n’y croit plus.
— Je ne me ferai pas charcuter à nouveau ! il rugit.
— Et tu vas faire comment pour récupérer ?
— Le rugby c’est fini pour moi. De toute façon, je l’ai su au moment même où le mec m’a percuté pendant le match.
Le voir pleurer me fait un mal de chien. Je tente de lui faire sentir ma proximité et mon empathie en le prenant dans mes bras. Mais le rejet que je redoutais tant finit par tomber.
— Putain, mais lâche-moi ! Casse-toi, Nico, casse-toi ! Casse-toi et fiche-moi la paix pour de bon !
Malgré ses mots durs et blessants, je décide une fois de plus de prendre sur moi et de tenir bon. Je m’accroche. L’enjeu est trop important pour faiblir maintenant.
Il faut trouver un moyen de le convaincre de se faire réopérer par un chirurgien qui veuille bien le réopérer. Il faut à tout prix que je trouve une issue à ce problème. Ça ne peux pas se terminer comme ça !
Mais j’ai beau réfléchir, je me sens dans une impasse. Je sais que chaque minute qui passe amenuise un peu plus l’espoir de réussite d’une nouvelle intervention. Je me sens emporté par une véritable course contre la montre, et j’ai du mal à réfléchir. Dans la salle commune du Centre, j’étouffe. J’ai l’impression de vivre un cauchemar. Je me sens horriblement impuissant face à la malchance qui vient encore de frapper le garçon que j’aime.
J’ai l’impression de devenir fou. Je ne peux plus rester à attendre assis sans rien faire. Je me lève d’un bond, je sors du Centre. Je vais me balader sur la plage, sans but, emporté par une force qui me dépasse. Le jour décline, et le soir approche en amenant avec lui toutes les angoisses dont il a le secret. Le vrombissement des vagues accompagne mes pas et mes pensées.
Je marche longtemps, je marche loin. Je marche avec l’océan à ma gauche, je marche en direction de Bordeaux. Comme si ma vie d’étudiant m’appelait, loin d’ici, de toute cette souffrance. J’ai envie de revoir Albert et Daniel, Monica, Raphaël, Cécile, Fabien. J’ai envie de retrouver ma vie d’avant, avec ses hauts et ses bas, mais relativement sereine. Je n’en peux plus de cette inquiétude, de cette violence morale. Je n’en peux plus de voir Jérém souffrir, tirer la gueule, me hurler dessus, me balancer des mots qui me font mal. Je comprends que ce n’est pas lui, je comprends que c’est la peur qui le fait réagir ainsi. Mais c’est dur, très dur.
Et pourtant, je ne peux pas le laisser tomber, je ne peux pas. Il faut que je trouve le moyen de faire en sorte que Jérém accepte d’être opéré. Mais comment m’y prendre ? Comment contrer son refus catégorique ? J’ai l’impression que ma tête va exploser.
Soudain, au milieu de ce désarroi total, un souvenir, une image, un mot remonte à ma conscience et allume une petite lumière d’espoir dans mon horizon totalement bouché.
La silhouette, le visage, les cheveux grisonnants, l’allure, les lunettes, la chemise, le pantalon, la voix, les mots du chirurgien rencontré dans le train entre Toulouse et Paris le lendemain du premier accident de Jérém me reviennent à l’esprit. De ce souvenir, une idée qui me semble à la fois complétement folle et absolument fabuleuse jaillit incontrôlée, en rallumant l’espoir.
Je me suis éloigné du Centre en marchant. Je reviens vers mon appartement en courant comme un fou.
Je dois retrouver sa carte, je dois la retrouver vite. Je ne sais plus où je l’ai rangée, mais je dois la retrouver, à tout prix.
J’arrive à l’appart épuisé, en nage, essoufflé, avec un point de côté douloureux. Mais je ne me pose pas. Je cherche, je cherche, je cherche. Mais je ne la trouve pas. J’ouvre tous les tiroirs et toutes les portes de mon placard, j’inspecte toutes mes poches de pantalon, de veste de mon sac de la fac. Je feuillète tous mes dossiers de notes de cours. Je mets à sac l’appart, mais je ne trouve pas.
Ce n’est qu’au bout de longues minutes, lorsque mon studio semble désormais avoir été traversé par une tornade, que je me souviens que je l’ai tout bonnement rangée dans mon portefeuille.
Te voilà, toi, petite carte, avec le nom de ce chirurgien et celui de la clinique où il bosse. Et au verso, griffonné avec des signes tout juste lisibles, son numéro de portable. Ma joie est immense.
Je repense aux derniers mots qu’il nous avait lancés en se préparant à quitter le train, « vous pouvez m’appeler à n’importe quelle heure ». C’est adorable, mais quand-même, il est déjà 22 heures. Mais le temps presse.
Je compose le numéro du médecin, le cœur vibrant des espoirs les plus fous. Je tombe sur son répondeur. Je lui laisse un message en lui disant que nous nous sommes croisés dans le train Toulouse-Paris un mois plus tôt et que nous avions parlé de l’accident de rugby de Mr Tommasi. Je lui explique que son tendon d’Achille n’a pas tenu, et qu’il a besoin d’une nouvelle opération. Et d’un autre avis.
J’espère qu’il va me rappeler rapidement.
J’appelle le Centre pour avoir des nouvelles. Il n’y en a pas vraiment. L’infirmière que j’arrive à avoir dans le service me confirme que le transfert sur Paris a été commandé pour le lendemain à la première heure, mais que Jérém refuse toujours d’en entendre parler.
Pourvu que le chirurgien de Toulouse me rappelle à temps ! Pourvu que Jérém tienne bon dans son obstination et qu’il ne change pas d’avis ! Je voudrais tant aller le voir, lui parler de mon idée, mais je sais que je risque de me faire jeter à nouveau. Et puis, avant de lui parler de tout ça, je voudrais parler au chirurgien. Je suis anéanti par le fait de ne pas pouvoir être à ses côtés en ce moment si difficile. Il me manque tellement !
Ce soir, je suis dans un état de grande fébrilité. Le CD d’American life résonne en boucle dans mon casque. J’ai du mal à trouver le sommeil. Je ne dors pas beaucoup cette nuit.
Lundi 28 avril 2003, 8h00.
Je suis réveillé depuis plusieurs heures, depuis toute la nuit en fait. A force de compter les minutes, mon impatience est devenue insoutenable. Et la fatigue ne fait que la rendre encore plus insupportable.
Je rappelle le chirurgien à huit heures trente, je tombe encore sur son répondeur. Je commence à me sentir irrité, frustré, je commence à perdre espoir. Je n’ai pas de nouvelles de Jérém, et je ne peux pas aller le voir sans un dossier solide pour lui redonner de l’espoir.
Il est 9h30 lorsque mon téléphone sonne enfin. La sonnerie me fait bondir, le numéro qui s’affiche, avec l’indicatif de Toulouse, met mon cœur en fibrillation.
— Je me rappelle très bien de vous, me lance le chirurgien. Il va comment Mr Tommasi ?
— Pas bien en ce moment. La rééducation commençait à porter des fruits, mais le tendon d’Achille n’a pas tenu.
— La rupture itérative est ce qu’on redoute le plus dans ce genre d’opération. Il suffit d’une imprudence, un peu trop tôt, pour anéantir tout le travail du chirurgien et devoir tout recommencer à zéro. Il faut réopérer au plus vite.
— C’est ce qu’a dit le chirurgien du Centre. Mais il ne veut pas l’opérer car il pense que c’est très risqué, plus risqué que la première fois.
— Toute action est risquée, mais rien n’est impossible. Je vais aller le voir, je vais regarder son imagerie, et je vais me faire ma propre idée.
— Il faut que vous sachiez que Jérém refuse d’entendre parler d’être opéré à nouveau.
— Ouais, c’est ce qu’on va voir. Je m’en occupe. Je pars en fin de matinée et je suis au Centre dans l’après-midi.
— Je vous préviens, il n’est pas facile en ce moment !
— Un sportif blessé est rarement un gars facile. Mais ça fait plus de trente ans que j’en vois, et je commence à savoir comment m’y prendre. Votre ami va entendre ce que j’ai à lui dire. Et je vous promets que je vais lui faire entendre raison.
— Merci Monsieur.
— Avec plaisir, jeune homme.
Les mots du chirurgien et son assurance m’ont beaucoup touché. Sa confiance en la réussite d’une nouvelle opération m’a redonné espoir. Je suis au bord des larmes.
A 15 heures, le chirurgien est au Centre. Son entretien avec Jérém ne dure guère plus qu’une petite demi-heure. Juste le temps de regarder l’imagerie du patient et de donner son avis.
Le mec ne plaisantait pas. C’est pas un rigolo. L’assurance qu’il m’a montrée le matin au téléphone n’était pas en toc. Et ses arguments ont visiblement fait mouche chez le rugbyman blessé.
— Je l’opère demain matin à la première heure. Vous verrez que demain soir il sera un autre homme.
— Je ne sais pas comment vous avez fait pour le convaincre, mais merci, merci infiniment, docteur.
— Avec plaisir, jeune homme.
Le docteur Dupuy s’occupe d’obtenir l’accord de la direction du Stade. Le fax tombe en fin d’après-midi. A 19 heures, une ambulance quitte le Centre en direction de Toulouse avec Jérém à bord. Et moi je la colle au cul, à bord de sa belle allemande. Quand je regarde au fond de moi, je suis heureux. Car ce transfert est une première victoire. C’est le premier pas vers la sortie de toute cette merde.
A 23 heures, l’ambulance se gare devant la clinique toulousaine. Il est tard, je tombe de fatigue. Je n’ai pas le courage d’aller voir Jérém. Il doit être fatigué, et il a besoin de se reposer pour être en forme demain matin.
Qu’est-ce que ça me fait du bien, ce soir, de retrouver ma ville aimée, ma maison douillette, mes parents aimants.
Cette nuit encore, le sommeil est difficile. Mais cette fois, c’est l’espoir qui me tient éveillé.
Mardi 29 avril 2003.
La nouvelle opération de Jérém est programmée pour le matin. Je passe toute la journée à attendre. Heureusement, je ne suis pas seul à attendre. Maxime est là à la première heure. Le petit brun est aussi inquiet que moi, mais du mélange de nos peurs nous tirons un certain soulagement. Nous nous soutenons mutuellement, avec des mots, avec la simple présence de l’autre.
Nous parlons longuement de la chance inouïe d’avoir rencontré ce chirurgien dans le train, et du fait que jai gardé sa carte, ce qu’il n’a pas fait.
— Je suis confiant dans le fait que l’opération va bien se passer, me glisse le petit brun. Ce qui me fait le plus peur, c’est comment Jérém va affronter la convalescence. Ça a été dur la première fois de lui garder la tête hors de l’eau, j’imagine que là ça va être encore pire.
— Je préfère ne pas y penser pour l’instant, j’admets.
— Ça a été dur, hein ?
— Ne m’en parle pas. Je comprends qu’il souffre, mais rester à côté de lui est très dur.
— Si tu veux, je peux prendre le relais.
— Non, ça ira, merci. Je vais aller jusqu’au bout.
— Tu es vraiment un bon gars, Nico.
— Je fais juste ce que je peux pour l’aider.
— Je ne sais pas comment tu as fait…
— J’ai pris sur moi, et j’ai essayé de penser à des jours meilleurs.
— Oui, ça j’imagine bien. Mais je parlais de comment tu t’y es pris pour convaincre Jérém de laisser Maman lui parler.
— Ah, ça… je lui ai juste dit qu’il serait plus heureux en se débarrassant de sa colère.
— En tout cas, ça a été une réussite. Maman en pleurait de joie quand elle m’a appelé pour me l’annoncer.
— Ça me fait plaisir. Jérém était très heureux aussi. Ça lui a fait du bien d’évacuer tout ça de son esprit.
— Jérém t’écoute quand-même, plus que moi. T’as un bel ascendant sur lui, beau-frère !
Beau-frère. Comment ils me font du bien ces deux mots reliés par un tiret. Je n’avais jamais réfléchi à cela, au fait que techniquement Maxime et moi étions beaux-frères. Mais le petit brun y a pensé. Et ça me met du baume au cœur.
L’intervention prend fin vers midi. Maxime arrive à parler au chirurgien dans la foulée. L’intervention s’est très bien passée. Nous sommes tellement soulagés, nous avons besoin de laisser notre joie s’exprimer, nous nous enserrons dans les bras l’un de l’autre, en pleurs.
Maxime et moi passons quelques coups de fil pour annoncer la bonne nouvelle. J’appelle Papa, qui est très soulagé. Puis, j’appelle Thibault. Le jeune pompier vient nous rejoindre en fin d’après-midi. Il est accompagné de Thierry et Thomas, les inséparables de la joyeuse bande du rugby amateur toulousain des années du lycée.
En attendant de pouvoir rendre visite à Jérém, les trois copains se remémorent cette époque, à grands coups de rires, et de nostalgie. Les deux rugbymen amateurs interrogent également Thibault sur sa carrière au Stade.
— Tu es toujours à Toulouse, mais on ne te voit plus, depuis que tu es devenu une star ! lui lance Thierry.
— C’est vrai, c’est vrai. Je suis désolé !
— Il est aussi papa, et pompier volontaire, faut pas oublier ça, fait Thomas. C’est dommage que Nathalie et toi vous soyez séparés. Tu nous as jamais dit ce qui s’était passé…
Il s’est passé qu’il kiffe les mecs ! Cette évidence est si assourdissante dans ma tête que je la retiens de justesse alors qu’elle est à un poil de glisser sur mes lèvres.
— C’est la vie. Les choses arrivent, et parfois on ne peut rien y faire, se contente de lâcher le jeune rugbyman.
— Et tu as le temps de te chercher une poulette ? lui demande Thierry
— Pas vraiment…
— Il doit en avoir un peu partout, des poulettes ! avance Thomas.
Thibault sourit, l’air amusé. Le regard complice qu’il me lance me fait sourire aussi.
— Je crois que Nicolas sait quelque chose que nous ne savons pas ! fait Thierry qui a dû capter notre petite connivence.
— Non, je ne sais rien, rien du tout. Et si j’ai su, j’ai oublié, je m’en sors avec une pirouette.
Il est 19 heures lorsqu’une infirmière vient nous annoncer que les visites sont enfin autorisées. Mais pas plus que trois personnes à la fois. Sans nous concerter, Thibault et moi laissons d’abord Maxime y aller, avec Thierry et Thomas. J’aime autant qu’ils préparent le terrain, qu’ils mettent Jérém dans de bonnes dispositions avec leur humour, leur joie de vivre à la fois enfantine et virile, leur enthousiasme et leur optimisme encore intact, pas abîmé par tant de semaines de négativité. Aussi, Thibault et moi avons besoin de quelques instants pour parler seul à seul.
— Putain, Nico ! Tu as fait un miracle ! Quelle trouvaille que de faire appel à ce chirurgien ! C’est une légende dans le milieu du rugby. Il a réparé tant de mecs qui pensaient être foutus !
— Je ne sais pas ce qu’il a dit à Jérém pour le convaincre, mais ça a été une réussite, je rebondis.
— Il lui a donné quelques-uns des noms de joueurs très connus à qui il a offert des années de carrière après une sale blessure. Et ça, je peux te dire que c’est un argument imparable. Il a même appelé Lucas S., l’un de nos ailiers, un joueur extraordinaire, qui avait eu lui aussi une blessure grave il y a quelques années. Lucas a parlé à Jérém au téléphone et lui a expliqué tout le bien qu’il pensait de ce chirurgien.
— Trop bien !
— Mais sans toi, rien n’aurait été possible.
— Je n’ai rien fait de plus que ce qui s’imposait.
— Certes, mais tu l’as fait. Et tu as renversé une situation qui semblait sans issue. Alors là, je te tire mon chapeau, l’artiste.
La reconnaissance de Thibault, et sa façon de me la montrer, son regard plein de tendresse et d’estime, tout cela me va droit au cœur. Nous nous serrons très fort l’un contre l’autre, pendant un long moment.
— Tiens bon, Nico. Jérém est sensible à tes efforts, à ta présence. Au fond de lui, il sait ce que cela signifie. Tu penses que tu peux encore rester à ses côtés ?
— S’il m’en laisse l’occasion, oui, sans problème.
— Tu vas tenir le coup ?
— Il le faut…
— Et la fac ?
— Je m’en fous de la fac, je n’ai pas la tête à ça. Et même si je rentrais à Bordeaux, je n’arriverais à rien. Parce que mon cœur resterait avec Jérém.
— Tu es adorable Nico, il me glisse, l’air ému, en saisissant ma main entre ses deux grosses paluches bien chaudes, bien rassurantes.
— Tu as tout ce qu’il te faut à Capbreton ? il enchaîne.
— Oui, ça va merci beaucoup à toi.
— S’il te faut une rallonge, n’hésite pas.
— Merci Thibault, j’ai encore de quoi voir venir.
Maxime, Thierry et Thomas reviennent de la chambre de Jérém moins emballés que lorsqu’ils s’y sont rendus.
— Il est à cran… m’annonce le petit brun.
— Il est très fatigué, ajoute Thierry.
— On l’a un peu décrispé, mais il y a du taf encore, admet Thomas.
— Là, vu les circonstances, il faut une séance Thib… se marre Thierry.
— Tu es le seul qu’il a toujours écouté, tu es le seul qui arrivait à le raisonner, abonde Thomas. Même quand il était saoul comme une barrique !
— Il a fait du chemin depuis, c’est pas sûr qu’il m’écoute comme avant…
— On parie ?
J’appréhende un peu ces retrouvailles, mais la présence de Thibault à mes côtés me rassure beaucoup.
Maxime et ses potes avaient raison, Jérém est d’une humeur massacrante.
— Allez, Jé, ne tire pas cette tête, lui lance le jeune pompier. L’intervention s’est très bien passée, pourquoi tu n’essaies pas de te détendre ?
— Parce que je sais tout ce qui m’attend, et je ne sais pas si je vais avoir le courage d’affronter tout ça à nouveau.
— Tu ne vas pas l’affronter seul. Et ça, ça n’a pas de prix.
Jérém pousse un long soupir.
— Nico a encore envie de rester à tes côtés, malgré toutes les misères que tu lui as faites… il lance sur un ton plus léger.
— Mais qu’est-ce que tu es allé raconter ?
— Rien du tout, mais je te connais, Jé. Quand tu vas mal, il faut s’accrocher pour rester ton pote !
— Je n’ai rien demandé !
— Non, mais tu as besoin de tout, si tu veux te remettre sur pattes. Et surtout de Nico. Alors, accepte son aide. Il n’y a pas de honte à se faire aider quand on en a besoin.
— Au point où j’en suis…
— Et ne lui rends pas la vie impossible. Ce qu’il fait pour toi, c’est la plus belle preuve d’amour qu’il puisses te donner.
— Salut champion ! En fait, salut, les champions !
Sur ces mots, qui me vont droit au cœur, Thibault se retire, nous laissant seul à seul. Les quelques instants qui suivent son départ sont plombés par un silence assommant.
— Comment tu te sens ? je ne trouve pas mieux pour essayer de rompre la glace.
— Comme un mec qui s’est encore fait charcuter !
— Je ne vais pas te dire que ça va aller, sinon je vais encore me faire jeter ! je tente de plaisanter.
— Il parait que c’est toi qui as fait venir ce mec… il me lance de but en blanc.
— Quel mec ?
— Le type qui m’a opéré…
— Euh… oui !
— Tu le connais d’où ?
— Je l’ai rencontré dans le train le lendemain de ton premier accident quand je suis monté te voir à Paris avec Maxime.
J’ai l’impression que Jérém a envie de me dire quelque chose, mais j’ai l’impression que ses mots restent bloqués au fond de sa gorge. Les secondes s’égrènent et installent un nouveau silence d’une lourdeur épuisante.
— Je suis content qu’il ait pu te convaincre de sauter le pas.
— Si ça se trouve, je vais être encore plus mal foutu après. Si ça se trouve, je viens de faire une belle connerie !
— La connerie aurait été de ne rien faire. Je te promets que ça va bien se passer.
— Arrête de dire ça, tu n’en sais rien ! Cette opération ne me garantit pas que je rejouerai un jour !
— Tu as raison, je n’en sais rien. Et non, cette opération ne te garantit pas que tu rejoueras au rugby. Mais elle était quand même nécessaire pour pouvoir espérer y arriver un jour.
— Nico…
— Oui, Jérém ?
— Merci. Merci Merci.
Ce sont des petits « mercis », lancés du bout des lèvres, à peine chuchotés. Mais ils signifient tellement pour moi.
Mai 2003.
Oui, l’opération a été un succès. Un franc succès. Tout s’est bien passé, et le chirurgien a l’air très optimiste.
Pas Jérém. Après être retourné au Centre de Capbreton pour le suivi plus rapproché, la nouvelle immobilisation post-opératoire le plonge dans un état de prostration totale. D’autant que cela lui interdit également de progresser dans la rééducation des ligaments croisés de son genou, ce qui n’est pas du tout une bonne chose à ce stade.
Son mauvais état moral s’accompagne d’un mutisme irradiant une hostilité sourde, une agressivité latente et angoissante. Les jours, les semaines qui ont suivi cette deuxième opération ont été durs, éprouvants. J’avais considéré les premiers jours à ses côtés après le départ de Maxime comme les pires moments de ma vie. Je n’imaginais pas que ce triste record allait être allègrement battu un mois plus tard.
Jérém est tendu, à fleur de peau, envahi par une colère bouillonnante et prête à jaillir à chaque instant. Je marche sur des œufs à longueur de temps. Il ne se passe quasiment pas un jour sans qu’il ne me hurle dessus pour un oui ou pour un non, sans qu’il ne me balance de me casser, qu’il n’a pas besoin de moi.
Et pourtant je reste. Je reste parce que je sais que je ne pourrais pas être ailleurs qu’ici, à ses côtés. Ma place est ici.
Dans cette épreuve, je peux compter sur le soutien de ma cousine Elodie. Nous nous appelons deux fois par semaine, et elle sait trouver les mots pour m’apaiser. Elle sait aussi me faire rire. Comme au bon vieux temps, où nous étions tous les deux célibataires, le temps où nous refaisions le monde assis en terrasse dans un bar à Toulouse, ou sur la plage de Gruissan. Je me rends compte que ce temps est révolu, car ma cousine a sa vie, sa petite famille. Et moi aussi j’ai ma vie. Il y a la distance géographique entre nous, et celle, encore plus inéluctable, des obligations personnelles, les circonstances personnelles, les chemins empruntés. Je sens toujours son amour, mais quelque chose a changé. Je me rends compte que notre complicité se situe désormais sur des souvenirs communs, heureux, certes, mais appartenant au passé. Le changement de nos relations avec les autres nous donne la mesure du temps qui glisse sournoisement.
Parfois, il m’arrive de penser à Ruben. Je me demande ce qu’il devient. Je me demande s’il a eu beaucoup de peine suite à notre rupture. Le dernier soir où nous nous sommes vus, il m’a semblé très fort. C’est lui qui a pris les choses en main face à mon hésitation. Je m’en veux de lui avoir fait du mal. J’espère qu’il a rencontré quelqu’un. Parfois, lorsque la solitude, la détresse et la tristesse me happent, je pense au petit Poitevin, et je m’en veux terriblement. Je pense aux bons moments que nous avons passés ensemble, aux balades à vélo, à son sourire, à son regard amoureux, à ses attentions, à son envie de m’installer dans sa vie. Je crois que Ruben m’aimait vraiment, tendrement. J’espère qu’il a rencontré quelqu’un qui le rend heureux. Certains soirs, je pars faire un tour avant d’aller me coucher. Certains soir, j’ai envie de l’appeler. Mais j’y renonce. Je me dis que c’est par altruisme, pour ne pas raviver la blessure de ma trahison. A moins que ce ne soit par lâcheté, pour ne pas être confronté à sa souffrance, dont je suis responsable, pour ne pas ajouter de la détresse à celle que je porte chaque jour.
Malgré le soutien d’Elodie, ainsi que celui de Papa et Maman, de Thib et de Maxime, au bout de quelques semaines mon moral accuse le coup. Je dors mal, je suis de plus en plus fatigué, physiquement et mentalement. J’ai du mal à me montrer positif, car tout élan dans ce sens est balayé par Jérém d’un revers de main. Si j’insiste, je me fais jeter. Il me faut garder le moral, il me faut le garder pour deux. Ou plutôt pour un régiment, tant Jérém s’emploie à le saper.
Un soir, après l’un de ses accès de colère, parti d’une broutille, je craque. Je ne peux retenir mes larmes, je pleure devant lui.
Lorsque je lève les yeux, je réalise que Jérém pleure lui aussi. Je m’approche de lui, je le prends dans mes bras. Son torse est secoué par des sanglots incontrôlables.
— Ne sois pas si méchant avec moi, s’il te plaît ! Je ne te veux que du bien ! Je t’aime, Jérém Tommasi !
— Je sais… je sais. Je suis désolé.
J’ai l’impression que tant de tensions se relâchent enfin, les miennes, les siennes. Je le serre encore plus fort contre moi, nous pleurons ensemble.
— Merci, Nico, merci.
Si je tiens, c’est grâce à ses « merci ». Parfois, sans que je m’y attende, ce petit mot glisse de ses lèvres. Ça tombe lorsque je lui apporte une boisson, lorsque je l’aide à se lever. Et si ces « merci » me touchent autant, c’est parce que je sais que c’est non seulement sa façon de me montrer sa reconnaissance pour tout, pour ma présence avant tout, malgré tout, mais aussi sa façon de s’excuser d’être aussi difficile à vivre, d’avouer son incapacité à faire autrement, sa souffrance et sa peur.
En ce mois de mai, il m’arrive de repenser régulièrement au mois de mai d’il y a deux ans, à cette insouciance, à cette magie sensuelle qu’il y avait entre nous. Il y a deux ans, à cette même époque de l’année, je découvrais le sexe avec Jérém. Tout n’était pas parfait, certes. A l’époque déjà il m’était difficile d’apprivoiser le beau brun. Je me trouvais face à un mur qui refoulait avec violence toute tendresse venant de ma part. Comme aujourd’hui, au fond. Avec la différence qu’à l’époque Jérém n’était pas si malheureux qu’il l’est aujourd’hui.
Il l’était, certes, parce qu’il n’acceptait pas ce qui se dévoilait en lui au fil de nos révisions. Mais il avait des exutoires, comme le rugby, la fête, les potes. Aujourd’hui, immobilisé pendant de longues journées, il s’ennuie, il est frustré, il a du mal à voir le bout du tunnel. Il se sent prisonnier d’un corps abîmé.
Un corps qui, au bout de deux mois d’immobilisation, commence à perdre de sa tonicité. Je n’ai pas souvent l’occasion de le voir torse nu, à part les rares fois où il m’invite à passer clandestinement la nuit avec lui. Mais lorsque cela arrive, j’observe que sa musculature, au repos forcé depuis des semaines, devient peu à peu un brin moins saillante. Jérém a sans doute pris quelques petits kilos. Rien d’alarmant, il reste une sacrée marge avant que cela cesse d’être furieusement attirant.
Au contraire, même. Je dirais même que cet adoucissement des lignes de sa musculature, combiné à sa magnifique pilosité brune laissée libre de son expression naturelle, le rend encore plus sexy. Il existe en effet une sensualité propre aux corps masculins se situant juste un poil en dessous de la pure perfection plastique. La perfection peut parfois intimider. Ce « poil » en dessous de la perfection, cette virilité sans artifices, semble rendre ces corps masculins un brin plus accessibles, et excessivement érotiques.
Et puis il y a le regard, le mien, celui de la tendresse, ce regard qui embrasse bien plus de choses que la beauté et le désir pur.
N’empêche que l’on peut constater la différence entre le Jérém d’il y a six mois, la dernière fois où j’ai fait l’amour avec lui, et le Jérém d’aujourd’hui. Une différence que le principal intéressé n’apprécie guère et qui contribue à lui saper un peu plus le moral.
— Mes abdos s’effacent, il me lance, un soir en revenant de la salle de bain.
— T’exagère, j’aimerais bien avoir des abdos effacés comme les tiens !
— Moi j’aimais bien avoir mes abdos d’avant !
— Je te trouve terriblement sexy comme tu es…
— Moi je ne me trouve pas sexy du tout.
— J’ai tellement envie de te sucer ! je m’entends lui lancer, comme un cri du cœur. Désolé, je me reprends, ça m’a échappé.
— J’ai envie aussi. Mais ça ne marche toujours pas.
— J’ai envie d’essayer…
Un instant plus tard mon nez et ma bouche parcourent son torse, agacent ses tétons, je m’enivre de la nouvelle sensualité de ce corps adouci. Je sens que Jérém est tendu, je le suis aussi. Lorsque j’arrive à proximité de sa queue, après un bon moment de préliminaires, je constate qu’elle est toujours au repos. Je cogite, je m’inquiète. L’enjeu est de taille, au sens propre comme au sens figuré. Je sais que s’il n’arrive pas à bander, ça va encore mettre un coup à son moral, à son égo de mec, que ça va le mettre en pétard, et qu’il ne va plus jamais vouloir recommencer.
J’ai pris un risque en lui proposant de lui offrir du plaisir. J’ai été surpris qu’il accepte, et ça m’a fait un plaisir fou de l’entendre dire qu’il en avait envie. Maintenant le train est lancé. Il faut qu’il arrive au terminus, ou au moins qu’il gagne quelques arrêts. J’aimerais au moins arriver à le faire bander un peu, quitte à le finir à la main ou à le regarder se finir à la main.
Je me lance, je le prends en bouche. Je me concentre sur son gland, toujours complètement détendu. J’y vais doucement, mais avec passion. J’insiste pendant un petit moment. Et mes efforts finissent par être récompensés. J’arrive à lui offrir une demi-molle.
Je continue de le pomper, confiant de pouvoir faire mieux. J’y vais franco, dans le but de le faire jouir dans ma bouche. J’aimerais tellement renouer avec cette sexualité qui nous a toujours si bien réussi à tous les deux. J’aimerais tellement lui faire sentir qu’il est en train de récupérer et de redevenir le sacré baiseur qu’il a toujours été. J’ai envie de flatter son ego de jeune mâle.
Mais les choses ne se passent pas comme j’aurais aimé. Au bout d’un moment, je sens que son érection ne progresse plus, elle faiblit, même. Je ne peux pas renoncer, je ne veux pas qu’il subisse ce nouvel échec. Mais c’est fichu.
— Arrête ! je l’entends m’intimer.
Cette fois-ci, je n’insiste pas.
— On réessaiera une autre fois.
— Non, on ne réessaiera pas.
— C’était idiot de ma part de te chauffer, c’est trop tôt.
Mais Jérém ne réagit pas. Il remonte son boxer, il se glisse sous les draps et se tourne sur le côté.
— Tu devrais rentrer à l’appart, je l’entends ajouter.
— Et pourquoi ?
— Parce que j’ai envie de rester seul.
— J’ai pas envie de rentrer à l’appart.
— Tu devrais même rentrer à Bordeaux.
— Mais qu’est-ce que tu racontes ?
— Je ne sais même pas ce que tu fous encore là, alors que je ne peux même plus te baiser !
— Je m’en fous que tu ne puisses plus me baiser ! Je suis certain que ce n’est qu’une mauvaise passe, et que tout va revenir dans l’ordre.
— Peut-être que ça ne reviendra pas !
— Je te dis que si. Et même si ça ne revenait pas, tu crois que je te laisserais tomber à cause de ça ?
— T’as toujours kiffé ma queue, et maintenant, elle ne marche plus. Je ne vaux plus rien !
— Bien sûr que je kiffe ta queue ! Mais c’est toi que j’aime, avant ta queue ! Et tu vaux tout l’or du monde à mes yeux, que tu bandes ou pas ! Putain, mais tu n’as pas compris ça encore ?!
— Tu serais peut-être plus heureux avec un autre gars, plutôt que de t’enterrer, ici, avec moi !
Ce qu’il vient de dire me touche énormément. Je reçois ces derniers mots, ce sacrifice qu’il serait prêt à faire, de me laisser partir pour ne pas me noyer avec lui, comme des mots d’amour.
— Je ne te laisserai pas tomber, tu entends ?! Je t’aime, espèce d’idiot !
Je m’allonge à côté de lui et je le prends dans mes bras. Je ressens toutes les tensions et les inquiétudes qui secouent son esprit et qui irradient dans son corps. Jérém est déçu et soucieux. J’essaie de l’apaiser en le couvrant de câlins.
Lundi 19 mai 2003.
Ce matin, Jérém a passé des examens au genou et au pied. C’est en début d’après-midi que le docteur Dupuy doit faire le voyage depuis Toulouse pour faire un bilan sur son opération. Jérém est très silencieux ce matin. Je devine qu’il est très inquiet. Je sens qu’il a besoin d’être soutenu. J’ai envie de lui proposer de l’accompagner, mais je redoute sa réaction. A ma grande surprise, c’est de lui que vient cette proposition.
— J’aimerais que tu viennes avec moi au rendez-vous avec Dupuy…
— Mais c’est avec grand plaisir que je t’accompagne, chéri !
Le docteur Dupuy regarde attentivement l’imagerie réalisée le matin. Puis, il examine le patient. Il l’invite à faire des mouvements avec ses articulations blessées, articulations qu’il ausculte avec ses mains. Il est extrêmement concentré, et son regard affiche une certaine gravité. Pourvu qu’il n’ait pas encore de mauvaises nouvelles à annoncer !
— Vous pouvez vous rhabiller.
— Alors ? lance Jérém, impatient et inquiet.
— Alors, alors. Ce que je vois, c’est exactement ce que j’avais envie de voir. Autrement dit, tout se passe on ne peut mieux. Le tendon est bien accroché, il est souple. Et même les croisés du genou n’ont pas trop perdu de leur souplesse. Le travail du kiné est excellent.
Jérém a l’air soulagé, et apaisé. Il est ému. Je suis tellement heureux que j’ai du mal à contenir mon émotion.
— Tout va bien, mon garçon, il n’y a qu’à reprendre la rééducation dans une semaine, et le tour est joué. Mais il faut être patient, il faut que ça cuise à feu doux, sinon tu vas tout cramer à nouveau. Autrement dit, tu n’auras pas d’autres sursis. Si ça recasse, on ne pourra plus réparer.
Le docteur Dupuy est très professionnel, mais aussi avenant et drôle. Au final, il est très rassurant.
— Mais ôtez-moi d’un doute, il nous lance. Vous êtes potes tous les deux, c’est ça…
— Oui, c’est ça.
— Et dites-moi, en toute franchise. Vous êtes potes comme ces potes qui n’ont pas besoin de femmes pour être heureux ?
Je suis surpris autant par sa démarche que par la formule qu’il a employée. Jérém a l’air abasourdi.
— Tu ne crois pas vraiment que tu es le premier joueur connu et pédé qui passe sur mon billard, hein ? il essaie de le mettre à l’aise. Je te rassure, j’en ai vu d’autres !
Son franc parler, sa bienveillance, son ouverture d’esprit, couplé à un solide professionnalisme rendent le personnage extrêmement sympathique et rassurant.
— Je ne veux pas m’occuper de vie privée, rassurez-vous, et tout ça, ça ne sortira pas d’ici.
— En quoi ça vous concerne ce qu’il y a entre nous ? demande Jérém.
— Je veux juste vous aider, si je peux.
— Nous aider ?
— Hétéro ou pas, il y a une complication qui survient très souvent après ce genre d’accident, et qui contribue à pourrir la vie des blessés et de leurs partenaires.
Soudain, je comprends où il veut en venir. Le sujet est sensible, mais je lui fais confiance pour savoir comment s’y prendre une fois de plus.
— Je veux dire, il se peut que certaines choses qu’on aimait faire dans le couple dans les moments d’intimité soient impossibles à faire pendant un certain temps.
— Combien de temps ? lâche Jérém, soudainement intéressé par les arguments du chirurgien.
— Je ne peux pas te dire. Chaque cas est unique et chaque corps réagit de façon différente. En fait, ce n’est pas le corps qui est à l’origine de ces troubles, mais plutôt le mental. Avec le moral au fond du seau, il est très dur… d’être dur.
— Et puis, les médocs que tu prends n’arrangent rien de ce côté-là. Mais rien n’est perdu, tu es jeune et en bonne santé par ailleurs, et une fois qu’on t’aura arrangé tout ce bazar, ça va revenir tout seul.
— C’est chiant d’avoir envie et de n’arriver à rien !
— Je sais. Mais il faut être patient, et surtout ne pas faire une fixette là-dessus. Plus tu cogites là-dessus, plus tu te bloques, et plus tu as du mal à bander. Ne cogite pas, ça viendra quand il sera temps. Et puis, dis-toi bien que dans ton malheur, tu as de la chance, Jérémie.
— De la chance ?
— Je t’ai dit que tu n’es pas le premier joueur gay que je soigne. Mais tu es sans doute celui qui est le plus soutenu, le plus entouré, le plus aimé. Tu as de la chance d’avoir Nicolas qui t’épaule avec tant de dévouement et d’abnégation. En plus, je suis sûr que tu lui as rendu la vie impossible !
— J’ai même été un vrai gros con !
Le docteur Dupuy se marre et nous libère.
Les bonnes nouvelles au sujet de ses blessures ont vachement détendu mon beau brun. Sa négativité se dissipe peu à peu. Les derniers mots du chirurgien ne sont pas non plus tombés dans l’oreille d’un sourd. Son attitude à mon égard a changé. Jérém est désormais plus aimable, plus touchant. Son envie de tendresse est revenue. Je reste dormir avec lui de plus en plus souvent, mon bonheur est total.
Nuit après nuit, les caresses de plus en plus audacieuses. Et le temps dont a parlé le docteur Dupuy ne tarde pas à arriver. Un soir, après un long câlin devenu de plus en plus sensuel au fil des minutes, je l’entends prononcer le genre de réplique qui me met dans tous mes états :
— Vas-y, suce !
Ooooooohhhhh, putaaaaiiiin !!! Comment je l’avais attendue, celle-là, comment elle m’avait manqué ! Et comment ça me fait plaisir de l’entendre prononcer ces mots, sur ce ton en plus, un ton chargé d’excitation et qui n’admet pas de réplique mais juste de l’action.
Evidemment, je m’exécute avec un bonheur inouï. Lorsque je me glisse entre ses cuisses, je trouve sa queue dans une forme qui n’est toujours pas celle du bon vieux temps, mais qui est tout à fait honorable.
Je le prends en bouche sans tarder, et je m’affaire à rendre inoubliables ces retrouvailles sexuelles.
Je le pompe longuement, doucement, et j’arrive à le faire bander davantage, j’arrive à lui arracher des soupirs et des frissons de plaisir. Quel bonheur que de retrouver cela, après tant de temps, après tant d’inquiétudes et de mauvais moments !
Ses doigts n’ont pas perdu le réflexe de caresser mes tétons pour augmenter mon excitation et mon entrain par ricochet.
Au bout d’un moment, sa queue semble reperdre un peu de vigueur. Mais je ne me laisse pas décourager. Je mets les bouchées doubles et j’arrive à l’envoyer en orbite.
— Putain, je vais jouir ! je l’entends s’exclamer, dans un long et profond soupir.
Son corps est secoué par des frissons. Le mien aussi. Ses giclées n’ont pas la puissance que je leur ai toujours connue, mais elles sont copieuses, denses, bien chaudes. Je retrouve son goût de mec avec un bonheur indicible. Et je laisse couler son jus dans ma gorge. Je savoure enfin son goût de mec, mélangé à l’enivrante sensation d’une belle victoire, celle de lui faire enfin retrouver le plaisir de l’orgasme.
Je suis tellement excité que j’ai envie de jouir. Je m’allonge à côté de Jérém et je me branle. Ses doigts caressent mes tétons et je ne tarde pas à parsemer mon torse de longues traînées brillantes et chaudes.
— Putain, tu as réussi ! je l’entends me lancer, sur un ton enthousiaste et enjoué.
— C’est toi qui as réussi, mec !
Nuit après nuit, à grands coups de caresses, de câlins, de douceur et de sensualité, Jérém retrouve sa virilité. Ce ne sont que des pipes, pour l’instant. Mais le processus de réparation de son ego de petit mec est bien lancé, et je suis confiant. Le beau brun retrouve de l’assurance, il dépasse ses angoisses, la peur de la panne.
Un soir, j’arrive à me faire posséder en me laissant glisser sur sa queue à nouveau bien raide alors qu’il reste allongé sur le dos. J’ai vu l’orgasme déformer sa belle petite gueule, j’ai vu dans son regard cette ivresse, cette satisfaction de se répandre en moi. J’ai senti sa main qui a branlé ma queue et qui m’a fait jouir sur son torse, sur ses pecs, sur ses beaux poils bruns.
— C’était un truc de fou ! il me glisse, le souffle court, un beau sourire de garçon repu dans son regard.
— Moi aussi j’ai adoré.
— Merci, Nico.
— Merci de quoi ?
— D’avoir été si patient, de ne pas être parti quand je te faisais la misère. En plus je t’ai dit tellement de fois de te casser…
— Je n’aurais jamais pu.
— Au fait, il faut que je te rembourse, Nico. Ça doit te coûter une blinde de rester ici.
— T’inquiète, ça va. J’ai de l’argent de côté.
— Comment tu peux avoir autant de thune de côté ?
— Ça va, je te dis.
— Je pense que tu me caches quelque chose.
— Pourquoi je te cacherais quelque chose ?
— Parce que je m’étais transformé en horrible con et que tu ne pouvais plus me parler.
— Y a un peu de ça… j’admets.
— Mais je vais me ressaisir, et j’aimerais bien que tu me parles à nouveau.
— Je n’ai rien à te dire !
— Moi je pense que si.
— Pense ce que tu veux !
— On fait un jeu…
— Quel jeu ?
— Tu ne me dis rien, mais je te pose des questions et tu réponds oui ou non.
— Non !
— Si ! Allez, on joue. Moi je pense que tu n’as pas toute cette thune. Oui ou non ?
— Euh… non !
J’accepte finalement de jouer à ce petit jeu, parce que je pense que Jérém a envie de savoir et qu’il va être touché par ce qu’il va apprendre. Il est désormais assez fort pour ne pas se sentir humilié par cet élan de générosité de ses potes, mais pour en ressentir une immense gratitude. Il pourra ainsi les remercier, ils le méritent tellement !
— Donc c’est quelqu’un d’autre qui casque. Oui ou non ?
— Euh… oui…
— Ça ne peut pas être mon père, j’espère que ce n’est pas le tien non plus… c’est pas eux, hein ?
— Non !
— Alors, c’est forcément quelqu’un qui me connaît et qui m’aime bien.
— Oui, ils t’aiment vraiment beaucoup.
— Ils ? Quoi, ils sont plusieurs ?
— Oui…
— Combien ?
— Deux. Même trois, en fait.
— Trois ?
— Autant de monde m’aime à ce point ?
— Oui, et beaucoup plus de monde que tu ne le crois.
— Voyons… l’un d’entre eux ne jouerait pas au Stade Toulousain par hasard ?
— Evidemment ! C’est lui qui a ouvert la souscription, je plaisante.
— Thib, putain, lui c’est vraiment le gars le plus cool de l’Univers !
— C’est clair !
— Et qui d’autre ?
— A toi de trouver ! je m’amuse.
— Voyons… Thierry ou Thomas ? Non, ils ne gagnent pas assez bien leur vie…
— Je vais t’aider… il joue aussi au rugby…
— Naaan… pas lui ?
— Lui, qui ?
— Pas Ulysse ?
— Si !
— Lui aussi, il est adorable !
— C’est vrai. J’ai discuté avec lui. Il est vraiment adorable.
— Et qui d’autre alors ?
— Tu ne devineras jamais !
— Alors dis-moi !
— Tu te souviens de mes proprios à Bordeaux ?
— Oui, très bien ! Quoi, eux aussi participent ?
— De façon indirecte. Ils m’ont annoncé que tant que je suis à tes côtés je n’aurai pas à payer mon loyer.
— Oh, ils sont incroyables !
— Ils le sont, en effet.
— A partir de maintenant, c’est moi qui prends le relais. Et je vais rembourser tout le monde.
— A ta place, je commencerais à faire un tour de coups de fils de remerciements.
Dès le lendemain soir, Jérém s’attèle à passer ces coups de fil.
Evidemment, aucun des trois sponsors n’a voulu être remboursé. Les trois ont exigé de continuer à financer mon séjour à Capbreton jusqu’à la fin de la rééducation.
— Si c’est toi qui payes, le jour où t’as un pet de travers, tu es capable de tout faire capoter. Si tu y tiens, tu me rembourseras le jour où tu disputeras ton premier match. Voilà ce qu’il m’a dit. Thib est un vrai pote, me lance Jérém, en raccrochant d’avec son meilleur ami.
— C’est évident, c’est un gars exceptionnel.
Je ne sais pas si c’est le bon moment pour passer aux aveux, pour me délester de ce poids que je traîne depuis des mois. Un poids qui n’est pas celui des remords, car je ne regrette pas ce qui s’est passé entre Thib et moi lorsqu’il est venu à Bordeaux. C’est plutôt le poids de la cachotterie, de la non franchise qui me mine depuis des mois. Je ne peux pas cacher cela à Jérém. Et non pas seulement car il risque de l’apprendre un jour, et de m’en vouloir encore plus. Non, le fait est que je ne peux pas cacher cela au garçon que j’aime. Je dois assumer mes choix. Je lui dois la franchise.
Ça fait longtemps que je veux parler à Jérém de ce qui s’est passé, mais comme me l’avait fait remarquer Thibault lors de notre première visite à Paris après l’accident, ce n’était pas le moment. Depuis trois mois, ce n’est pas le moment. Est-ce que ça l’est maintenant ? Je ne le sais pas. Au fond de moi, je redoute la réaction de Jérém. Mais ce soir, je me sens assez fort pour lui expliquer comment et pourquoi cela s’est passé. Je nous sens assez forts pour affronter cela.
— A propos de Thibault…
Les mots glissent de mes lèvres. Et une fois lancé, je ne peux plus revenir en arrière.
— Quoi, Thibault ?
— Il faut que je te dise quelque chose, Jérém.
— Vous avez couché ensemble, c’est ça ? il me glisse, le plus naturellement du monde.
— C’est ça… j’admets, désarmé par son regard, un regard qui demeure calme, aimant.
— Comment tu sais ?
— Je me suis posé la question quand vous êtes venus à Paris.
— Pourquoi ? On a fait quelque chose…
— Non, rien du tout, il me coupe. Mais j’ai vu une complicité, et aussi un malaise. Je me suis dit que ça cachait quelque chose.
— Ah…
— Ça s’est passé quand ? il m’interroge.
— Au mois de février, avant ton accident.
— D’accord.
— D’accord ? C’est tout ce que ça te fait ? je m’étonne à haute voix.
— Ça m’a fait un peu chier au début. Mais après, je me suis dit que je serais vraiment mal placé pour te faire la morale pour ça. Primo, j’ai fait la même chose il y a deux ans. Deuxio, je t’avais encore laissé tomber comme une merde. Et tertio, je préfère que ça se soit passé avec Thib plutôt qu’avec un connard qui t’aurait jeté après. Et puis, ce n’est pas comme si c’était la première fois que vous couchez ensemble ! On a fait ça deux fois, je te rappelle !
— C’est pas faux !
— Alors, je comprends parfaitement que vous ayez pu avoir envie de vous faire du bien, rien que tous les deux. Je n’avais qu’à être là avec vous. J’ai été con, tant pis pour moi…
Je suis ébahi par la réaction de Jérém, par sa lucidité, son ouverture d’esprit, sa propre remise en question, par le fait qu’il pense à mon bien-être.
— Vraiment, tu n’es pas fâche ?
— Non, pas du tout. C’était plus le fait de ne pas savoir si j’avais vu juste ou pas qui me minait.
— Alors, là, tu m’épates !
— C’était une seule fois ?
— Une seule fois.
— Même la nuit où vous êtes venus à Paris, à l’hôtel…
— Non, il ne s’est rien passé cette nuit-là.
— Et s’il n’y avait pas eu l’accident ?
— Je ne peux pas te dire Jérém…
— C’était que du sexe ?
J’hésite un peu sur la réponse. Mais je lui dois la franchise et je ne veux rien lui cacher.
— Si je te disais oui, je ne te dirais pas toute la vérité. Thibault est un garçon attachant, adorable. Je crois qu’il est impossible de ne pas ressentir de l’affection pour un gars comme lui, et encore plus impossible de coucher avec lui sans ressentir de la tendresse.
— Je sais, je sais… il admet, le regard rêveur. Tu es amoureux de lui ? il rebondit.
— Non, je ne crois pas. Thibault est quelqu’un de spécial. Mais pas aussi spécial que toi. Je pense que je pourrais ressentir de la tendresse pour pas mal de garçons. Mais ce que je ressens pour toi, je ne l’ai jamais ressenti avec aucun autre.
— C’est pareil pour moi, Nico, c’est pareil pour moi.
— Je t’aime, Jérémie Tommasi.
— Moi aussi je t’aime, Ourson !
Nous faisons l’amour. C’est doux, c’est intense.
— Merci de m’avoir parlé de tout ça, il me chuchote à l’oreille, après être venu se caler contre mon dos et m’avoir pris dans ses bras.
— Merci à toi de l’avoir pris de cette façon.
Jour après jour, je trouve Jérém de mieux en mieux dans sa peau. Entre les mots rassurants du docteur Dupuy concernant sa rééducation, sa sexualité retrouvée, ainsi que la réponse aux questionnements autour de Thibault et moi qui devaient le tarauder depuis tout ce temps, son esprit semble s’être délesté d’un grand poids. Tout cela doit jouer sur la motivation qu’il affiche désormais pour la reprise de la rééducation. Toute son attitude face à la vie a changé.
L’horizon de Jérém, et le mien avec, semble à nouveau s’éclaircir. Je suis tellement heureux ! La vie me paraît soudainement à nouveau si belle.
Et peu importe si, malgré les enveloppes remplies de notes de cours qui depuis des semaines atterrissent régulièrement dans ma boîte aux lettres, un grand merci, Monica, je ne suis pas arrivé à préparer mes examens. Peu importe si je vais rater mon semestre. Je ne regrette rien, le jeu en valait grandement la chandelle.
Papa a raison, « Des cours, ça peut se rattraper plus tard. Des blessures comme les siennes, il faut les panser maintenant ».
Voir Jérém aller mieux, ça n’a pas de prix. 8 commentaires
8 commentaires
-
Par fab75du31 le 18 Septembre 2022 à 22:39
Mardi 8 avril 2003.
Le lendemain, je rejoins le Centre de rééducation de Capbreton en passant par la plage. Je marche sur le sable, je m’emplis les yeux du mouvement incessant des vagues, je me laisse emporter par le bruit de l’océan. J’ai l’impression que ce déferlement d’énergie visuelle et sonore vient jusqu’à moi, en moi, et me recharge à bloc.
Après cette petite marche matinale, je me sens revigoré, et plein d’optimisme. Pas dégueu comme trajet au saut du lit pour les prochaines semaines. Pourvu que tout se passe bien pour Jérém !
Je suis au Centre à 9 heures, et j’attends tout le reste de la matinée pour voir Jérém. Il est 13h30 passées lorsque le bobrun revient de la batterie d’examens préalables au démarrage de sa rééducation.
— J’ai l’impression d’avoir passé plus d’examens ce matin que pendant toute ma vie. Ça n’en finissait plus ! il s’exclame.
— Alors, ils t’ont dit quelque chose ?
— Non, rien. Je dois voir mon médecin référent en fin d’après-midi pour faire le point.
— Je suis sûr que tout s’est bien passé.
— On verra. Pour l’instant je vais manger, je meurs de faim.
Je rentre manger aussi. J’en profite pour faire une petite sieste et pour faire quelques courses. Je reviens au Centre vers 18h00, avant le repas du soir. Je suis optimiste, j’ai besoin d’être optimiste.
Mais mon optimisme va être de courte durée. Ce soir, Jérém tire la mine des mauvais jours. Son regard est noir et fuyant, et tout dans son attitude dégage la déception et la colère.
— Salut, Jérém, ça va ? je lui tends le bâton pour me faire battre.
— Non, ça ne va pas ! il explose aussitôt.
— Qu’est-ce qui se passe ?
— Il se passe que le tendon du pied n’a pas cicatrisé comme il aurait dû. Il semblerait que l’opération ait foiré. Je suis foutu !
— Ne dit pas ça ! Il a dit quoi exactement, le médecin ?
— Il pense que c’est à surveiller, et qu’il faut y aller mollo avec la rééducation, sinon il risque de péter à nouveau. La rééducation va prendre des plombes, je ne vais pas tenir !
— Si, tu vas tenir. Tu vas tenir parce que c’est ta seule chance, ta seule option pour espérer rejouer un jour.
— Je suis fatigué, j’ai pas envie !
— Tu dois au moins essayer. Essayer c’est le premier pas pour y arriver.
— C’est ça, oui !
— De toute façon, tu dois y arriver, sinon je vais aller me faire péter la gueule par les gars de Châteauroux ! j’essaie de le faire rire.
Mais Jérém n’est pas en état de rigoler, et ma petite vanne tombe à plat.
— En plus, je me suis fait pourrir à cause des joints !
— Ils l’ont vu aux examens ?
— Oui, et à partir de maintenant, c’est interdiction complète.
— Je t’avais dit, Jérém !
— Il m’a interdit l’alcool et la cigarette, aussi…
— La cigarette ?
— Il m’en laisse dix par jour. Je vais devenir fou.
L’heure du dîner arrive. Je le trouve à nouveau découragé, pessimiste, négatif, et ça me brise le cœur de devoir le laisser.
Je ne suis pas vraiment bien lorsque j’arrive à l’appart. La solitude me pèse ce soir. Heureusement, j’ai pensé à apporter ma radio cd et quelques CD pour avoir un peu de compagnie.
Mais lorsque j’ai le moral au fond des chaussettes, comme ce soir, aucun CD ne me fait envie. Alors j’allume la radio, et je délègue à un programmateur musical le choix de ce que je vais écouter.
Une surprise m’attend ce soir-là. A l’issue d’une page interminable de pub, et alors que mes pâtes sont presque prêtes, une voix sort de la radio, traverse le vide du petit séjour, rentre dans mon pavillon auriculaire, fait vibrer mon martelet, pénètre dans mon cerveau, et pointe direct vers mon cœur. Là, elle provoque un feu d’artifice. Quelques mots a cappella scandés par une voix que je reconnaîtrais entre mille, malgré les filtres et autres artifices.
Do I have to change my name
Will it get me far
Should I lose some weight
Am I gonna be a star
(…)
American life…
J’étais au courant que son retour dans l’actualité musicale était imminent. Mais avec tout ce qui s’est passé en quelques jours, j’avais perdu tout ça de vue.
Et là, c’est la claque. Un nouveau titre, dans un style épuré, avec des sons percutants, et d’une grande élégance. Cette voix, cette présence, est la petite note positive qui me permet de ne pas me noyer dans les inquiétudes qui assombrissent à nouveau l’horizon de Jérém. Et le mien, par ricochet.
Décidemment, Madonna est toujours là quand j’ai besoin d’une voix familière, elle accompagne ma vie et me donne de la joie, souvent au moment où j’en ai le plus besoin.
Son effronterie, son énergie, sa façon d’être ce qu’elle veut, faisant fi des contraintes sociales, ouvrant de nouveaux possibles en dehors des préjugés, de l’ordre établi, sa façon de donner de la visibilité aux minorités dans ses chansons – Vogue, s’il ne faut en citer qu’une – minorités dont je fais partie, cela me parle et me touche au plus haut point.
Sa façon d’exprimer sa sexualité, ses envies, ses désirs, ses fantasmes (c’est dans son livre Sex que j’ai vu pour la première fois deux hommes s’embrasser) de façon décomplexée, déculpabilisée, sa façon de faire ce qu’elle veut et de profiter de la vie comme elle l’entend, cela me fait rêver, alors qu’au fond de moi je sens et je sais que la société me censure à cause de ma différence.
Son côté à la fois icône et iconoclaste est explosif.
Je penserai toujours à cela, à cette joie que j’ai ressentie à chacune de ses sorties discographiques, à cette sensation rassurante d’avoir une amie artiste qui ne me laisse pas tomber, qui est là à chacun des tournants de ma vie, j’y penserai toujours tant d’années plus tard, lorsque l’âge la rattrapera, l’entraînant dans une dérive sans fin. Et ma tendresse à son égard ne flanchera jamais.
Mercredi 9 avril 2003.
Le lendemain matin, je mate le Morning Live. Je prends sur moi et je m’accroche pour ne pas me laisser décourager par les niaiseries de mauvais goût dont cette émission a le secret. Mon effort et mon dévouement finissent par être récompensés car je finis par tomber sur le clip que j’attendais.
Do I have to change my name
J’apprends par les bandeaux qui s’affichent en bas de l’écran que ce clip serait une version très édulcorée de l’original, version que Madonna aurait réalisée dans l’urgence, la première ayant été boycottée par MTV car jugée trop polémique à l’égard du président des Etats-Unis et de sa décision de mener une guerre contre l’Irak. Notamment dans un contexte où les médias américains commençaient à parler des premiers boys tombés dans le désert à 10000 bornes de chez eux.
J’ai l’impression que depuis le 11 septembre, le monde est en train de devenir fou. Quand je pense à ces jeunes garçons qui perdent leur vie à la guerre, j’en ai mal au cœur.
La vie est cruelle, et elle l’est aveuglement. Elle s’est acharnée sur Jérém. Oui, Jérém est blessé. Mais au moins, il n’est pas à la guerre. Je ne me sens pas bien de penser à cela, mais je ne peux m’en empêcher.
J’ai eu l’occasion de voir le planning de Jérém, et je sais que ce n’est pas la peine d’arriver au Centre trop tôt le matin. Je profite de ma matinée pour ouvrir enfin les livres de cours.
Je retourne au Centre vers l’heure du déjeuner. Je retrouve Jérém dans la salle commune, comme convenu. Il n’a pas l’air ravi. La première séance de rééducation a été douloureuse.
— Ils t’ont fait faire quoi ?
— Piscine et vélo d’appart. Ils m’ont pris pour une mémé qui veut maigrir ! Je ne vais jamais récupérer avec ça !
— Patience, Jérém, patience !
Le lendemain, le moral de Jérém est toujours en berne.
— Regarde tous ces mecs en fauteuil roulant, en béquilles, avec des attèles, des pansements, il me lance, alors que nous prenons un café dans la salle commune. Il y a beaucoup de sportifs, et certains y sont depuis des mois. Ils triment du matin au soir, et beaucoup d’entre eux n’y arrivent pas, ils n’y arriveront jamais !
— Toi, tu y arriveras.
— Je ne veux pas rester ici des mois, il continue, sans prêter cas à mes mots. Cet endroit, c’est une putain de casse de luxe pour sportifs abimés. Cet endroit me fiche les boules !
— Pour quelques-uns qui n’y arrivent pas, tant d’autres y arrivent ! Autrement, la renommée de cet endroit ne s’expliquerait pas !
— J’ai entendu un mec qui disait que les clubs nous garent ici en attendant la fin de notre contrat.
La morosité et le pessimisme de Jérém perdurent pendant de longs jours. Ce n’est qu’au bout de presque deux semaines de rééducation que les choses semblent prendre un nouveau pli. Le jeune ailier semble prendre confiance dans le programme de rééducation, et il semble enfin voir des progrès.
J’ai même l’impression qu’il commencerait à reprendre espoir, même s’il s’en défend. Mais je sais désormais interpréter son attitude, sa communication non verbale. Et son regard. Et dans ce dernier, je revois enfin cette étincelle, cette flamme qui m’emplit de joie. Je vois dans ses yeux que, même s’il prétend le contraire, il a recommencé à y croire. Je n’ai pas oublié les mots du chirurgien rencontré dans le train, et je me rends compte à quel point ils étaient justes.
Oui, le moral de Jérém semble s’améliorer. Mais une visite surprise va le remettre sérieusement en pétard.
Mardi 22 avril 2003.
Le lendemain du week-end de Pâques, je me pointe au Centre sur le coup de midi, comme d’habitude. Lorsque Jérém débarque avec ses béquilles, je vois son regard s’assombrir en une fraction de seconde et devenir si noir que le ciel avant un orage violent.
Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que j’ai fait, encore ? Qu’est-ce que je vais prendre, encore ?
— P’tit Loup, je tente de l’amadouer.
— Qu’est-ce que tu fiches ici ? je l’entends rugir, la voix chargée de colère et d’agressivité, le regard ailleurs.
— Mais Jérém, qu’est-ce que…
— Pas toi, elle ! il me coupe sèchement.
C’est là que je remarque une dame assise dans un coin, à l’écart. Elle doit avoir une quarantaine d’années, elle est brune, et assez élégante. Jérém la regarde fixement et la fusille du regard.
— Jérémie, mon chéri. Je voulais savoir comment tu allais. Tu ne réponds pas à mes coups de fil.
— Si je ne réponds pas, c’est parce que je n’ai pas envie de te parler, et encore moins de te voir.
— J’ai le droit d’avoir envie de savoir comment va mon fils, non ?
Ah, voilà une bonne surprise. « Belle-mère » est là. Pas sûr que la réunion familiale sera pour bientôt.
— Ah, tu te souviens que tu as des fils que quand ils sont à l’hôpital !
— Jérémie, mon chéri…
— Arrête de m’appeler « mon chéri », ça fait dix ans que je ne le suis plus. Et ça fait dix ans que tu n’es plus ma mère ! Maintenant fiche le camp, je ne veux plus te revoir ici.
Jérém fait demi-tour et disparaît dans l’ascenseur.
Je regarde cette femme. Elle a l’air défaite. Jérém n’y est pas allé de main morte. Je connais l’animosité qu’il garde en lui vis-à-vis du fait que sa mère l’a abandonné pour refaire sa vie, mais je trouve qu’il a été très dur.
— Ça va, Madame ? je lui demande.
— Pas vraiment.
— Il n’est pas bien en ce moment.
— Je sais. Mais dites, vous connaissez Jérémie ?
— Oui, on était au lycée ensemble. Et on est restés potes depuis. Je m’appelle Nicolas.
— Et tu es venu lui rendre visite ?
— En fait, j’ai un appart pas loin, et je viens le voir de temps en temps.
— Je peux vous demander comment il va ?
— Il a eu beaucoup de mal après son accident. Là, depuis quelques jours, ça semble aller mieux. Les réparations au genou et à la cheville semblent bien évoluer et la rééducation commence à porter les premiers fruits.
— Je suis soulagée. Désolée que vous ayez dû assister à cette dispute.
— C’est rien.
— Vous savez, c’est compliqué entre mon garçon et moi.
— Je sais…
— Il vous a parlé de moi ?
— Oui, je sais que vous avez divorcé de son papa quand il était ado.
— Je sais que j’ai fait beaucoup de mal à mes garçons, et Jérémie en a souffert plus que son frère.
— Vous aviez certainement vos raisons.
— Je n’aimais plus leur père, et j’ai suivi l’homme que j’aimais. Et la vie m’a amenée sur d’autres chemins. Je me suis installée à l’autre bout de la France, j’ai monté une entreprise avec mon nouveau compagnon, et je suis très vite retombée enceinte. J’ai deux autres enfants, une fille de 9 ans et un garçon de 8. Mon choix peut paraître égoïste, mais je n’ai pas pu faire autrement. Je ne pouvais pas m’occuper de deux familles. Mais je n’ai jamais cessé de penser à Jérémie et à Maxime. Jamais. J’ai essayé de reprendre contact à plusieurs reprises, mais j’ai toujours rencontré l’hostilité de leur père, et la leur aussi. Avec Maxime, j’ai enfin pu rétablir un contact il y a quelques mois. Pas avec Jérémie. Ça me fend le cœur que Jérémie me déteste à ce point, elle s’exclame tristement.
— Il a énormément souffert parce que vous lui avez énormément manqué.
— Je sais. Mais dis-moi, quel genre de garçon est aujourd’hui, Jérémie ? Je veux dire… avant l’accident.
— Avant l’accident, ça faisait un moment que je ne l’avais pas vu. Il était très pris par le rugby et…
— Mais depuis qu’il joue dans des grandes équipes, il a l’air épanoui, non ? elle me coupe.
— Il l’est, oui. L’année dernière il a galéré, mais depuis qu’il est au Stade, ça lui réussit vraiment bien. Et ça lui apporte beaucoup de satisfaction.
— Et au-delà du rugby ? Est-ce qu’il est heureux ? Ou du moins serein ?
— Je pense qu’il l’est, oui. Mais Jérém est un garçon qui n’aime pas montrer qu’il ne va pas bien. Quand c’est le cas, il se renferme et il envoie tout valser, y compris ses potes.
— Il a toujours été comme ça, mon Jimmy, même quand il était petit. Quand on le grondait, il se cachait et on avait beau l’appeler, il n’y avait plus personne. Il ne revenait que quand il avait faim !
— Jérém est un garçon qui aime bien se montrer fort. Mais quand on le connaît un peu mieux, on s’aperçoit que sous la carapace qu’il s’est construite se cache un garçon sensible, à fleur de peau, un garçon touchant.
— Vous avez l’air de bien le connaître…
— Vous pouvez me tutoyer, Madame.
— Et toi aussi, et tu peux aussi m’appeler Alice au lieu de Madame !
— D’accord !
— Il a de la chance d’avoir un copain comme toi…
— Je ne sais pas, si vous le dites.
— Tu l’aimes, ça se voit.
— Oui, beaucoup.
— Allez, trêve de cachotteries ! Je sais qui tu es pour Jérémie, Nicolas. Maxime m’en a parlé.
— Ah… vous savez tout, alors.
— Oui, et je suis heureuse qu’il soit avec un garçon comme toi. Maxime m’a dit le plus grand bien de toi. Et je vois qu’il ne s’est pas trompé. Tu es ici pour le soutenir, tu ne laisses pas tomber. Tu es un bon garçon, Nicolas.
— Je fais ce que je peux…
— Je sais que je ne pourrais jamais rattraper les années que je lui ai volées, la souffrance que je lui ai infligée, elle enchaîne. Je voudrais juste pouvoir lui parler pendant quelques minutes sans qu’il me hurle dessus. Je voudrais lui demander pardon, et essayer de lui expliquer ma version des faits. Je voudrais lui faire comprendre que je n’ai jamais cessé de penser à lui et de l’aimer, quoique son père en dise. Mais je crois qu’il n’est toujours pas prêt et je commence à croire qu’il ne le sera jamais. J’ai fait le voyage pour rien. Enfin, non. J’ai pu rencontrer le garçon qui rend mon fils heureux. Et ça, ça me fait vraiment plaisir.
— Vous partez quand, Alice ?
— Maintenant. Je n’ai plus rien à faire ici.
— Vous pouvez attendre jusqu’à demain ?
— Pourquoi attendre ?
— Laissez-moi parler à Jérém ce soir.
Nous nous échangeons nos numéros de portable.
— Bien entendu, je ne vous promets rien. Mais je vais essayer de le raisonner.
— Ne mets surtout pas votre relation en danger à cause de moi.
— Je vais faire attention, promis.
— Je vais chercher une chambre pour cette nuit, alors.
— Je vous appelle ce soir.
Je ne suis pas sûr de pouvoir convaincre Jérém de faire un pas vers sa mère. Mais je sais que je m’en voudrais de ne pas essayer.
Je retourne au Centre en fin d’après-midi, comme d’habitude. J’attends jusqu’à 19 heures mais Jérém ne vient pas dans la salle commune. Je l’appelle sur son portable, il ne répond pas. Je demande à l’accueil, je m’entends dire qu’il doit être en train de dîner. J’insiste pour qu’on aille le prévenir que je voudrais le voir. Quelques minutes plus tard, on me répond qu’il n’est pas dans la salle de repas, et qu’il doit être monté dans sa chambre. Je m’y rends illico. Je tape à la porte. Le battant s’ouvre dans la seconde, et Jérém n’a pas du tout l’air surpris de me voir débarquer, comme s’il m’attendait. Il ne parle pas, il a le regard perdu.
— Je t’attendais en bas…
— Je suis monté de suite après la fin de la séance de kiné.
— T’as pas mangé ?
— J’avais pas faim.
— Tu ne devrais pas sauter de repas…
— Elle est partie ? il me coupe sèchement.
— Elle a dit qu’elle prenait une chambre pour cette nuit. Elle repartira demain.
— Bon débarras !
— Tu as été très dur avec elle.
— Elle le mérite !
— Tu ne penses pas que tu devrais lui laisser une chance de s’expliquer ?
— Certainement pas !
— Tu savais que Maxime s’était un peu rapproché d’elle ?
— Oui, mais ça le regarde. Moi, je ne peux pas.
— Tu ne voudrais pas entendre ce qu’elle a à te dire ?
— Ça m’intéresse pas ce que cette conasse a à me dire !!! il rugit. Je n’en ai rien à faire d’elle !!!
Son visage est parcouru par une expression de colère et de souffrance qui me peine énormément.
— Si vraiment tu n’en avais rien à faire, tu ne te mettrais pas dans cet état à cause d’elle !
— Fiche-moi la paix, toi aussi !
— Mais regarde dans quel état te met cette rancœur. Ça fait dix ans que cette colère est en toi, dix ans qu’elle te bouffe et qu’elle te rend malheureux.
— Ça, c’est mon problème.
— Au moins, tu admets que c’est un problème ! Et tu veux garder ce « problème » en toi encore combien de temps ? Tu ne crois pas qu’il a fait assez de dégâts ? Tu ne crois pas que t’as d’autres fardeaux à porter en ce moment, et que tu as besoin de toute ton énergie pour récupérer plutôt que pour être en colère ? Tu ne crois pas que pardonner te demandera moins d’énergie que de haïr ?
— Je n’y arrive pas. Dès que je la vois, tout remonte, et… et… et… je n’y arrive pas… je n’y arrive pas !
— Elle a fait mille bornes pour venir te voir. Elle a fait un beau geste, et elle l’a fait pour toi. Tu ne crois pas que ce serait l’occasion de mettre tout ça à plat et de te débarrasser une fois pour toutes de ce « problème » ?
— Si j’accepte de lui parler, elle va encore m’embobiner. Papa a toujours dit qu’elle était très douée pour embobiner les gens !
— Depuis quand tu accordes de l’importance à ce que dit ton père ? Ton père a été quitté pour un autre, il n’est sans doute pas très objectif sur le sujet !
Jérém se tait, l’air pensif, troublé.
— Ecoute-la, et fais-toi ton idée ! Laisse-la parler, tu la pourriras après si tu veux. Mais si tu la pourris d’entrée, si tu refuses de l’écouter, tu ne sauras jamais ce qu’elle a à dire.
— Je préfère autant qu’elle se tire et qu’elle ne revienne jamais.
Je rentre à l’appart lessivé et déçu. Au fond de moi, j’avais cru pendant un moment avoir réussi à trouver les mots pour convaincre Jérém de laisser une chance à sa mère. J’ai foiré. J’appelle Alice et je lui fais part du refus de son fils de lui parler.
— C’est pas grave. Je m’attendais à ça. Je te remercie d’avoir essayé, Nicolas. Je suis heureuse de t’avoir rencontré. Prends toujours soin de mon Jimmy comme tu l’as fait jusque-là, et donne-moi quelques nouvelles de temps en temps.
— Avec plaisir, Alice.
Cette nuit, je ne dors pas beaucoup. J’ai le cœur lourd. Je sais que ça ferait beaucoup de bien à Jérém de se débarrasser de cette haine ancienne. Je voudrais trouver le moyen pour le lui faire admettre. La venue de sa mère était une occasion en or, une occasion qui ne se reproduira peut-être plus jamais Et je ressens une impression de gâchis monumental.
Mercredi 23 avril 2003.
Le lendemain matin, je ne me réveille pas vraiment en forme. Je n’ai pas assez dormi. Et j’ai toujours le cœur aussi lourd que la veille. Il est 8h45. Je me dis qu’à cette heure, Alice doit déjà avoir pris la route.
Je passe la matinée à parcourir les photocopies des notes de cours que Monica m’a gentiment envoyées par la Poste. A midi, je me pointe comme chaque jour au Centre. J’attends de longues minutes, et mon bobrun ne vient pas. Je retourne à l’accueil. Je m’entends dire que Mr Tommasi a eu une permission de sortie pour ce midi et qu’il devrait rentrer avant 15 heures, pour sa séance de kiné.
Pourquoi a-t-il eu une permission de sortie ? Où est-il allé ? Il est déjà 13 heures. Depuis le temps, j’ai appris à mettre à profit les longues heures d’attente en faisant suivre mes cours dans mon sac de la fac.
En attendant que Jérém revienne, je révise.
Il manque une poignée de minutes avant 15 heures lorsque la porte vitrée automatique du hall d’entrée s’ouvre pour laisser rentrer le bobrun aux béquilles. Lui, mais pas lui tout seul. Il est accompagné. Alice se tient à côté de lui. Elle sourit, et Jérém a l’air tellement plus détendu qu’hier soir !
— Nicolas ! me salue la maman de Jérém, dès qu’elle me capte.
— Bonjour Alice. Salut Jérém.
— Je fais pas les présentations… lance Jérém, un brin moqueur.
— Non, on s’est débrouillés pour ça, je lui relance.
— Je n’ai pas du tout envie de partir, mais il faut que je prenne la route. Le travail m’appelle, fait Alice.
— Et tes gosses aussi !
— Oui, eux aussi. J’aimerais que tu viennes les rencontrer un jour. Ce sont tes demi-frères et sœurs.
— Je ne sais pas si je suis prêt pour ça.
— Si un jour tu l’es, tu seras toujours le bienvenu. Tous les deux, vous serez les bienvenus ! Jimmy, tu m’as fait un cadeau qui a une valeur inestimable pour moi.
— Ce n’était qu’un resto…
— Tu sais très bien de quoi je parle, petit filou ! Merci de m’avoir écoutée. Ça m’a fait un bien fou, tu peux pas savoir !
— A moi aussi !
— Viens-là, Jérémie ! fait Alice, débordée par l’émotion. Quel beau garçon tu es devenu ! Tu es un homme à présent ! Je suis tellement fière de ce que tu es devenu !
Alice est en larmes. Jérém a lui aussi l’air très ému, et je sens qu’il est en train de fournir un effort inouï pour retenir ses sanglots.
— Nicolas, encore une fois, très heureuse d’avoir fait ta connaissance. Et merci pour tout ce que tu fais pour mon garçon !
— Très heureux aussi. C’est un plaisir d’être là pour Jérém ! Je ne pourrais pas m’en dispenser !
— A bientôt, les garçons, elle nous lance, juste avant de passer la porte vitrée automatique du Centre.
Sa silhouette vient tout juste de disparaître dans le parking et Jérém est en larmes. Je le prends dans mes bras et je le serre très fort contre moi.
Je retourne voir Jérém le soir même. Il a l’air heureux. Sa séance de kiné s’est très bien passée. Après l’explication avec sa maman, son cœur est plus léger. Ce soir, il est de fort bonne humeur. Il me demande de monter dans sa chambre et de passer la nuit avec lui.
— Mais c’est pas interdit ?
— Si, mais je m’en bats les couilles !
Nous nous allongeons sur le lit l’un à côté de l’autre.
— Elle sait pour nous ! il me glisse.
— Oui, et elle l’a très bien pris.
— Je n’aurais pas cru.
— Tu es content de l’avoir écoutée ?
— Oui.
— Ça t’a fait du bien ?
— Je crois, oui.
Jérém vient se blottir contre moi.
— Merci Nico, tu es mon ange gardien ! je l’entends me souffler.
— Je t’aime, Jérémie Tommasi !
Cette nuit nous partageons des baisers, des caresses, beaucoup de tendresse. Je ne lui demande pas plus, je n’ai besoin de rien de plus. Je ne sais pas où il en est avec ses problèmes de libido, mais on affrontera cela le moment venu.
Jeudi 24 avril 2003.
Après une nuit passée clandestinement dans la chambre de Jérém au Centre, je rase les murs pour m’évader au petit matin sans être remarqué. Cette clandestinité est marrante, elle a un petit goût de transgression, de secret et de complicité qui me plaît beaucoup.
J’ai adoré passer la nuit avec Jérém. Et j’ai adoré les caresses et les baisers du matin. Et son sourire. Et son :
— Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Nico.
Le lendemain de cette nuit passée avec Jérém et de cette journée qui a marqué la réconciliation entre ce dernier et sa maman, le CD d’American life, l’album, fait son apparition dans les rayons du supermarché où je fais les courses. Évidemment, il tombe tout seul dans mon caddie. A partir de cet instant, mon impatience d’écouter ces nouvelles chansons devient chaque instant plus insupportable.
De retour à l’appart, je baisse les stores, je m’allonge sur le lit, j’éteins mon téléphone. J’insère la galette dans mon vieux poste, je mets mon casque. Avant de lancer la lecture, je feuillette le livret. Très graphique, très stylé.
Je le remets dans le boîtier, je pose le tout à côté de moi. Je résiste encore quelques instants à mon impatience de lancer la lecture. Je sais que cette impatience, que cet instant d’avant, sont le sel du bonheur. A une époque où la musique était « rare » car liée à un support physique, une sortie discographique de son artiste préféré était un événement.
Je lance enfin la lecture.
Do I have to change my name
L’album s’ouvre avec le single qui circule en radio depuis deux semaines (à cette époque, les radios mainstream passent encore du Madonna). Je ferme les yeux, et je me laisse approcher, pénétrer, enivrer par cette première écoute de l’enregistrement complet, en qualité CD. Je découvre les autres titres un à un. Je les savoure en essayant de me concentrer totalement sur la magie de cette première écoute, de cette première fois. Je sais que les écoutes suivantes n’auront plus cette magie, celle de la découverte. Certes, une autre magie prendra le relais, plus durable, celle des souvenirs qui vont s’accrocher à ces mélodies, à ces rythmes, à ces paroles, à cette voix.
Mais la magie de la première écoute est éphémère. Et c’est en cela qui réside toute sa beauté. Cette première écoute, c’est comme le premier baiser qu’on donne à un garçon qu’on aime, elle est unique. Les autres seront forcément différentes.
Après « American life », que je redécouvre en l’écoutant dans le casque, je retrouve « Die Another Day », souvenir d’une escapade à Paris commencée dans le bonheur et terminée dans la crainte que Jérém puisse être attiré par Ulysse. Crainte par ailleurs bien avérée par la suite.
Je suis touché par « Hollywood », « Nobody Knows me » et « Nothing fails ». Et bouleversé par la douceur et la puissance d’« Easy Ride ».
Ce soir encore, Jérém m’infiltre dans sa piaule. Nous nous embrassons, nous nous câlinons, comme deux adolescents. Jérém ne montre aucun désir d’aller plus loin, toujours pas. C’est à la fois frustrant et délicieusement excitant que cet échange de tendresse qui ne franchit pas la barrière de la sensualité.
La discussion prend la place du sexe. Jérém me parle longuement de son repas avec sa mère, et de son regret de ne pas lui avoir permis de s’expliquer plus tôt. Il dit se sentir soulagé d’un poids immense.
Nous parlons de plein de sujets. Je trouve même le moyen de le questionner sur cette histoire racontée dans la presse people au sujet de sa relation avec Alexia.
— Je suis étonné que tu ne m’aies pas posé la question plus tôt…
— T’as vu comment t’étais dans une humeur de chien jusqu’à il n’y a pas longtemps ? Je n’avais pas envie de me faire jeter encore !
— C’est pas faux ! J’ai été insupportable, hein ?
— Euhhh… je feins de réfléchir, avant d’asséner avec conviction : OUAIS !
— Cette histoire a été inventée de toute pièce pour me protéger.
— Mais te protéger de quoi ?
— Les derniers mois, je suis un peu sorti à Paris…
— Dans des boîtes gay ?
— Oui… et on m’a reconnu. Des bruits commençaient à circuler. Alors mon agent a eu cette idée.
— T’as couché avec cette meuf ?
— Mais jamais de la vie ! Cette meuf me rebute, elle est conne comme un manche à balais !
— Et Ulysse ?
— Quoi, Ulysse ?
— Tu en es où avec lui ?
— Nulle part.
— Il s’est passé quelque chose entre lui et toi ?
— Non, jamais. Et il ne se passera jamais rien. Ulysse n’est pas comme nous.
Au fond de moi, je suis un peu déçu qu’il n’ait pas cité la raison qui devrait le tenir à elle seule à bonne distance du beau blond. La raison dont j’aimerais être le sujet.
— Il n’a pas voulu, il précise.
— Tu lui as fait des propositions ? j’accuse la surprise.
— Je ne veux rien te cacher, Nico…
— J’apprécie.
— J’ai craqué un soir où j’avais trop bu.
— Et comment il a réagi ?
— Bien. Il m’a juste dit que les gars ce n’était pas son truc. Il a été super cool, mais ça m’a mis un putain de malaise ! Pendant des semaines j’ai eu beaucoup de mal avec ça, et même encore maintenant.
— C’était quoi alors, qui t’attirait vers lui ?
— J’étais impressionné par ce gars, et je le suis toujours. Il a une prestance, il dégage un tel charme…
— Ça va, ça va, je sais, je l’ai revu quand tu étais à l’hôpital à Paris, je le coupe.
— Mais surtout, il continue, Ulysse est un véritable ami, quelqu’un qui arrive à tirer le meilleur de moi, quelqu’un qui m’encourage, et qui me soutient à chaque fois où j’en ai besoin. Ulysse est quelqu’un qui me grandit…
— Et il marche sur l’eau ? je plaisante.
— Même si c’était le cas, ça ne changerait rien.
— Tu parles du fait qu’il est hétéro ?
— Non, je parle du fait que je ne suis pas amoureux de lui. Et que quand je suis seul, quand je ne vais pas bien, c’est à quelqu’un d’autre que je pense.
— Alexia ? je le cherche.
— Oui, exact !
— Petit con, va !
— Je ne sais pas comment tu t’es débrouillé, mais tu as volé un morceau de mon cœur.
Ah, la voilà la raison que j’attendais ! Il a fallu être patient pour l’entendre enfin ! Et comment ils me touchent, ces mots de mon bobrun !
— Je suis vraiment désolé de t’avoir planté avant Noël, et de t’avoir dit ce que je t’ai dit. Comme quoi tu n’étais pas un homme…
— C’est oublié, Jérém. L’important c’est que tu retrouves ta forme et que nous soyons ensemble.
— Je ne te laisserai plus jamais partir.
— Je n’ai pas l’intention de le faire.
— Nico, tu es un sacré bonhomme. Ton propriétaire a raison, un homme c’est un mec qui sait s’occuper de ceux qui comptent pour lui. Je sais que je compte pour toi, et je vois comment tu t’occupes de moi. Tu as des couilles, Nico, pour me supporter comme tu le fais.
C’est l’un des plus beaux compliments que l’on ne m’a jamais fait de ma vie. Et ça vient de Jérém. Je suis tellement heureux !
Tant que nous sommes lancés dans les confidences, j’en profite pour lui poser une autre question qui me brûle les lèvres depuis des mois.
— Le soir du Nouvel An, tu as essayé de m’appeler…
— Oui…
— Tu t’étais trompé ou tu avais regretté de l’avoir fait ?
— Ce soir-là, tu me manquais trop. Mais quand je suis tombé sur ton répondeur, je me suis dit que tu m’avais oublié, et que tu étais retourné avec ce gars de Bordeaux.
— C’est pour ça que tu n’as pas répondu à mes rappels et à mes messages ?
— Je me suis dit que je devais arrêter de foutre ta vie en l’air.
— J’aurais tellement aimé que tu répondes et que tu me dises que je te manquais.
— Et tu aurais fait quoi ? On était loin l’un de l’autre et…
— Je pense que je serais venu te rejoindre sur le champ !
— Mais tu n’étais pas avec ce gars ?
— Si, j’étais avec lui. Mais je n’ai pas arrêté de penser à toi pendant toute la soirée, et au réveillon à Campan de l’année dernière.
— Moi aussi je n’ai pas arrêté de penser à toi et au réveillon à Campan de l’année dernière !
— Quel gâchis ! je commente.
— C’est clair !
— Et tu en es où avec ce gars ?
— Je suis là, avec toi, Jérém. Je l’ai quitté quand je lui ai dit que je partais à Paris pour être avec toi après ton accident.
— Tu étais amoureux de ce gars ?
— Non. Quand j’étais avec lui, j’arrivais parfois à me cacher à quel point j’avais mal d’être séparé de toi. Être avec lui c’était une sorte de répit. Mais je n’ai jamais arrêté de penser à toi, jamais !
— Je te demande pardon aussi pour ce que je t’ai dit à l’hôpital à Paris. C’est pas vrai que je ne t’ai jamais aimé. Je ne le pensais pas, j’étais juste en colère.
Ce n’est pas un « je t’aime » franc, mais ne dit-on pas que le résultat d’une double négation est une affirmation ? Et même cette double négation me va droit au cœur.
— Je sais, je sais. Je t’aime aussi, Jérémie Tommasi !
Cette nuit encore, nous partageons beaucoup de tendresse, mais toujours pas de sensualité. Jérém semble réfractaire à toute caresse érotique. Lorsque j’essaie de passer mes mains sous son t-shirt, ou de caresser ses tétons par-dessus le coton, il trouve toujours un prétexte – l’envie d’une cigarette, une crampe, le besoin d’aller au petit coin, un cachet à avaler – pour s’éloigner.
Jérém n’est pas en demande de sexe. Je suis frustré, mais pas inquiet. Je ne suis plus inquiet. Je ne le suis plus depuis que j’en ai parlé avec Thibault.
— J’ai vécu la même chose quand j’ai eu mon accident il y a deux ans. Panne de libido totale. Je bandais plus. Mon médecin m’a dit que c’était courant après un traumatisme. Un traumatisme entraîne de la fatigue, la peur pour l’avenir, la déprime. Et les médocs n’arrangent rien non plus de ce côté-là. Il ne faut surtout pas lui mettre la pression, car il doit déjà bien se la mettre tout seul. Il faut juste lui laisser du temps, et ça va finir par s’arranger.
Je pense chaque jour aux mots de Thibault, et surtout à la nécessité de ne pas brusquer les choses. J’attends patiemment que le « bon moment » arrive.
Vendredi 25 avril 2003.
Ce matin, je me suis fait gauler en train de quitter la chambre de Jérém par l’une des infirmières de nuit, une nana plutôt sympa qui répond au prénom de Laetitia. Après m’avoir fait un petit rappel des uses et coutumes du Centre, elle conclut :
Tu peux dormir là quand je suis de garde. Tu te pointes discretos après 22 heures, et tu te tires tout aussi discretos avant 7 heures, avant le changement d’équipe et avant l’arrivée des médecins « lève tôt ». Il te suffit de regarder le planning.
Cette main tendue me met du baume au cœur.
Ce soir-là, Laetitia est à nouveau de garde.
Ce soir-là, alors que je reviens de la salle de bain après m’être brossé les dents, je trouve Jérém allongé sur le lit, devant la télé, en boxer. Son beau torse délicieusement poilu, ses pecs saillants et ses tétons, ainsi que la bosse saillante qui remplit la poche de son boxer aimantent mon regard et mon désir. Devant cette attitude, devant le regard qu’il me lance et dans lequel il me semble retrouver une petite étincelle lubrique, je me dis que le « bon moment » est enfin arrivé.
Ce désir que je vois dans son regard embrase instantanément le mien. J’ai envie de lui donner du plaisir. J’ai envie de le prendre en bouche et de le rendre dingue.
Je m’approche de lui, je me glisse entre ses cuisses. Je m’allonge sur lui, je le caresse, je l’embrasse, j’excite ses tétons. J’ai l’impression qu’il est un brin tendu, mais il se laisse faire. Rapidement, j’envoie ma bouche parcourir les reliefs saillants de son beau torse. Je plonge mon nez, ma bouche, mon visage entre ses pecs, entre ses poils. J’atterris sur ses abdos. Je m’enivre de la douceur intensément érotique des petits poils qui dessinent cette ligne droite qui descend de son nombril, s’abime derrière l’élastique de son boxer, et entraîne mon regard et mon désir tout droit vers sa virilité. Les petites odeurs de propre, de gel douche et de petit mec qui émanent de son boxer me rendent dingue.
Je laisse mes lèvres parcourir le tissu fin de son boxer, impatient de trouver sa queue raide emprisonnée par le coton.
Mais il n’en est rien, Jérém ne bande pas.
Je ne me décourage point. Je descends le boxer, je la retrouve enfin, après tant de mois. Belle, même au repos. J’approche mon nez de ses couilles, ça sent délicieusement bon.
Je la prends en bouche, et pendant un bon petit moment, je m’affaire avec entrain pour la réveiller. Mais rien ne se passe. Je tente le tout pour tout, je lèche ses couilles, je pousse jusqu’à sa rondelle, je la titille longuement avec ma langue. Je suis confiant, je sais que ça, ça l’a toujours rendu dingue.
Mais ma confiance est douchée au fil des minutes. Je n’arrive à obtenir aucune réaction. Jérém ne bande toujours pas.
— Laisse tomber, Nico.
Mais je ne l’écoute pas. Je redouble l’intensité de mes caresses, j’agace ses tétons, j’envoie ma langue s’occuper de son gland à bloc.
— Arrête, je ne vais pas y arriver, il me balance plus sèchement, et s’écartant de moi.
— On fera ça une autre fois, je tente de relativiser.
— Peut-être que ça aussi, c’est fini pour moi ! il fait, amer, en s’allumant une cigarette déjà à moitié fumée.
— Ne dis pas n’importe quoi ! Après tout ce qui t’est arrivé, c’est normal d’avoir des séquelles pendant quelque temps. J’ai entendu dire que ce genre de chose arrive après un traumatisme… Mais tout va finir par s’arranger, j’en suis certain !
Je voudrais lui dire que Thibault en est passé par là, et que tout s’est arrangé. Mais je ne veux pas prendre le risque qu’il prenne mal le fait que j’ai parlé à son pote de ses problèmes.
Mais mes mots ne semblent pas l’apaiser. Jérém fume sa cigarette lentement, en silence. Il a l’air frustré et déçu.
— Rien ne presse, Jérém, vraiment. Je n’aurais pas dû te proposer ça ce soir, c’est certainement trop tôt…
— Mais j’en avais envie, putain ! il s’exclame, sur un ton dépité. Mais ma queue ne marche plus.
— Quand tu iras mieux, tout s’arrangera, tu verras. Pour l’instant, concentre-toi sur ta rééducation.
— Tu vas pas m’aimer longtemps avec la queue en panne…
— Je t’aime comme tu es, Jérémie Tommasi !
Jérém revient au lit et s’allonge, tourné sur le flanc. Ce soir, je n’ai pas droit à d’autres bisous. Je m’approche de lui, je le prends dans mes bras et je le serre très fort contre moi.
Samedi 26 avril 2003, midi.
A la sortie de ses séances de ce matin, Jérém a à nouveau l’air détendu et de bonne humeur. Visiblement, la rééducation se passe de mieux en mieux. Mais j’ai l’impression qu’il y a autre chose. Je pense que le fait d’avoir mis des mots sur ses problèmes d’érection, et d’avoir senti que je le soutiens dans cette épreuve aussi, ça lui a fait du bien.
Les choses ont l’air de prendre un pli positif et je m’en réjouis. Je suis tellement heureux que je dois me faire violence pour ne pas l’embrasser là, sur le champ, dans la salle commune, alors que plusieurs personnes nous entourent.
Je rentre à la maison, j’écoute deux fois le CD d’American life. J’aime vraiment beaucoup. Je l’aime d’autant plus que ses chansons sont en train de se lier à des sensations d’espoir vis-à-vis de l’état de Jérém, ainsi qu’à des souvenirs pleins de tendresse vis-à-vis de notre amour.
Dimanche 27 avril 2003, 16h49.
C’est là, juste au moment où l’horizon semble se dégager, qu’un nouveau désastre survient.
Ce soir-là, pile au moment où je m’apprête à quitter mon appart pour aller retrouver Jérém après ses exercices de l’après-midi, mon portable se met à sonner. Lorsque je regarde l’écran et que je vois s’afficher le numéro du Centre, je ressens une profonde inquiétude s’emparer de moi. C’est la première fois que ça arrive. Au fond de moi, je sais immédiatement que ça ne sent pas bon.
Je décroche, assommé par un très mauvais pressentiment.
L’infirmière que j’ai à l’autre fil m’annonce que suite à un accident, Mr Tommasi est en train de passer des examens. Je suis à présent mort d’inquiétude et d’angoisse. J’essaie d’en savoir plus, mais l’infirmière ne peut pas m’aider et me renvoie vers le médecin en charge du patient.
Je quitte l’appart et je trace sur la plage comme un fou.
— Mr Tommasi était sur le tapis, il faisait de la petite course, et à un moment il a accusé de très fortes douleurs au niveau de la cheville, m’explique le praticien.
— Mais qu’est-ce qui s’est passé ?
— Les examens sont formels. Il a été victime d’une rupture itérative du tendon d’Achille.
— C’est quoi rupture itérative ?
— En gros, la réparation n’a pas tenu, et il a cassé à nouveau…
— OH, NON !!! je me désole.
J’ai l’impression de chuter du haut d’un immeuble de 100 étages. Le ciel qui semblait se dégager, me tombe sur la tête.
— Ces derniers jours je le voyais plus optimiste et impliqué. Mais aussi plus impatient. Je lui ai dit de ne pas trop forcer, je lui ai dit que le tendon était encore fragile. Mais il n’y a pas eu moyen.
C’est horrible. Cette catastrophe arrive justement au moment où Jérém recommençait à reprendre confiance, à se faire confiance. Il doit être encore plus mal qu’après le premier accident. Là, c’est retour à la case départ. Quel dommage, alors qu’il était si heureux de progresser ! Jérém doit à nouveau être à ramasser à la petite cuillère. Comment vais-je faire, maintenant, pour lui redonner espoir ?
— Et quelle va être la suite ? je veux savoir.
— Une nouvelle opération est nécessaire.
Je m’en doutais, mais j’avais espéré une solution magique. Et le fait d’entendre le médecin doucher mon illusion me plonge dans une tristesse infinie.
— Vous pensez l’opérer quand ?
— Je ne pourrais pas l’opérer…
— Comment ça ? je tombe des nues.
— La première intervention n’a pas été réalisée ici. Et nous ne pouvons pas prendre le risque d’aller à l’encontre de complications qui pourraient découler d’une opération précédente que nous n’avons pas effectuée. Si jamais ça se passe mal, les assurances ne nous couvriraient pas.
— Mais on s’en fout des assurances ! Je m’emporte.
— Non, on ne s’en fout pas. Cette deuxième opération est très risquée, plus que la première. Le résultat est incertain. Si on se rate sur un sportif de cette valeur, le club va nous tomber dessus avec ses avocats.
En entendant le chirurgien parler d’assurances, d’avocats, de « sportif de cette valeur », ça me donne envie de gerber.
— Mais putain, quand je vous écoute parler, j’ai l’impression de vous entendre discuter d’une putain de bagnole accidentée et non pas d’un garçon blessé qu’il faut soigner au mieux.
— Je sais, c’est triste. Mais j’ai des comptes à rendre, et il en va de la réputation du Centre.
— Et qui va l’opérer, alors ?
— Le chirurgien parisien qui a effectué la première opération, j’imagine. Nous sommes en train d’organiser le rapatriement à Paris en urgence. Il faut l’opérer au plus vite si on veut avoir une chance que ça marche.
— Et quelles sont les chances que cette nouvelle opération marche ?
— Je ne peux pas me prononcer officiellement. Mais, entre nous, elles sont très minces.
Ce que je viens d’entendre me déchire les tripes, c’est un coup de massue qui m’assomme. Le staff du Stade a été averti du nouvel accident de Jérém. Mais, en attendant de pouvoir aller le voir, la triste tâche de l’annoncer aux proches m’incombe.
J’appelle Maxime, Thibault, Ulysse, Papa. Ils sont tous tout autant dépités que moi.
En début de soirée, je peux enfin voir Jérém. Il est allongé sur le lit, le regard perdu. Il a l’air complétement défait. J’appréhende son humeur, son état d’esprit. Je sais qu’après ce nouvel accident il a reperdu tout espoir. Et je sais qu’il a besoin d’en retrouver au plus vite. Mais je sais aussi qu’essayer de lui redonner espoir sans me faire jeter, ça va être un sacré numéro d’équilibriste.
— Salut, je lui lance timidement.
— Salut, il me répond machinalement, sans presque me regarder.
Le ton de sa voix est bas, froid, dépourvu de toute émotion. Jérém a l’air vidé, éteint. J’hésite, je cherche les bons mots à utiliser pour savoir comment il va, sans pour autant lui donner l’occasion de me balancer l’évidence à la figure et de me faire jeter. Mais je n’ai pas besoin de chercher bien longtemps.
— Je suis foutu, cette fois-ci je suis vraiment foutu ! il me balance, en larmes.
— Ne dis pas ça. Ils vont t’opérer à nouveau, et cette fois-ci, ça va marcher, je tente de lui apporter du positif, tout en m’approchant pour le prendre dans mes bras.
Mais je sens qu’il n’est pas d’humeur. Je le sens à fleur de peau, et j’ai peur qu’il me jette au premier contact.
— Je ne me ferai pas charcuter à nouveau ! il rugit.
— Et tu vas faire comment pour récupérer ?
— Je vais rester comme ça.
— Mais tu seras diminué, et tu ne pourras plus jouer.
— Le rugby c’est fini pour moi. De toute façon, je l’ai su au moment même où le mec m’a percuté pendant le match.
— Mais la rééducation se passait bien, tu commençais à récupérer…
— J’ai voulu me voiler la face. Mais j’ai toujours su que ça se terminerait comme ça, il me balance, de plus en plus en colère.
— Tu es sous le choc, et je le comprends. Mais il faut continuer à y croire. Moi j’y crois, et je serai toujours là pour te soutenir, je tente de le réconforter.
Le voir pleurer me fait un mal de chien. Je tente de lui faire sentir ma proximité et mon empathie en le prenant dans mes bras. Mais le rejet que je redoutais tant finit par tomber.
— Putain, mais lâche-moi ! Casse-toi, Nico, casse-toi ! Casse-toi et fiche-moi la paix pour de bon !Merci à FanB pour les corrections.
Merci à Yann pour l'animation ci-dessus.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui lisent cette histoire, avec une mention spéciale pour celles et ceux qui ont commenté ou qui commenteront.
 12 commentaires
12 commentaires
-
Par fab75du31 le 31 Août 2022 à 17:22
Chers lecteurs, chères lectrices,
suite à la demande d’un lecteur concernant la possibilité de participer de façon discrète au financement de l'écriture de Jérém&Nico, je précise qu'il est possible de faire ça la plus discrètement du monde en cliquant sur le bouton "PAYPAL Ajouter au panier" dans la colonne à droite de ce site (il faut remonter en haut de la page pour le voir).Ou en cliquant ici même :
 financer Jérém&Nico sans inscription, en toute discrétion, en cliquant sur ce bouton :
financer Jérém&Nico sans inscription, en toute discrétion, en cliquant sur ce bouton :Ceux qui ont un compte PAYPAL seront alors redirigés vers la page de connexion PAYPAL. Le montant du don est libre, et c'est un don unique. Sur le révélé de banque, ce don apparaîtra simplement comme PAYPAL, sans aucune mention de Jérém&Nico.
Merci d'avance pour votre aide.Et bien sûr, les commentaires, même courts, sont toujours les bienvenus.
Fabien0321 Sous les vents redoutables, le Roseau plie…
Mars 2003.
[Tu étais sur une lancée magique, Jérémie Tommasi, et tout te réussissait. Pendant les matches, tu marquais des points à tour de bras. Tes coéquipiers t’admiraient, tes adversaires te redoutaient, le public du stade vibrait à chacun de tes essais. Et ça te donnait comme une sorte de délicieuse ivresse qui te portait, qui te donnait des ailes, qui te poussait à te surpasser, à aller toujours plus loin.
Sur le terrain, tu te sentais bien. Parce que tu te sentais à ta place. Parce que pendant deux fois quarante minutes, tu étais Tommasi12, un gars avec qui la moitié de la France voudrait jouer au rugby et être pote, et l’autre moitié coucher avec.
Sur le terrain, tu n’étais que puissance, aisance, talent insolent. Tu étais l’incarnation de l’image que tu voulais donner de toi. Tu construisais ta légende personnelle match après match. On t’annonçait une carrière fulgurante. Certains te prédisaient même des matches en équipe nationale dès l’année prochaine.
Chaque samedi, l’espace de deux ou trois mi-temps, tu oubliais tes doutes, tes interrogations, tes blessures. La peur qu’on découvre ton secret. Tu te sentais tout puissant, tu te sentais invincible, inarrêtable. Tu te sentais immortel. Et cette sensation était la plus grisante de toutes.
Mais ton bel élan et tes faux sentiments de toute puissance ont été stoppés net, un samedi de mars, à quelques minutes de la fin de la mi-temps. Tu t’étais envolé, tu étais monté très haut. Et soudain, tu es redescendu sur terre, brutalement, au sens propre comme au sens figuré. Et ça a fait un mal de chien. La douleur physique et morale a été insoutenable.
Aujourd’hui, tu es fracassé, dans ta chair et dans ton esprit. On t’annonce de longs mois de rééducation, loin du rugby. Huit mois, dans le meilleur des cas, loin de tout ce qui fait le sel de ta vie.
Huit mois, ça te paraît une éternité. Hier encore tu étais une star sportive montante, dans huit mois tu ne seras plus personne. Tu vas te démuscler, et beaucoup plus vite que tu t’es musclé. Tu vas perdre tous tes atouts. En huit mois, l’équipe va apprendre à se passer de toi. En huit mois, tout le monde va t’oublier. Tes coéquipiers, tes supporters, la direction de l’équipe. Ton contrat de joueur va-t-il seulement être renouvelé à la fin de la saison, alors que tu ne seras toujours pas revenu sur le terrain ?
A quoi bon, au fond, puisque tu te dis que tu ne reviendras jamais au niveau d’avant ! Tu te dis que tes blessures sont trop graves. Et que même si tout se passe bien, tes tendons ne seront plus jamais aussi résistants qu’avant l’accident. Et même s’ils l’étaient, le souvenir de la douleur que tu as ressentie te tétanise. Tu ne veux plus jamais ressentir cette douleur atroce. Tu ne sais même plus si tu vas oser courir à nouveau un jour.
Et encore moins jouer au rugby. Car depuis cet accident quelque chose a cassé dans ta tête. Jusqu’à ce jour, le contact avec les adversaires ne t’a jamais fait peur. Tu y allais avec insouciance, avec inconscience.
Aujourd’hui, tu réalises que ton corps est fait lui aussi de chair, d’os et de sang. Tu réalises qu’il est précieux, car il est fragile. Ce n’est que maintenant, trop tard, après cet accident qui remet tout en question, qui bouche ton horizon, que tu réalises le danger que tu courais à chaque action de match, à chaque entraînement.
Certes, tu avais entendu parler de joueurs blessés, de convalescences qui s’étirent, de joueurs qui ne reviennent jamais au niveau d’avant, tu as entendu parler de carrières brisées. Mais l’inconscience de ta jeunesse t’a toujours amené à penser que cela n’arriverait qu’aux autres.
Et puis, sans crier gare, c’est arrivé à toi. Et ça t’a conduit là où tu es maintenant, immobilisé dans ton canapé, en train de déprimer à fond. Tu sais que tu ne reviendras pas au rugby si tu es diminué, tu ne veux pas finir à jouer dans une petite équipe.
Alors, tu te dis que le sport professionnel c’est fini pour toi. Et cela te plonge dans une immense détresse. Car, après avoir goûté pendant un an et demi au monde étincelant du rugby, la perspective d’une vie ordinaire avec un petit boulot ça te fiche les boules.
Oui, si le rugby c’est fini pour toi, qu’est-ce qu’il te reste dans ta vie ? A quel rêve, à quelle ivresse tu vas pouvoir t’accrocher désormais pour faire taire tes démons intérieurs ?]
Jeudi 27 mars 2003, au soir.
C’est dur de voir Jérémie pleurer. Ses larmes passent de ses joues aux miennes, et elles me transmettent toute sa souffrance. Une souffrance refoulée, pleine de colère, une colère pleine de désespoir.
— Va-t’en, Nico, pars loin d’ici. Tu vois pas que je suis en train de couler ? Ne coule pas avec moi !
— Je ne partirai que quand tu iras mieux. Et personne ne coulera. Je te promets que tu iras mieux. Je te promets qu’un jour tu joueras à nouveau au rugby et encore mieux qu’avant l’accident. Je te promets qu’un jour tu gagneras le Top16 avec le Stade. Mais pour ça, il faut y croire. Pour cela, il faut continuer à croire en tes rêves.
Oui, je sais que je distribue de l’espoir à crédit, à découvert, sans prendre aucune garantie, en encourant un risque fou. Mais en voyant Jérémie dans cet état je ne peux faire autrement que lui donner quelque chose à quoi s’accrocher, coûte que coûte. J'ai besoin d'y croire et je veux qu'il commence à l'envisager.
Je pense aux mots du chirurgien du train :
« Et surtout, il faut s’arranger pour qu’il n’arrête jamais d’y croire, même s’il prétend le contraire. Car l’espoir est l’élément clé de la guérison. Il n’est bien évidemment pas suffisant, mais il est terriblement nécessaire. »
— Tout est possible, pourvu qu’on continue à rêver, je lui glisse, alors que mes sanglots se mélangent aux siens.
Les joues de Jérém sont encore humides lorsque Thibault et Maxime rentrent à l’appart. Le petit brun s’en rend compte. Il prétend avoir oublié de prendre le courrier, tout en faisant disparaître en catastrophe les enveloppes qu’il tenait à la main dans la poche arrière de son jeans. Quant à Thibault, il avance avoir oublié de faire des courses. Les deux adorables petits mecs quittent fissa l’appart, pour me laisser un peu plus de temps pour sécher les larmes de Jérém.
Ce soir-là, Thibault et moi prenons une chambre dans un hôtel. Elle comporte deux lits jumeaux, mais très vite nous les rapprochons pour nous câliner.
— Ça me fend le cœur de le voir dans cet état, me glisse Thibault, alors que ses gros bras me pressent contre son torse puissant et chaud.
— A moi aussi ça me fend le cœur, il est tellement abîmé !
— C’est vrai que tu peux passer du temps avec lui ? il me questionne.
— Oui, je peux, et j’en ai envie.
— Tu t’en sens le courage ?
— Je ne sais pas, mais j’ai envie d’essayer.
— Il faut être très fort, Nico…
— Je sais.
— Tu es sûr que ça ne va pas interférer avec tes études ?
— Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Je pense que mes camarades peuvent m’aider.
— Tu es vraiment un chouette gars, Nico.
— Toi aussi Thibault, tu es un gars en or.
— Ce qui me fait peur, c’est quand il va se retrouver seul à Capbreton. J’ai peur qu’il n’y mette pas tout son cœur, et qu’il ne fasse pas tout ce qu’il faut pour récupérer.
— J’aimerais pouvoir être à ses côtés quand il sera là-bas, mais je n’ai aucune idée de comment faire, j’avance.
— Si tu es vraiment sûr que tu peux passer du temps avec lui, je te propose quelque chose.
— Dis-moi…
— Je te paie le séjour à Capbreton. Tu prends une chambre ou un appart là-bas, et je règle tous les frais pendant tout le temps que tu seras à côté de Jé.
— Mais Thibault ! je m’exclame, touché pas sa générosité, ému par sa bonté.
— Il n’y a pas de « mais ». Si tu es prêt à t’occuper de lui, je peux te faciliter la tâche, et je veux te faciliter la tâche. Mais je te préviens que ça ne va pas être facile, il ajoute aussitôt. Les jours qui t’attendent ne vont pas être de tout repos. Il est démoli à l’intérieur, et il voit tout en noir. Il va te rendre malade, parce qu’il va très mal. Mais il a besoin de toi, même s’il va toujours prétendre le contraire.
L’admiration et l’immense tendresse inspirées par la grandeur d’esprit que Thibault vient de me montrer une fois de plus, n’ont jamais été si débordantes, si fortes à m’en donner des larmes. J’ai envie de lui, j’ai envie de faire l’amour avec lui. J’ai envie de lui offrir tout le plaisir qu’il mérite. J’ai envie de le câliner, j’ai envie d’offrir à cet adorable garçon toute la douceur qu’il mérite. Et putain je sais, à quel point il la mérite !
Thibault un véritable puits à câlins, un véritable aimant à bisous. Cette nuit, je lui donne toute la tendresse dont il a besoin, qui n’est sans doute qu’une fraction de celle qu’il m’inspire.
Nous savons le désir que nous partageons. Mais cette nuit la présence de l’autre nous suffit pour nous faire nous sentir bien.
Samedi 29 mars 2003.
Thibault et Maxime restent un jour de plus et rentrent à Toulouse dans le week-end. Quant à moi, je reste avec Jérém. Je reste malgré le fait qu’après notre rapprochement du premier soir, malgré qu’il ait accepté que je m’installe chez lui pour quelques jours pour permettre à Maxime de rentrer à Toulouse, Jérém s’est montré assez distant et froid. La cohabitation ne s’annonce pas vraiment sous les meilleurs auspices. Mais je prends sur moi, et j’essaie de garder un peu d’optimisme quant au fait que ça va s’arranger.
— J’attends ton RIB, me glisse discrètement Thibault, en me prenant dans ses bras, avant de partir. Et si c’est trop dur, tu m’appelles. Je viendrai vous voir, s’il le faut je ferai l’aller-retour dans la nuit.
Ce garçon est vraiment, vraiment adorable.
Début avril 2003.
Entendre raconter la détresse de Jérém par Maxime et la vivre en première ligne, au quotidien, ce sont deux choses complètement différentes. La tâche est ardue, et ça demande beaucoup d’énergie. De l’énergie mentale, morale en particulier.
En plus de son inquiétude pour son avenir au rugby qui se traduit par une mauvaise humeur constante et indécrottable, Jérém semble toujours essuyer les conséquences de son traumatisme crânien. Comme me l’avait annoncé Maxime au téléphone, mon beau brun souffre d’insomnies. Le peu qu’il dort, il dort mal, et il ne récupère jamais de sa fatigue qui commence à devenir chronique. Il sommeille toutes ses journées affalé sur le canapé, assommé par les médocs, l’air vidé de toute énergie. Il boit des bières, il fume. Le mal de tête ne le lâche jamais, il prend cachets sur cachets, il a toujours aussi mal. Il est très sensible à la lumière. Aussi, nous vivons dans la pénombre, et c’est lugubre. Le manque de lumière ne joue pas en faveur du moral. Son ouïe est hypersensible, et il m’engueule à chaque bruit un peu brusque dont je suis l’auteur.
Il est très irritable, et le peu que nous échangeons, je le trouve perdu, nerveux, parfois confus. Il a du mal à penser et réfléchir, et cela semble lui demander un effort immense. Aussi, il semble avoir du mal à se souvenir de certaines choses.
Et les innombrables cigarettes, joints, calmants et bières qu’il siffle chaque jour n’arrangent rien. L’accès permanent à ces Paradis Artificiels contribue à le maintenir dans le coltard, à étourdir ses capacités intellectuelles, à empêcher son esprit d’affronter la réalité, de reprendre sa vie en main, de puiser au plus profond de lui l’énergie pour rebondir.
J’ai beau lui dire que tout ce mélange peut être dangereux pour sa santé et que ça peut compromettre son rétablissement. Il m’envoie bouler en disant qu’il n’y aura pas de rétablissement.
Lorsque je le regarde, lorsque je l’entends parler, déprimer, je vois un garçon brisé. Quand je pense à la fierté qui brillait dans ses yeux lorsqu’il jouait et qu'il marquait un but, je ne reconnais plus le garçon renfermé et éteint qui est là sous mes yeux.
Je sens que quelque chose s’est brisé au fond de lui, quelque chose d’important, d’essentiel, de vital, même. Je crois que c’est le rêve de sa vie qui s’est brisé. Et il n’y a pas de douleur plus insoutenable que celle provoquée par un rêve qui se brise.
Je voudrais trouver les mots pour l’aider à aller mieux, mais je ne sais pas par où commencer. D’autant plus que dès que j’ose aborder le sujet « accident » ou « blessures » ou essayer de l’encourager, je me fais remballer comme un malpropre.
La dernière chose que je veux en ce moment c’est m’engueuler avec lui. Il n’a pas besoin de ça, et moi non plus. J’ai besoin de mettre toutes les chances de mon côté pour tenir le coup, et surtout ne pas me faire mettre à la porte. Mais à quoi bon rester avec lui si je ne peux l’aider à aller mieux ?
J’ai du mal à tenir le coup. Je tiens en prenant sur moi, je prends sur moi en repensant aux mots du chirurgien dans le train à propos de la souffrance du sportif blessé.
« J’ai vu passer pas mal de jeunes sportifs sur mon billard, rugbymen, footballeurs, handballeurs, avec des blessures graves. Et je peux vous dire que ceux qui s’en sont sortis, ce sont ceux qui ont eu du soutien pendant toute la durée de la rééducation. Il ne faut pas le lâcher, même s’il devient odieux. S’ils deviennent invivables, c’est parce qu’ils souffrent, et ils souffrent parce qu’ils ont peur d’avoir tout perdu. Il faut être forts. Il faut l’être pour vous, et pour lui. »
Je repense aussi aux mots d’Ulysse.
« Sous le vent contraire, le Chêne tente de résister et se fait déraciner. Alors que le Roseau plie, mais il tient bon, il récite par cœur. Sois Roseau, Nico ! La tempête va arriver, mais elle repartira. Et tu seras toujours debout après son passage. »
J’essaie, mais c’est tout sauf évident.
En attendant, je fais tout ce que je peux pour lui faciliter la vie. Je l’aide à se lever, même s’il ne voulait pas au début, à s’habiller. Je vais faire ses courses, y compris le shit (très beau garçon que son dealer, j’ai tellement envie de lui dire de changer de métier !), je lui fais à manger, je fais le ménage. J’œuvre discrètement. J’essaie d’être là pour lui, tout en me protégeant.
Malgré cela, ces quelques premiers jours de cohabitation se révèlent particulièrement difficiles. Jérém est sacrement amoché, meurtri par la vie. Il est en permanence sur les nerfs, et un rien suffit pour le faire exploser. Il peut être très blessant. Il peut aussi pleurer, parfois. Et là, inutile de penser à le prendre dans mes bras pour essayer de l’apaiser, sous peine de me faire encore jeter méchamment. Il vaut mieux que je parte dans la pièce d’à côté en attendant que ça passe. Ça me fend le cœur de ne rien pouvoir faire pour lui. Et je pleure de mon côté à chaudes larmes.
C’est dur, vraiment dur. Mais c’est décidé, je resterai à ses côtés malgré son humeur de chien rageur, à essayer de l’aimer malgré lui.
Le fait est que la mauvaise humeur, la morosité et le pessimisme sont des bêtes salement contagieuses. Je regarde Jérém se noyer jour après jour et j’ai l’impression qu’il m’entraîne vers le fond avec lui. Je réalise qu’il avait raison le soir où il m’avait dit qu’il était en train de couler. Et je réalise que quelque part, le fait de me dire de partir pour ne pas couler avec lui ressemblait à s’y méprendre à une preuve d’amour.
Alors je reste, bien qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'il me gueule dessus et qu'il m'ordonne de me casser et de lui foutre la paix.
Je sors tous les jours faire les courses, pour prendre l’air quand celui de l’appart devient trop irrespirable. Mais je pars la peur au ventre, et je rentre vite. Je ne peux me résoudre à le laisser seul plus qu’une demi-heure. Je n’arrive pas à me débarrasser de la peur qu’il puisse faire une connerie. Ma peur est peut-être infondée. Mais il est si mal que je préfère ne pas prendre le moindre risque.
Une infirmière vient chaque jour lui renouveler les pansements et l’aider à prendre soin de lui. Mathilde est une nana qui assume parfaitement ses rondeurs et qui a l’air on ne peut mieux dans ses baskets. Elle est dynamique et avenante. Elle est drôle et pétillante et sa venue est comme un rayon de soleil dans la triste monotonie de ces journées, de ce huis-clos qui devient de plus en plus pénible.
Chaque jour, elle fait ses observations positives sur la cicatrisation des blessures. Jérém fait mine de ne pas en faire cas. Ou balaie ses mots d’un revers de main. Pourtant, quelque chose me dit que le récit de cette évolution positive ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd.
Jour après jour, Mathilde garde son sourire malgré les réflexions chargées de pessimisme avec lesquelles Jérém réagit à ses encouragements.
En dehors de cette visite quotidienne, de ce rendez-vous à la fois amusant et rassurant, les seuls moments sereins ce sont ceux que nous passons en silence à jouer à la PS. C’est le seul moyen que j’ai trouvé pour partager du temps avec mon beau brun, sans le mettre en pétard, sans me faire jeter, le seul moyen pour l’obliger à faire un break cigarette-pétard-boisson.
Franchement, les jeux vidéo, et a fortiori des jeux vidéo de sports, ça m’intéresse autant que la sexualité des nanas. Mais je prends sur moi, je fais l’effort, je m’accoutume à cette activité que je perçois comme étant « contre nature ». J’apprends à jouer à FIFA pour le distraire. Je finis même par me défendre et même par lui mettre des raclées, lui qui jouait à FIFA déjà bien avant notre première révision.
Parfois j’y pense, pendant que nous jouons. Je pense à ce jour de mai d’il y a bientôt deux ans, où j’ai traversé une partie de la ville afin de réviser avec lui pour le bac. J’ai des frissons en repensant à son regard lubrique, à sa main qui attrape la mienne et qui la pose sur la bosse de son jeans. D’autres fois, en le revoyant debout, contre le mur, le t-shirt blanc taillant son torse comme un gant, la casquette à l’envers, la braguette ouverte, la bosse saillante, m’invitant à aller le sucer. Je vibre de nostalgie en repensant à la première fois où j’ai eu accès à sa virilité, la première fois où je l’ai pris en bouche. Et à ses mots : « Je vais jouir et tu vas tout avaler ». Et au bonheur avec lequel je m’étais exécuté.
Ce jour-là, il était aussi venu en moi, il m’avait possédé pour la toute première fois. Je découvrais un monde nouveau, fait d’un plaisir sensuel inouï.
Mais aussi de frustration. A la fin de cet après-midi de bonheur, alors que j’espérais un peu de tendresse, Jérém m’avait dit de partir et de fermer ma gueule au sujet de ce qui venait de se passer.
Je l’avais regardé, planté devant sa PS, en train de jouer à FIFA, la casquette à l’envers et torse nu, beau comme un Dieu. Un petit Dieu auquel j’avais offert tout le plaisir qu’il avait demandé.
Quand j’y pense, Jérém était un sacré petit con à l’époque, un petit macho imbu de sa queue et pour qui seul son plaisir comptait. Une sacrée tête à claques qui ne doutait de rien. Du moins en surface. En tout cas, à ce moment son effronterie était intacte, car une certaine insouciance l’était aussi.
Depuis qu’il est à Paris, j’ai l’impression que cette insouciance a été mise à rude épreuve par la pression liée à son statut, à son métier, à sa notoriété croissante. J’ai l’impression que la disparition progressive de l’insouciance est le lot que certains considèrent comme indissociable du package « Devenir adulte ». Ce qui est certain, c’est qu’elle a totalement disparu depuis son accident.
Je me sens nostalgique et ému par le souvenir de cette insouciance révolue, par le souvenir des révisions dans l’appart de la rue de la Colombette. A cette époque Jérém était certes un insupportable petit con. Mais il était serein, confiant en lui et en l’avenir. Tout ce qu’il n’est plus aujourd’hui. Je donnerais cher pour remonter le temps.
C’est pour cela que j’aime ces moments FIFA, car ils me ramènent au souvenir d’une époque somme toute heureuse (elle ne l’était pas totalement, mais le temps a dû commencer à faire le tri, je pense), et révolue.
Hélas, ces moments de partage ne durent jamais très longtemps, car la migraine finit toujours par revenir. Jérém est obligé parfois d’abandonner en pleine partie. Je le vois alors balancer sa manette, planter la partie, et s’affaler sur le canapé, l’air épuisé et souffrant.
En dehors de ces moments de détente, Jérém fume cigarette sur cigarette, pétard sur pétard, boit bière sur bière. Il mange peu, il dort beaucoup. Surtout le jour.
La nuit, Jérém dort dans son lit, et moi sur le canapé. J’ai trop peur de lui faire mal dans le sommeil.
Nous ne partageons plus aucun moment de tendresse. Et ça me manque terriblement. Je ne demande pas grand-chose. Une caresse, un baiser, une accolade me suffiraient pour me sentir moins seul, moins rejeté. Mais Jérém est très distant. Ça me rend malade. J’ai besoin de le toucher, de sentir sa présence avec mon corps, avec ma peau. J’essaie d’aller vers lui. Parfois, je passe ma main dans ses cheveux, je l’embrasse dans le cou furtivement. Mais il ne réagit pas. Je finis par avoir l’impression que ça le dérange plus qu’autre chose.
Le sexe me manque aussi. Je n’ose même pas aborder la question, de peur de me faire rembarrer méchamment. Bien sûr, il est convalescent, et j’attendrai autant qu’il faudra. J’en ai envie, et je me dis qu’il pourrait en avoir envie aussi, et que ça pourrait nous faire du bien. Je suis bien placé pour savoir à quel point un bon orgasme est capable d’apaiser un garçon.
Si je savais qu’il en a envie, je serais bien évidemment partant. Mais il ne manifeste aucun désir en ce sens. Alors, j’essaie de tâter le terrain sur le ton de l’humour. L’occasion se présente un soir, alors qu’il vient de passer de longues minutes à se faire sermonner au téléphone par son petit frère.
— Tu veux une glace ? je lui propose.
— Non !
— Une boisson ?
— Non !
— Un café ?
— Non !
— Une pipe ?
— Non plus.
— Une pipe, ça ne se refuse pas ! je tente de rigoler.
— Ça, tu oublies !
— Pourquoi tu dis ça ?
— Pour rien, laisse-moi tranquille.
— Je disais ça juste au cas tu en aies envie…
— J’ai pas envie !
— C’est pas grave, pas grave du tout, vraiment. Je rigolais !
Un long moment de silence suit ces derniers mots, un silence ponctué par plusieurs taffes de cigarette. Puis, après avoir écrasé son mégot, je l’entends me glisser, le regard ailleurs :
— Je n’ai pas bandé une seule fois depuis l’accident. Ça fait plus d’un mois, il précise.
Je n’avais pas soupçonné l’existence de ce point de frustration dans le corps et dans la tête de mon beau brun, un point qui doit se mélanger aux autres et les amplifier encore.
Jeudi 3 avril 2003.
Ça ne fait même pas une semaine que je cohabite avec Jérém, et j’étouffe. L’envie de partir est de plus en plus forte. Mais je ne peux pas le laisser tout seul. Dans trois jours il va partir à Capbreton, et je n’ai toujours pas trouvé l’occasion pour lui annoncer que j’envisage de l’accompagner.
Soudain, une idée traverse mon esprit. Je la peaufine au fil des heures.
Vendredi 4 avril 2003.
Et je la mets en pratique dès le lendemain.
— Ça te dit d’aller faire un tour en bagnole ? je lui balance en début de matinée, après le départ de Mathilde.
— Un tour où ?
— Il fait beau aujourd’hui, on pourrait faire une virée hors de Paris.
— T’as qu’à y aller seul.
— Je voudrais que tu viennes avec moi. Je pense que ça te ferait du bien de prendre l’air et de voir le soleil.
— Très peu pour moi.
— S’il te plaît, s’il te plaît, un tout petit tour. On sort de Paris, on se fait un resto, et on rentre pour la sieste. Je meurs d’envie de tester ta nouvelle bagnole, j’appuie mon propos pour le motiver.
— Tu me casses les couilles !
— Je t’aime moi aussi, je lui lance à contre-pied.
Quelques minutes plus tard, je m’installe au poste de conduite de sa belle allemande bleu métal.
— Elle est magnifique, on dirait une fusée !
— Vas-y mollo, c’est un petit bijou, et elle m’a coûté une petite fortune. Et si je ne joue plus, il y a de fortes chances que je doive la revendre.
— Tu ne la revendras pas, car tu n’en auras pas besoin.
— Roule et ferme-la ! il me balance, en s’allumant une clope.
Je démarre le petit bolide et je m’insère dans la circulation dense de la capitale. Le périphérique est saturé.
— Quelle connerie de prendre la route à cette heure-ci ! il râle dans son coin.
Je prends mon mal en patience et je finis par sortir de Paris. Le volant se laisse happer par la direction d’Orléans.
— Tu veux aller où, au juste ?
— Je ne sais pas encore. J’ai envie de rouler, cette bagnole est une pure merveille !
La belle allemande roule, roule, roule. A Orléans, elle réclame son dû. Nous nous arrêtons à une station-service pour faire le plein et boire un café. Je regarde mon téléphone et j’ai envie de pleureur de bonheur. Le SMS que j’attendais vient d’arriver. Tout est bon, la virée est bouclée. Pendant que nous buvons notre café, une bande de cinq mecs d’environ notre âge s’approche de nous, le regard rivé sur Jérém et sur ses béquilles.
— Tommasi ? C’est toi, tu es Tommasi ? l’interpelle l’un des mecs, un beau brun appartenant à la team « casquette à l’envers ».
— Non, c’est pas moi, fait Jérém, sur un ton vexé et peu engageant.
— Si c’est toi ! insiste le petit mec. Tu me signes ma casquette, s’il te plaît ?
— Je ne suis plus personne, je ne jouerai plus. Ma signature ne vaut plus rien, parce que c’est la signature d’un raté.
— Quand on a vu ce qui t’es arrivé à la télé, on était grave vener… ce type qui t’a dégommé, il l’a fait exprès, il mériterait qu’on lui casse la gueule !
— Ce qui est fait est fait, glisse Jérém, le regard fuyant et désabusé.
— Tu t’es fait opérer, mec ?
— Oui, j’ai du rafistolage partout.
— Tu reviens quand sur le terrain ?
— Jamais !
— Comment ça, jamais ?
— Les médecins tablent sur six mois de rééducation, j’avance.
— Les médecins ne savent rien !
— Tu vas revenir, et comment ! Tu es un magicien sur le terrain et tu nous emmènes avec toi quand tu marques un but. Tu n’as pas le droit de nous laisser en plan !
— La vie m’a laissé en plan…
— Toi t’es son pote ? s’adresse à moi le mec.
— Oui…
— Alors, tu le surveilles pour qu’il fasse tout comme il faut, pour qu’il revienne au plus vite et que tout se passe bien. Je te nomme responsable de son avenir au rugby. T’as intérêt à ce que tout se passe sans accrocs. Si ça foire, on te trouve et on te pète la gueule ! Eh, les gars, on lui pète la gueule s’il y a un problème ?
Ses potes acquiescent en rigolant.
Je sais que le gars plaisante. Mais en même temps, je ressens toute l’admiration qu’il éprouve pour Jérém et son souhait sincère de le voir revenir sur le terrain.
— C’est noté, je plaisante, à moitié amusé et à moitié ému par la spontanéité et la bienveillance de ce garçon.
— Tiens, signe la casquette, il insiste.
Jérém s’exécute en râlant. Il signe également un bout de papier, un ticket de métro, une boîte en carton contenant des chocolats.
— Ils étaient sympas ces gars, je lui lance, en reprenant l’autoroute.
— Surtout casse-couilles.
— Ça t’a pas fait plaisir d’être reconnu ?
— En ce moment, je m’en passe bien.
— Tu donnes de la joie à ces gars, et ils ont voulu te le montrer. J’ai trouvé ça très mignon.
Jérém ne répond pas. Mais quelque chose me dit que même s’il prétend le contraire, cette petite rencontre lui a mis du baume au cœur. Je le vois au fond de ses yeux, je le vois à cette étincelle, petite, faible, émoussée, mais bien présente, qui vient de s’allumer au fond de son regard.
La belle allemande semble désormais happée par la direction de Châteauroux.
— Tu vas me dire à la fin où tu veux aller ?
— J’ai envie de rouler, je reste vague. On va bientôt s’arrêter manger, puis on verra.
Nous prenons notre repas à proximité de Châteauroux. Jérém est taciturne et peu réactif aux efforts de conversation que j’essaie de faire. Pourvu que cette virée ne me pète pas à la figure. Il est 14h30 lorsque nous reprenons la route. La belle allemande semble toujours happée par le Sud.
— Il faut faire demi-tour, sinon on ne sera pas à Paris avant la nuit, me lance Jérém sur un ton agacé.
— Et pourquoi tu veux rentrer à Paris ?
— Parce que c’est chez moi !
— On pourrait dormir ailleurs…
— Mais où ?
— On va trouver !
— N’importe quoi ! Demain matin j’ai besoin de changer mes pansements, Mathilde va venir.
— Non, elle ne va pas venir.
— Comment ça ?
— Je lui ai dit que nous ne serions pas là.
— Et mes pansements ?
— J’en ai pris. Je l’ai regardé faire chaque jour et je peux me débrouiller.
— Ça me dit pas où tu veux aller dormir et à quoi ça rime toute cette route !
— Ça rime au plaisir de conduire cette merveilleuse bagnole, et à celui de t’entendre râler ailleurs que dans ton appart, et pour de nouvelles raisons !
— T’es con ! il me balance, un petit air amusé sur son visage.
— C’est la première fois…
— Quoi la première fois ?
— La première fois que je te vois sourire depuis l’accident.
— Je n’ai pas ri !
— Si tu as ri !
— Non, je te dis !
— Tu dis ce que tu veux. Moi, il m’a semblé te voir sourire. Et tu peux pas savoir combien ça me fait plaisir. J’aime tellement quand tu souris. Je t’aime, Jérémie Tommasi !
Nous faisons une nouvelle pause pipi café à proximité de Limoges. Le volant tient toujours le cap vers le Sud. Les panneaux TOULOUSE se font plus réguliers.
— Tu m’amènes à Toulouse ? me demande Jérém.
— Je t’amène quelque part.
Je ne peux pas encore lui dire qu’il chauffe, un peu.
Brives, Rocamadour, Cahors, Montauban, je laisse une à une ces villes derrière nous. TOULOUSE nous accueille. A l’approche de ma ville de naissance, le berceau de l’amour de ma vie, l’émotion me submerge. Toulouse, Papa, Maman, Elodie, vous me manquez, mais nos retrouvailles ne seront pas pour ce soir. Car la virée n’est pas terminée.
— Dis-moi où tu m’amènes, me glisse Jérém, alors que les sorties du périphérique défilent sous nos yeux.
— Tu vas vite comprendre.
La belle allemande quitte le périphérique et s’engage dans la direction Tarbes-Lourdes. Entre la sortie de Toulouse et le péage de Lestelle, Jérém demeure silencieux.
Ce n’est que lorsque nous avons passé la barrière que je l’entends me glisser :
— Tu sais que la maison va être froide et sale…
Ça me fait plaisir qu’il le prenne de cette façon. J’avais tellement peur qu’il me fasse un scandale !
— Qui t’a dit qu’on va à la maison ?
— Ah, voilà autre chose…
— Mais tu lui as dit au moins qu’on se pointait ? il enchaîne quelques instants plus tard.
— Oui, hier soir.
— Petit cachottier !
— Si je t’avais mis au courant, tu aurais dit non.
— C’est sûr.
— J’ai bien fait de ne rien dire alors !
— Il faut croire…
— Elle était tellement heureuse quand je lui ai annoncé que je t’amenais !
— Quel petit con tu es !
— Et toi non !
L’approche de Campan est elle aussi chargée d’émotion. Car ce petit village dans la montagne est l’endroit où j’ai depuis toujours été le plus heureux avec Jérém. Campan est notre refuge. C’est Jérém qui l’a dit un jour.
Il est près de 21 heures lorsque nous débarquons chez Charlène. Martine est là aussi. Les retrouvailles sont émouvantes. Les deux mamans de cœur de Jérém le serrent longtemps dans leurs bras, et elles pleurent de joie. Jérém pleure aussi. Mais cette fois-ci, j’ai l’impression que ses larmes le soulagent d’un grand poids.
Un bon petit dîner nous attend au coin du feu.
— Nico m’a prévenu un peu short, alors ce soir je n’ai pu rameuter que Martine, plaisante Charlène.
— Qu’un deuxième couteau, quoi, se marre l’adorable commerçante.
— Désolé, je glisse instinctivement.
— Ne le sois surtout pas ! Je suis tellement heureuse que tu aies eu cette idée ! J’imagine que vous êtes fatigués par la route et que vous avez envie de vous coucher de bonne heure. Mais demain soir, tu ne vas pas échapper à un bon gros repas au relais !
Évidemment, la conversation tourne longuement autour de l’accident de Jérém et sur l’avancement de sa guérison. Lorsque le jeune rugbyman évoque son départ prochain pour le Centre de rééducation de Capbreton, Charlène lui balance du tac-au-tac :
— Mais tu as quelqu’un qui t’accompagne là-bas ?
— Non, j’y vais seul.
Je ne lui ai toujours pas dit que j’ai prévu de le suivre à Capbreton. Charlène m’en offre l’occasion avec en prime un soutien prévisible qui ne sera pas de luxe. Un soutien dans lequel j’avais espéré en préparant ce voyage.
— Je pourrais t’accompagner, moi.
— Quoi ?
— Je peux rester quelques jours là-bas, le temps que tu prennes tes marques.
— Et tu vas crécher où ?
— Je prendrai une chambre.
— Et tu vas la payer comment ?
— J’ai un peu d’argent de côté…
— Voilà une riche idée ! s’exclame Martine. Au moins les premiers jours, le temps que tu t’habitues à ta nouvelle routine.
— Je me débrouillerai.
— Quand tu vas arriver là-bas, tu ne vas connaître personne, et tu ne vas voir que des gars accidentés comme toi, ou pire. Ça va te saper le moral. Tu n’auras pas de trop d’un visage connu, et de celui de ton petit copain qui plus est !
Jérém ne relève pas les derniers mots de Martine. Il ne les confirme pas. Mais il ne les infirme pas non plus. J’ai eu peur qu’il le fasse. Mais il ne l’a pas fait.
— D’ailleurs, si tu as besoin d’un peu de cash, je peux t’en filer, me lance Charlène.
— Je n’ai pas besoin de votre aumône ! s’exclame Jérém.
— Mais qui te parle d’aumône, espèce de petit con ! On veut seulement mettre toutes les chances de ton côté pour que ta rééducation se passe au mieux !
— J’ai assez d’argent pour rester quelques jours, je coupe court.
— Je ne t’ai jamais demandé de venir à Capbreton.
— Je sais. Je ne vais pas rester longtemps. De toute façon, tu vas finir par me rendre chèvre. Je vais rester quelques jours, une semaine au plus, je m’arrange avec la vérité. Et puis, si je ne viens pas, avec qui tu vas jouer à FIFA ?
Samedi 5 avril 2003.
Le lendemain soir, le relais accueille la foule des grandes occasions.
Une grande bannière composée d’autant de feuilles A4 que de lettres nécessaires pour composer le mot « Bienvenu, champion ! » est affichée sur le plus grand mur de la salle.
Tout le monde est là. Arielle avec sa spécialité, la quiche pas assez cuite. Martine avec sa bonne humeur contagieuse. Nadine avec son rire sonore et communicatif. Satine avec sa grande gueule. Les adorables aînés de l’asso, Ginette et Edmond, sont là aussi. Marie-Line et Bernard, collectionneurs de cas soc’ équins ont répondu également à l’invitation de Charlène. Daniel est là aussi, avec ses deux maîtresses, sa Lola et sa guitare. Loïc et Sylvain sont présents, et visiblement toujours ensemble. Je suis étonné de voir également Florian et son copain Victor. Vu l’animosité que nourrissait Florian vis-à-vis de son ex, je n’aurais jamais imaginé voir les deux couples dans une seule et unique pièce sans qu’il y ait du sang sur le dancefloor. Mais ainsi soit-il, tout est bien qui finit bien.
Jérém avance en s’aidant avec ses béquilles. Je me tiens derrière lui, au cas où il y aurait un souci, à cause des vertiges qu’il a parfois suite à son traumatisme crânien.
Jean-Paul, l’être le plus sage et bienveillant que je connaisse se tient devant la porte avec sa femme Carine, la nana la plus curieuse que je connaisse. Il a les yeux humides.
Dès que Jérém franchit le seuil, il le prend dans ses bras et le serre très fort contre lui.
— Salut, toi ! il lui glisse.
— Salut…
— Comment tu te sens ?
— Bien, maintenant que je suis ici, avec vous.
Je ne peux exprimer à quel point ces quelques mots me touchent.
— Et moi je suis heureux de te voir parmi nous. Bienvenu, Mr Tommasi !
— Putain, tu ne fais jamais les choses à moitié, lui balance Daniel en le prenant à son tour dans ses bras. Tu nous as fichu une trouille bleue encore une fois.
Chaque cavalier vient saluer le champion blessé à tour de rôle, et les « Comment ça va ? » pleuvent de toute part.
— Vous m’écoutez, s’il vous plaît une minute ? j’entends Jérém lever la voix à un moment pour attirer l’attention.
— Chut, chut, il va annoncer sa candidature à la présidentielle, plaisante Daniel.
— Ta gueule !
— Oui, merci ! Jé-ré-mie pré-si-dent ! Jé-ré-mie pré-si-dent ! Jé-ré-mie pré-si-dent !
— Mais tu la fermes un peu et le laisses parler, oui ? intervient Lola.
— Tu as oublié de prendre sa laisse, ce soir, non ? plaisante Satine.
— Je ne le dis qu’une fois et je ne le répéterai pas, reprend Jérém en donnant de la voix. J’ai été blessé et opéré aux ligaments croisés du genou et au tendon d’Achille. Apparemment, ça cicatrise bien. Je me suis cogné la tête sur le sol, et ça déconne encore un peu, mais ça a l’air de s’arranger aussi. Dans quelques jours, je vais en rééducation à Capbreton pendant quelques mois. Est-ce que je vais rejouer au rugby ? Je n’en sais foutrement rien. Inutile de me le demander ou de faire des pronostics. Je vous dirai quand je le saurai. En attendant, parlons de choses plus marrantes. J’en ai marre de parler bobos. Des tamalous, il y en a assez dans cette assos !
— Bien dit, fait Jean-Paul ! Jé-ré-mie pré-si-dent !
Toute l’assistance reprend le slogan lancé par Daniel et ça fait un joyeux bordel.
— Qu’est-ce qui se passe ici ? j’entends demander par une voix familière.
Maxime est là, et il n’est pas seul. Thibault a fait le déplacement avec lui.
Je n’oublierai jamais cette soirée. Cette première fois où, à la faveur de cette ambiance bienveillante et bon enfant dont cette assos a le secret, j’ai retrouvé un peu du Jérém d’avant l’accident. Un Jérém capable de sourire, de voir du positif, un Jérém plus apaisé. Un Jérém que je désespérais de pouvoir retrouver un jour. Je n’oublierai jamais les sourires que JP et Daniel ont pu lui tirer, les encouragements qu’ils ont pu lui apporter, et le regard ému et touché de Jérém.
Et ce que je n’oublierai jamais par-dessus tout, c’est le regard qu’il m’a lancé lorsque je l’ai rejoint à la cheminée, pendant qu’il fumait sa cigarette. Je n’oublierai jamais le « Merci » qu’il m’a glissé discrètement, les yeux humides, et sa main qui se pose sur ma nuque, ses doigts qui se glissent brièvement dans mes cheveux. Non, je n’oublierai jamais le premier geste de tendresse non seulement depuis l’accident, mais depuis notre séparation en décembre dernier.
Cette nuit, Jérém me manque beaucoup. Charlène nous a préparé deux chambres séparées pour laisser plus de place à Jérém. Quand la maison s’est tue, j’aurais voulu aller le rejoindre. Mais j’ai préféré le laisser se reposer. Il avait l’air si claqué, après toutes les émotions de la soirée ! Heureux, mais claqué.
Dimanche 6 avril 2003.
Demain, lundi, c’est je jour du départ de Jérém pour Capbreton. Avant de prendre la route ce dimanche, nous passons dire bonjour à Unico, Tequila et Bille. Charlène est très émue de voir Jérém répartir aussi vite.
— Vous auriez dû venir plus tôt ! elle nous gronde.
— Je n’avais pas le moral.
— Et ça va mieux maintenant ?
— On dirait…
— Prends bien soin de toi, mon grand. Et si ça ne va pas, appelle ta vieille copine ! Merci, Nico, de prendre si bien soin de lui.
Jérém demeure silencieux pratiquement jusqu’à Toulouse. Mais je suis heureux de voir qu’il a l’air bien plus dans son assiette que pendant le voyage aller. Ce bain d’affection, de tendresse, de bienveillance qu’ont su lui offrir ses amis cavaliers a l’air de lui avoir vraiment fait du bien.
— Tu es sûr de vouloir venir à Capbreton ? il me questionne de but en blanc.
— Sûr et certain.
— Tu vas louper tes cours.
— Je m’en fous.
— Mais pas moi !
— Tu loupes bien tes cours, toi !
— Moi je suis nul en cours, je suis un touriste à la fac. Mais toi, c’est du sérieux.
— Ma priorité, c’est toi, ta guérison.
— La fac devrait l’être aussi !
— J’ai pris des dispositions pour me faire aider par des camarades de cours. Et puis, Capbreton est à moins de deux heures de Bordeaux !
— Si ça se passe bien, tu pourras repartir.
Ah putain, qu’est ce que je suis heureux de l’entendre enfin envisager que ça pourrait bien se passer !
Je n’ai pas pu trouver, seul, le moyen pour rallumer cette flamme en lui, pour lui redonner l’espoir. Mais j’ai su trouver ceux qui ont su le faire à ma place. Et rien que ça, ça me donne une joie immense.
— C’était pas une idée idiote cette virée ! je m’entends réfléchir à haute voix.
— Pas idiote du tout. Merci encore. Ça m’a fait un bien fou.
Ses mots m’émeuvent aux larmes, sa main chaude qui se pose sur ma cuisse me donne des frissons. J’ai l’impression de retrouver peu à peu notre complicité perdue, et je suis aux anges.
— Je te rembourserai les frais que tu auras à Capbreton.
— T’en fais pas pour ça. Vraiment pas.
Évidemment, je me garde bien de lui dire que ce sont les sous de Thibault et d’Ulysse (ce dernier a voulu partager les frais de mon séjour à Bordeaux avec le premier) qui vont me permettre de m’installer à Capbreton et d’y rester le temps qu’il le faudra. Les deux rugbymen m’ont demandé de ne rien dire à Jérém pour ne pas qu’il se sente gêné par leur geste.
— L’important c’est que ça se passe bien. Je t’aime, Jérémie Tommasi !
Nous arrivons à Paris dans la soirée et nous dînons au restaurant. Pour la première fois depuis des mois, je dors avec Jérém. Pour la première fois depuis des mois, il me laisse le prendre dans mes bras. Pour la première fois depuis l’accident, je sens que la boule de rage qui était dans son ventre semble s’être dissipée. Cette nuit, Jérém dort du sommeil du juste.
Moi, en revanche, je dors très peu. Malgré le fait que Jérém m’ait dit que je ne risque pas de lui faire mal, je n’arrive pas à me détendre. Mais le fait de le tenir dans mes bras, et les quelques baisers que nous nous sommes échangés avant de nous souhaiter une bonne nuit, me mettent du baume au cœur.
Lundi 7 avril 2003.
Jérém est attendu pour son admission au Centre dans l’après-midi. Après avoir ramassé mes affaires et aidé Jérém à réunir les siennes, nous reprenons la route. Jérém semble soucieux. Dans sa tête, mille questions doivent fuser. C’est le début du moment de vérité. Il va faire un check up, avant l’étude du plan de rééducation. C’est là qu’il va savoir si tout se passe bien ou pas. Il doit appréhender les résultats des tests qui l’attendent. J’appréhende aussi. Il doit appréhender la réponse de son corps à la rééducation. Il doit avoir peur que les résultats se fassent attendre plus que prévu. Ou, pire, qu’ils ne soient jamais au rendez-vous. Les semaines, les mois à venir vont être déterminants pour la suite de sa carrière sportive. C’est là que tout se joue.
— Ça me rassure que tu sois là, je l’entends me glisser à un moment.
Je croise son regard et j’y vois une peur panique immense.
— Je suis là, et je serai là autant qu’il le faudra.
En passant à côté de Poitiers, j’ai un petit pincement au cœur en pensant à Ruben, à cette famille dont il m’a souvent parlé et que je ne connaîtrai jamais. Je ne regrette pas d’avoir volé au secours de Jérém, la seule chose que je regrette est de n’avoir pas été honnête plus tôt avec le petit Poitevin. Je l’ai été, dans une certaine mesure. Mais ça ne l’a pas empêché de tomber amoureux de moi et de croire en des rêves dans lesquels je n’ai jamais cru, des rêves que j’ai fini par briser, et par deux fois.
Sur la route vers Capbreton, nous faisons une halte à Bordeaux pour que je puisse récupérer d’autres affaires. Mes deux propriétaires viennent nous saluer. A nouveau, Jérém est accueilli avec une chaleur et une affection qui font vraiment du bien.
Lorsque je leur annonce que je vais m’installer à Capbreton pendant quelque temps pour rester aux côtés de Jérém pendant le début de sa rééducation, Albert n’hésite pas un instant.
— Pendant tout le temps que tu seras là-bas, tu n’auras pas à nous payer le loyer de l’appart. On te le garde jusqu’à l’automne, sans problème.
— On te le gardera le temps qu’il faudra, abonde Denis.
— Oui, le temps qu’il faudra, lui fait écho Albert.
— Merci beaucoup, merci de tout cœur ! je leur lance.
— On va dire que c’est notre contribution à la bonne cause de faire retrouver le meilleur de sa forme à ce beau et bon joueur, ainsi que le chemin du terrain de rugby.
— Merci, fait Jérém, l’air tout aussi ému que moi.
— C’est beau, ce que tu fais, Nico, avance Albert. Tout lâcher pour aider le garçon que tu aimes. Là, tu me plais, Nico. Certains avancent que nous, les pédés, ne sommes pas de hommes parce que nous ne sommes pas attirés par les femmes, il continue. Mais rappelle-toi ce que te dit un vieux croulant. Être un homme ne veut pas dire épouser une femme, aimer le foot ou le rugby, comme on veut nous faire croire dans le monde. Être un homme, c’est avant toute chose être droit et responsable, c’est protéger les siens, ceux qu’on aime, et qui nous aiment. Et là, Nico, tu n’as rien à envier à aucun soi-disant « homme ». Au contraire, il y a tant de guignols hétéros qui devraient prendre exemple sur toi.
— Le papi a raison, me lance Jérém, lorsque nous reprenons la route.
— Lequel ?
— Le plus âgé…
— Il a raison au sujet de quoi ?
— Un homme, c’est ce qu’il a dit.
Ulysse avait bien raison. Le roseau est toujours débout après le passage de la tempête.
Lundi 7 avril 2003, 17h12.
Le Centre de rééducation est situé juste derrière la plage. Depuis le parking, on entend le vrombissement des vagues, et on sent à plein nez les effluves d’eau salée.
Au check in, je suis touché que Jérém écrive mon nom et prénom et qu’il me demande mon numéro pour garnir la rubrique « Personne à appeler en cas d’urgence ».
Par ce simple geste, il acte le fait qu’il accepte ma présence, aussi longtemps que nécessaire, qu’il me fait confiance, qu’il apprécie que je sois là. Et ça me touche énormément.
La chambre de Jérém a vue sur l’Océan, sur le sable, sur le ciel. C’est magnifique. La chambre et le lit sont assez grands pour deux. Ça m’arrache le cœur de passer la nuit ailleurs. Mais pour l’aisance de Jérém, il est préférable que je m’en tienne aux plans, et que je trouve un hébergement dès ce soir.
Je demande à l’accueil, et la réceptionniste me donne les coordonnées d’un bailleur qui loue des meublés pour les accompagnants, à la semaine. Le prix n’est pas donné, mais j’ai pour consigne de ne pas m’arrêter sur ce genre de détail. C’est confortable de pouvoir compter sur la générosité désintéressée de mes deux jeunes et adorables sponsors. C’est dans le besoin, qu’on voit qui sont les vrais amis.
Le bailleur dispose de plusieurs studios à quelques centaines de mètres du Centre. J’en réserve un et je paie cash la première semaine de loyer.
Puis, Jérém et moi allons dîner au resto. C’est le dernier resto que nous allons partager pendant un bout de temps, parce qu’on nous a bien précisé à l’admission qu’à partir du début de la rééducation, l’alimentation de Jérém sera pilotée et surveillée afin d’optimiser ses chances de récupération. Alors je choisis un bon restaurant, et j’invite mon homme.
— Mais t’as vu les prix ? T’as gagné au loto, ou quoi ?
— T’inquiète, ça va aller.
Je passe une bonne soirée. Nous passons une bonne soirée. Jérém est favorablement impressionné par l’endroit et par l’accueil qui lui a été réservé. Tout dans ce Centre, la déco, les chambres, les tenues du personnel, dégage un côté professionnel et performant qui est très rassurant. Et la proximité de l’Océan, la puissance des éléments est un plus non négligeable.
Après le repas, je raccompagne mon beau au Centre. Je l’accompagne jusqu’à sa chambre, pour pouvoir lui faire un câlin et un bisou avant de lui souhaiter une bonne nuit.
Au moment de nous quitter, Jérém a l’air fébrile.
— Et si ça marche pas ? il me questionne, l’air complètement perdu et inquiet.
— Ça va marcher !
— Tu viens quand demain ?
— Je viendrai dans la matinée, j’attendrai que tu aies fini tes visites.
M’arracher de son étreinte, m’éloigner de ce garçon qui a besoin de moi et qui accepte enfin mon aide est une déchirure. C’est dur de le quitter. Mais il le faut. Je pleure pendant tout le trajet entre le Centre et le meublé.
Quelques minutes plus tard, je me retrouve seul dans cet appartement encore étranger. Je me sens perdu, et je ressens une boule au ventre à l’idée d’avoir laissé Jérém seul, lui aussi, seul avec ses angoisses. Il est 23 heures passées, mais j’ai besoin d’entendre une voix familière.
Je sais que Papa et Maman ne se couchent jamais avant minuit. J’appelle à la maison. Je tombe sur Papa.
— Tu as eu raison de l’accompagner, Nico, il va avoir besoin de toi, m’encourage Papa.
— J’espère arriver à suivre quand même mes cours, mes camarades m’ont promis de me passer leurs notes.
— Tu es assez doué pour y arriver.
Cette confiance et cette estime que Papa me témoigne depuis notre réconciliation me touchent toujours autant.
— J’espère.
— Des cours, ça peut se rattraper plus tard. Des blessures comme les siennes, il faut les panser maintenant.
— Hélas, je ne suis pas chirurgien, ni kiné…
— Je parlais des blessures intérieures, celles qui ne se voient pas, mais qui font le plus de dégâts.
— Je sais, Papa.
— Tu l’aimes, et il t’aime. Ta place est à ses côtés. Il a besoin de toi. Aide-le.
— J’espère qu’il va m’en laisser l’occasion…
— Dis-lui que c’est ton père qui t’envoie ! il plaisante.
Papa arrive à me tirer un sourire ému. Il me touche vraiment.
— Je suis fier de toi, Nico
— Merci Papa !
Ses encouragements me vont droit au cœur. Les mots de Maman vont dans le même sens, et je me sens compris et soutenu. Et ça fait un bien fou. 7 commentaires
7 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Jérém&Nico - Saison 1